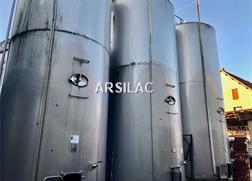’ordre du jour de votre assemblée générale était riche, qu’en retenez-vous ?
Stéphane Gabard : C’est une assemblée élective où l’on renouvelle un tiers de notre conseil d'administration avant l’élection du président chaque année. Nous avons renouvelé le tiers sortant et le prochain conseil d’administration désignera le président.
Vous présentez-vous à votre succession et y-a-t-il d’autre candidat ?
Je suis candidat à ma réélection et il n’y a pas d’autre candidat à date. Il y a deux ans, il y avait eu un autre candidat. C’est ouvert et c'est toujours très intéressant d'avoir une part de démocratie dans nos instances. Sur ce sujet, nous avions la refonte d'une partie de nos statuts lors de l’assemblée générale. Avec la crise et les contestations diverses et variées, certains ont challengé notre dispositif électoral*. L’an dernier, nous avons eu quelques contestations sur des élections de secteur. Nos services ont commis une erreur d'affectation d’un délégué qui a été élu sur le mauvais secteur. Nous avons décidé de revoir une partie de nos statuts avec un avocat spécialisé et de remettre au goût du jour les statuts qui étaient anciens. Nous avons fiabilisé nos élections, les services juridiques de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité doivent finir de les étudier pour les valider.
L’an passé, des candidatures au renouvellement du conseil d’administration, notamment proches du collectif Viti 33, s’étaient émues d’être présentées sur une liste à part, un canal contestataire, face à votre liste, le canal historique.
Il y a eu cette contestation qui était effectivement légitime. L'année dernière, on m’a reproché ma sémantique [NDLA : Stéphane Gabard évoquant une liste de personnes investies dans les instances et une autre d’opposition], parce qu’à la base, ce sont tous des viticulteurs qui ont envie de sortir l’appellation vers le haut. Après, il y a des approches différentes. Aujourd'hui, on a besoin de représentants qui s'impliquent. Le canal historique et le canal contestataire ont pu se parler. Cette année, il y a eu autant de candidats que de postes. On a trouvé les meilleurs candidats aux différents postes pour que ça travaille dans un équilibre serein. Dans toutes les commissions et dans tous les groupes de travail il y a des membres du collectif, il y a du canal historique… Il n’y a pas de différenciation, simplement ceux qui veulent travailler et œuvrer pour la filière.
La hache de guerre semblant enterrée, des projets collectifs ont-ils pu avancer ? Comme le sujet de l’évolution du cahier des charges de l’AOC Bordeaux, avec les enjeux de rouge frais, de sucrosité, de réduction du degré alcoolique, de segmentation… ?
Cette cohésion permet de travailler ensemble sur le cahier des charges, sur les évolutions de la loi Egalim et surtout sur des évolutions d’organisation de producteurs… Après le sujet des statuts, le gros dossier de l’assemblée générale était de remettre au goût du jour la mention claret, qui existe dans notre cahier des charges (comme simple mention, sans définition de critères organoleptiques et analytiques), mais qui aujourd'hui est très peu utilisée (on a aujourd’hui des ventes sur le marché britannique, à peu près 11 000 hectolitres plutôt d'entrée de gamme aux alentours de 5 livres).
Vous parlez de claret (prononcé clarette), une mention historique pour les vins bordelais (le new french claret de la famille Pontac et du château Haut Brion au XVIIème siècle), qui sera donc distincte de l’appellation Bordeaux clairet actuellement en place ?
Ce sera bien distinct du Bordeaux clairet. On cherchait dans notre segmentation à avoir ce fameux rouge léger, convivial, aromatique, qui peut être consommé dès la sortie du frigo. Ce fameux nouveau produit qu'on pourrait faire sous signe de qualité AOC. Cela peut correspondre à cette mention de claret, parce que pour les anglo-saxons le claret était un rouge clair. Donc par extrapolation, cela peut être un rouge léger.
Comment le claret va-t-il s’articuler par rapport au clairet ?
Dans la catégorie des rosés, nous avons le Bordeaux rosé et le Bordeaux clairet. Dans la catégorie des rouges on a le Bordeaux rouge et le Bordeaux claret. Voilà, on est sur deux choses différentes.
Ne craignez-vous pas que la nuance claret/clairet soit source de confusion pour les consommateurs ?
Il fallait faire des arbitrages. Nous aurions pu faire évoluer le cahier des charges du clairet pour que cela corresponde. Ça, les producteurs historiques de clairet ne le souhaitaient pas. Ils voulaient rester sur un rosé gastronomique, plutôt foncé et un peu tannique. Nous pouvions soit créer une nouvelle mention, soit créer une nouvelle catégorie. Mais on sait très bien que créer une nouvelle AOC, au-delà d'arriver à se mettre d'accord sur un nom, aurait demandé du temps. Même si l'INAO réagit beaucoup plus rapidement.
Un principe fondamental des appellations d’origine défendu par l’INAO est aussi l’usage loyal, local et constant…
Vous voyez bien tous les freins qu'il pouvait y avoir à créer une nouvelle mention. Cet usage constant historique du claret permet d’adopter un cahier des charges relativement simple, mais avec une idée de profil produit bien définie.
Quels vont être les modalités de production du claret : densité, rendement, vinifications… ?
Au niveau du cahier des charges, on reste sur la même latitude que le cahier des charges Bordeaux rouge sur tout ce qui est densité, conduite au vignoble… Il n’y a rien de différent. On change juste quelques paramètres au niveau œnologique. Pour les vinifications, il y a plein de méthodes : ça peut être de la macération, ça peut être du pressurage direct, ça peut être de la thermovinification. Et on a vu dans nos dégustations qu’il y a des choses intéressantes dans chaque méthode. La fermentation malolactique est obligatoire pour les Bordeaux rouges, elle est facultative pour le claret parce que l’on pourrait avoir besoin de plus d'acidité sur certains profils. L’Intensité Colorante Modifiée (ICM) va être définie entre 3 et 15, ce qui est très large (en dessous de 3, c'est l’ICM du clairet). On encadre l’Indice des Polyphénols Totaux (IPT) entre 20 et 50.
La chose un petit peu novatrice que l'on voudrait utiliser, c'est la sucrosité. Pour avoir de la buvabilité et de la rondeur, on veut une certaine facilité, même à basse température. On demande de pousser la sucrosité à 7 grammes par litre. Et pas en sucre fermentescible ou en sucre résiduel, mais plutôt en édulcoration, par l'ajout de Moûts Concentré Rectifiés (MCR). On a fait beaucoup d'essais ici, en rajoutant de la sucrosité, des fois 2 grammes suffisent et sur d'autres matrices 5 g/l marchent mieux. Lorsque l'on est sur des sucres fermentescibles, donc des arrêts de fermentation (avec ce que cela a d’impossible pour s’arrêter au gamme prêt) il est très dur de se projeter sur le profil produit. Et puis on est sur un produit où il peut y avoir des déviations organoleptiques possibles s’il reste des sucres. On sait très bien que lorsqu'on a assaini le vin et que l'on rajoute de la sucrosité, c’est beaucoup plus facile pour la conservation avec beaucoup moins de risques de déviance.
Pour résumer, le claret c'est un vin rouge qui est frais et édulcoré.
Qui peut être édulcoré. La sucrosité est vraiment un outil et c'est pour ça que l'on souhaite monter jusqu’à 7 g/l. On avait des demandes d'opérateurs pour aller bien au-delà hein, sur 10 à 12 g/l. L'idée n’est quand même pas que ce soit un rouge moelleux. On est vraiment sur une aide œnologique qui va participer à la rondeur, à la longueur en bouche, mais qui ne marque pas.
Est-ce qu’il existe déjà des produits typés claret en Gironde, en IGP Atlantique ou en vin de France ?
Il en existe pas mal. Par exemple la cave coopérative de Berticot (spécialiste de l'IGP) et des viticulteurs indépendants qui le font hors appellation.
Quels sont vos objectifs de calendrier pour aboutir avec cette nouvelle appellation ? J’imagine que c’est un peu compromis pour le millésime 2024…
C’est totalement compromis pour 2024, il n’y a aucun espoir étant donné que l'on demande des choses un petit peu différentes. Il y aura la nomination d’une commission d'enquête et un travail d'aller-retour avec l'INAO. On aimerait bien que la claret soit quelque chose d'effectif aux vendanges 2025.
Avec le lancement d’une communication à ce moment…
Exactement. C’est quelque chose que l’on a commencé à tester en questionnant les consommateurs sur Bordeaux Fête le Vin. L'idée est vraiment de faire quelque chose de très souple, d’une très bonne buvabilité, de très agréable. Sans tomber dans la perversion de quelque chose d’insuffisant, de dilué. L'idée derrière ça, c'est donc un cahier des charges plutôt simple, en revanche un contrôle produit très renforcé. Sûrement un contrôle produit systématique. Ça sera à définir avec la commission d'enquête. L’idée est de bien définir les profils produits pour ne pas avoir des choses trop atypiques.
Sur les autres sujets, quelles sont les avancées pour la réduction du degré d'alcool, la sucrosité dans d’autres rouges de Bordeaux ou la segmentation ?
Pour l’instant, cette sucrosité sera envisagé sur un petit segment qui s'y prête bien. Et après un retour d'expérience de plusieurs années, on verra en fonction du bilan. C’est très novateur. On pourrait être le premier vin d’appellation à s’autoriser l'édulcoration, qui est permise en AOC, mais pour l'instant aucun cahier des charges ne l'a validée. Nous l’essayons sur un petit segment.
C'est tout le défi des appellations : être patrimoniale tout en s'adaptant aux tendances commerciales pour avancer sur ces deux jambes.
Il y a cette dichotomie. Aujourd'hui, avoir une appellation veut dire que j'ai un produit encadré par l'État et que j'essaye derrière de trouver une clientèle, un marché… Aujourd'hui, lorsque l’on a un marché, on aimerait voir comment nos vins d'origine, nos terroirs, nos savoir-faire peuvent répondre à cette demande sans se renier, toujours en ayant un lien à l'origine, mais avec quelques petites adaptations pour répondre un petit peu mieux.
Et concernant la désalcoolisation partielle de vos AOC ?
Le sujet nous intéresse. Le conseil d'administration a décidé que les techniques n’étaient pas encore assez mûres au vu des essais de notre commission technique. On trouve le meilleur comme le pire, avec de sévères déséquilibres et donc une déception client. On reste sur un statu quo. On pensait peut-être baisser notre degré minimum pour aller utiliser le dispositif de désalcoolisation actuellement limité à 20 %, mais ce serait prématuré étant donné que les techniques ne sont pas mûres. Ça ne va pas dire être fermé à ces techniques. Peut-être que l'on essaiera un Dispositif d’Evaluation des Innovations (DEI).
Où en est la segmentation de l’appellation Bordeaux, avec cette idée d’une mention type grand cru ?
Ça fait partie de notre feuille de route stratégique. L'enjeu est de rebattre l'intégralité de notre segmentation. Nous aurions pu faire ce nouveau produit, ce rouge frigo facile à boire dans l'appellation Bordeaux rouge, nous avons préféré créer une catégorie un petit peu à part avec le claret. C'est un peu le début de notre segmentation. Si on veut faire des vins un peu plus légers, un peu plus faciles à boire, un peu moins taniques, ils sont en claret. Maintenant, il faut que l'on s'accroche à notre segmentation Bordeaux, Bordeaux sup. Et peut-être un troisième niveau. Le chantier est vaste, on préfère mener les travaux les uns après les autres pour ne pas les bâcler.
Vous segmentez le profil de vos vins rouges structurés/légers, mais le manque de structuration des prix de Bordeaux, avec une fourchette allant très bas, perturbe beaucoup les clients…
La variation des profils produits est notre richesse, mais c'est aussi notre inconvénient quand la contre étiquette n’est pas suffisamment précise. C'est un peu la loterie Bordeaux, quand vous achetez un vin en grande surface : vous ne savez pas comment vous allez atterrir. Pour l’instant les échanges continuent, on n'a pas la solution magique qui pourrait faire consensus. On préfère la travailler encore un petit peu plus pour ne pas se tromper. On ne change pas une appellation tous les quatre matins.
Concernant les cépages, avez-vous des éléments de bilan sur les expérimentations menées ou de nouvelles demandes de Variétés d’Intérêt à Fin d’Adaptation (VIFA) ?
Nous avons intégré un certain nombre de VIFA, mais il nous reste encore quelques places. C'était un choix stratégique de pas avoir comblé toutes les cases. Car au niveau de l'INRA on devrait avoir l'homologation des nouveaux ResDur2 : des cépages résistants issus de de cépages originaires de Gironde. Qui auraient peut-être des profits aromatiques plus proches que ce que nous avons aujourd'hui. Nous allons avoir nos premiers retours, nos premières dégustations sur les VIFA, ça va être très intéressant. Ce matin dans l'Assemblée générale, il y a eu une demande de viticulteurs qui aimeraient que l'on ouvre nos cahiers des charges à beaucoup plus de cépages. Nous poussons aussi nos viticulteurs à utiliser un petit peu plus tous les cépages de nos cahiers des charges. En Gironde et en rouge, on a quand même passablement de cépages. Il y en avait quand même un, voire deux qui étaient très utilisés, les autres beaucoup moins. Et on voit qu'avec le changement climatique, le cot, le petit verdot et le carmenère peuvent être très intéressants (étant des cépages plutôt tardifs). Il y a aussi le travail sur l'adaptation au porte greffe et des techniques culturales (comme l'abaissement de la surface foliaire voté ce printemps).
L’autre gros sujet d’adaptation pour le vignoble bordelais est sa réduction de potentiel par l’arrachage qui est en cours. On entend qu’en Gironde il y aurait 20 000 hectares en moins d'ici la fin de l'année. Partagez-vous ce pronostic ?
Chacun dit ses chiffres. Les seuls que je crois sont ceux des Douanes, avec les déclarations effectives d'arrachage dont on est sûr et certain, et les déclarations de récolte et de revendications, parce que l'on sait très bien qu'il y a des hectares qui ne vont pas être arrachés, mais qui ne seront pas revendiqués parce que les vignes sont en friche, ne sont pas cultivées. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup d'exploitations veulent réduire la voilure et ont arraché sans le dispositif d’arrachage sanitaire sur 8 000 hectares. Ceux qui annoncent des chiffres au-delà de 20 000 ha doivent garder les proportions. Il y a un peu d’arrachage en Côtes et en Médoc, mais c'est beaucoup l'appellation régionale qui arrache. Quand vous avez une appellation régionale qui fait 55 000 ha et que certaines personnes annoncent 30 000 ha arrachés, cela ferait quasiment un hectare sur deux (en AOC Bordeaux). Même si aujourd'hui quand vous circulez dans le vignoble on voit beaucoup de surfaces libérées, on n'est pas à un hectare arraché sur deux. On n'y sera pas, c'est sûr et certain. Déjà, si vous êtes entre 15 et 20 000 ha, c'est un hectare sur trois. C'est déjà énorme.
À terme, l’AOC Bordeaux pourrait perdre son titre de premier vin d’appellation.
Je ne sais pas. Il va y avoir un dispositif d'arrachage national et d'autres régions, qui étaient très viticoles, vont aussi réduire la voilure. Peu m'importe si on est premiers en surface, j'aimerais être le premier en valorisation.
Dans la population vigneronne, on sent non seulement une fragilité économique croissante, mais aussi un décrochage du moral qui peut devenir abyssal…
Est-ce qu'il y a un viticulteur en forme aujourd'hui ? On voit bien que tous les modèles sont attaqués. Coopération, indépendant, vente directe, vente négoce, marché français, marché export... Il y a des modèles et des systèmes qui fonctionnent mieux que d'autres, c'est évident. Mais il y a encore un an de ça, on avait certains opérateurs qui étaient très préservés, qui avaient des structures qui fonctionnaient bien, qui étaient même en progression. Aujourd'hui, ils sont plus prudents. Et la viticulture ne vit pas dans un monde clos : les signes de notre environnement extérieur ne sont pas encourageants. Au niveau international, les tensions sont à l’Est et à l’Ouest. Au niveau français, je ne sais pas si tout le monde a une visibilité claire de ce qui va se passer politiquement dans les prochaines semaines. Moi pas.
Toute cette crainte ne peut qu'alourdir le fait que l'on est dans une profession difficile, soumise aux aléas climatiques. Depuis 2017, ça fait 8 années d’incidents climatiques récurrents et importants. Ce n'est pas ponctuel, ce n'est pas une petite surface. C’est du jamais vu. La résilience du viticulteur existe, mais tout a une limite.
Dans ce contexte difficile de réduction des commercialisations et du potentiel de production, on entend des craintes sur la stabilité financière d’Organismes de Défense et de Gestion (ODG) et même d’interprofessions. Qu’en est-il pour le syndicat des Bordeaux et Bordeaux supérieur ?
Toutes nos structures vivent de cotisations, soit sur la production, soit sur la commercialisation. Le vignoble girondin est monté à un peu plus de 115 000 hectares, on a frôlé la barre des 6 millions d'hectolitres. On va sûrement cette année descendre en dessous de la barre des 100 000 hectares. On est en commercialisation à 3,5 voire 3,4 millions hl. En ayant des cotisations qui sont basées sur les volumes et les surfaces, il y a obligatoirement beaucoup moins d'argent qui rentre dans les caisses de chaque organisme. Il y a donc une réflexion au niveau de la filière pour arriver à avoir plus d'efficience, plus d'économie. Aujourd’hui c’est dur pour toutes les ODG, pour la Fédération des grands vins de Bordeaux (FGVB), pour l'interprofession (CIVB).. On voit bien qu'il faut réfléchir à nos missions, peut-être changer les périmètres. Et avant de faire moins, on peut-être faire mieux.
Il n’y a donc pas de péril en la demeure pour le syndicat des Bordeaux et Bordeaux supérieur ?
Non. Mais il y a une véritable réflexion. Suite à ce recul, on a abandonné nos projets de réhabilitation et de projets œnotouristiques. Nous avons une grande maison qui est vieillissante, il y a des frais à y mettre, donc il y a tout un schéma de réflexion pour savoir s'il faut garder les périmètres. Je crois qu’il y a 28 ODG en Gironde aujourd’hui : a-t-on besoin d’autant d’ODG ? Est-ce que souvent l’on ne fait pas les mêmes missions ? Il y a peut-être moyen de se fédérer et de créer des économies qui seront toujours profitables pour la base. Créer des synergies, créer des spécialités. Je pense qu'on en a besoin. Nos adhérents ont le droit de demander plus d'efficience.
* : Dans le détail, Stéphane Gabard explique qu’« avec la grande taille de notre ODG (Organisation de Défense et de Gestion) nous avons une organisation décisionnaire un petit peu particulière. Ce n'est pas l'ensemble de nos vignerons adhérents à l'ODG Bordeaux qui peuvent siéger à l'Assemblée générale, mais ce sont des délégués de secteur, nos grands électeurs entre guillemets. Correspondant aux anciens cantons administratifs, chaque secteur est représenté par un délégué tous les 350 hectares de vignes et un délégué par tranche de 100 adhérents offre droit à un super électeur. Ces 176 délégués sont renouvelés par tiers chaque année, siègent deux fois par an à l'assemblée générale et vont élire le renouvellement du conseil d'administration. »