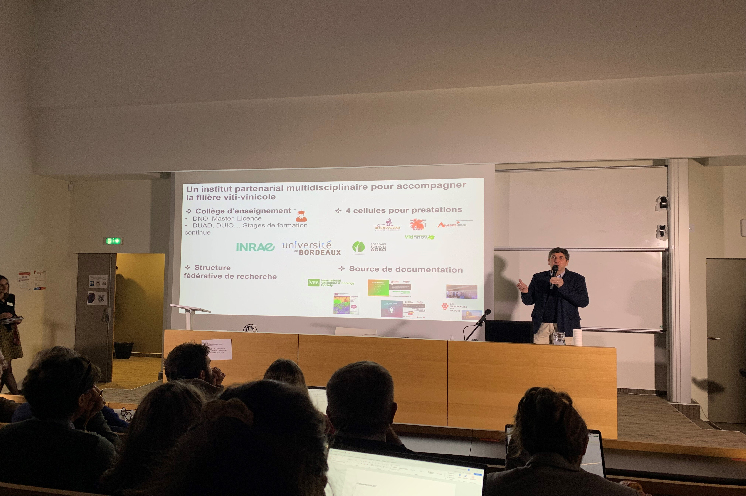Outre l’acidité et la teneur en sucres, le réchauffement climatique modifie la composante aromatique des vins. « Des marqueurs de vieillissement prématuré apparaissent comme les arômes de pruneaux », explique Céline Cholet, enseignant-chercheur à l’UMR Œnologie de l’ISVV de Bordeaux.
Pour étudier ses conséquences, des chercheurs bordelais ont récolté du merlot et du cabernet sauvignon de parcelles issus du réseau suivi maturité de l’ISVV dans l’Entre-Deux Mers en 2017 à trois dates différentes, chacune espacées d’une semaine : en sous-maturité, à maturité et en sur-maturité selon les critères du viticulteur qui s’appuie sur les conseils du réseau Bordeaux Raisin.
Pour chaque lot, ils ont suivi trois molécules à la mise et cinq ans plus tard : deux marqueurs de sucrosité, l’epi-DPA-G et l’astilbine, et un arôme marqueur du vieillissement prématuré des vins rouges, la MND, aux notes de pruneau.
Premiers résultats : quels que soient la date de récolte et le cépage, les marqueurs de sucrosité diminuent au cours du temps tandis que le marqueur de vieillissement prématuré augmente.
« Par ailleurs, on observe un effet cépage, explique Céline Cholet. La teneur en MND augmente plus rapidement dans les vins de merlot que dans ceux de cabernet sauvignon quelle que soit la date de récolte, ce qui traduit un vieillissement prématuré plus rapide du merlot. Même chose pour l’un des marqueurs de sucrosité, l’astilbine, qui baisse davantage dans le merlot que dans le cabernet sauvignon ».
Des tests triangulaires, qui n’ont pu être réalisés que sur le merlot, ont également permis au jury de percevoir des différences significatives entre les dates de récolte.
« Sur 53 vins testés, 29 vins permettent la croissance de Brett tandis que sept autres ne la permettent quasiment pas, indépendamment de l’ajout ou non de SO2. On parle de permissivité des vins », explique Warren Albertin, maitre de conférence à l’Université de Bordeaux en présentant les résultats de la thèse de Julie Miranda. Mêmes si les raisons restent encore mystérieuses, on sait que l’éthanol joue un rôle : moins il y a d’éthanol, plus Brett s’implante facilement. A noter également que certaines souches de Brett poussent beaucoup mieux que d’autres. Si tous les vins ne sont pas égaux devant Brett… toutes les Brett ne sont pas égales devant les vins !
Une autre thèse, Paul Le Montagner celle-ci, nous apprend aussi que Brett possède une capacité à adhérer aux surfaces sur lesquelles elle se développe. Après trempage d’un morceau d’inox dans un vin contaminé par Brett seulement 3h, un biofilm peut se former avec des niveaux de populations pouvant aller jusqu’à plusieurs millions de Brett par cm² ! Ces biofilms se développent mieux sur de l’inox que de l’epoxy. Leur formation dépend aussi de la souche de Brett et des autres micro-organismes présents. En revanche, le pH et l’éthanol affectent peu la bio-adhésion. « Des éléments supplémentaires en faveur d’un protocole de nettoyage soigneux », affirme Warren Albertin.
En Italie, des chercheurs ont mesuré l’impact de la désalcoolisation sur deux vins rouges d’aglianico, un cépage local. L’un de ces vins titrait 15,5 % vol. et l’autre 13,8 % vol. A l’aide d’un contacteur membranaire, les chercheurs les ont désalcoolisés à trois niveaux différents : -2% vol., -3% vol. et -5% vol. S’ils n’ont observé aucune différence au niveau des paramètres chimiques de base (acidité, SO2, pH…), de la couleur et des composés phénoliques, ils ont constaté « une perte de la plupart des composés volatils proportionnellement à la désalcoolisation, surtout des esters » indique Maria Tiziana Lisanti, chercheuse à l’université de Naples.
Lors des tests triangulaires, un jury non entraîné n’a pas distingué les deux vins désalcoolisés de 2 % vol. des témoins. En revanche, il a bien vu que ceux désalcoolisés de 5% vol. étaient différents. Et après la désalcoolisation de 3% vol., seul le vin qui titrait initialement 13,8 % vol. a été perçu comme différent. « Il semble donc que les dégustateurs amateurs ne perçoivent pas de différence tant qu’on ne désalcoolise pas les vins de plus de 20 % de leur titre alcoométrique initial » conclue la chercheuse.
Dans un second temps, les chercheurs ont demandé à un jury « expert » de classer les vins par ordre de préférence. Pour le vin à 13,5%, c’est le lot non désalcoolisé qui a obtenu la meilleure note. En revanche, plus surprenant, dans le cas du vin à 15,5% vol, le jury a préféré le lot désalcoolisé de 2% au témoin et au lot désalcoolisé de 5% !
Les chercheurs australiens de l’AWRI, découvreurs des thiols dans les vins rouges, ont repris leurs travaux en s’inspirant des Français. En 2019, ils ont pulvérisé du soufre mouillable et de l’azote (urée) sur de la syrah et du chardonnay au début de la véraison à hauteur de 15 kg/ha puis une seconde dose de 30kg/ha 2 à 3 semaines après. Alors que les vins témoins de syrah ne contiennent pratiquement pas de 3MH (thiol à l’arôme de pamplemousse), ceux ayant eu le premier apport d’azote et de soufre en contiennent 1500 ng/L et ceux ayant le double en renferment 3600 ng/L. Autant que le chardonnay. « C’est sans ambiguïté » annonce Philippe Darriet, directeur de l’ISVV.
Retour en France, à l’université de Bordeaux où Emilio de Longhi s’intéresse aux vins de riesling. Ce doctorant s’est demandé pourquoi ceux de la vallée du Rhin possédaient des notes citronnées tandis que ceux de la vallée de la Moselle, présentaient des notes de pêche et de fruits exotiques. Il faudra attendre sa soutenance de thèse en juin pour le savoir. Mais déjà, on a appris qu’il a découvert deux thiols qui n’avaient pas encore été identifiés dans ce cépage, le 3-sulfanylheptan-1-ol et l’ethyl 2-sulfanylpropionate, respectivement aux notes de pamplemousse et de roquette.
Autre surprise : Emilio de Longhi a découvert un nouveau composé, jamais rencontré jusque-là dans les vins. « C’est un composant à la fois terpénique et thiolé, le trans-p-menthane-3-one-8-thiol, aux notes de cassis très prononcées », explique Philippe Darriet. Emilio de Longhi a également montré que certains thiols, en mélange, pouvaient intensifier les notes de viande grillée dans les vins de riesling.
Enfin, lors d’une autre thèse, Emilie Suhas, son auteure, a découvert cinq thiols (2-methoxybenzenethiol, 5-methylfurfurylthiol, 2,5-dimethylfuran-3-thiol, o-toluenethiol, 2,6-dimethylbenzenethiol et 2,6-dimethoxybenzenethiol) qui se forment lors du vieillissement des vins rouges en barriques. En présence de composés du bois et d’H2S, ces composés issus de la transformation de précurseurs peu odorants vont se former dans les vins. « Ils participent au bouquet réducteur des vins avec des notes de viande grillée », détaille Philippe Darriet.
Quels polyphénols les colles éliminent-elles ? Pour répondre à cette question Gauthier Lagarde, doctorant de l’Université de Bordeaux, a utilisé une nouvelle technique de resolubilisation des précipités de collage. Pour commencer, il a collé un cabernet sauvignon de 2021 avec différentes colles - colle de poisson, albumine, gélatine, PVPP, bentonite, mélanges – toutes employées à 20 g/hL. Première conclusion : « Les bentonites précipitent bien plus d’anthocyanes que les autres colles », explique Michael Jourdes, maître de conférence à l’ISVV et encadrant de la thèse. Elles sont donc à éviter pour les vins qui manquent de couleur. Autre résultat : la gélatine est la colle qui précipite le plus de tanins. Enfin, la PVPP précipite les flavonols -pigments de couleur jaune- et procyanidines, « avec une affinité particulière avec la catéchine » précise Michaël Jourdes avant de conclure : « chaque colle a donc sa carte d’identité spécifique et précipite spécifiquement certains composés ». De quoi mieux comprendre l’impact du collage.
Et s’il existait une signature chimique propre à chaque domaine permettant d’identifier ses vins ? Stéphanie Marchand-Marion, enseignant-chercheur à l’ISVV de Bordeaux en est convaincue. Elle a réuni les bulletins d’analyse classiques et des analyses par chromatographie en phase gazeuse de sept grands domaines situés sur les rives droite et gauche Bordelaise, sur 12 millésimes. Puis, Alexandre Pouget, chercheur en neurosciences à la Faculté de médecine de l’Université de Genève les a traitées par l’intelligence artificielle. Résultat : sept nuages de points se dessinent sur un graphique, avec trois vins regroupés sur la droite et quatre sur la gauche, comme s’ils étaient séparés par la Garonne (figure x). « Une organisation quasiment géographique de ces châteaux » commente Stéphanie Marchand-Marion. « Il y a donc une empreinte de terroir des vins de Bordeaux démontrée par des analyses purement chimiques. En revanche, cela ne fonctionne pas aussi bien pour reconnaître les millésimes. Le terroir est plus fort que le millésime » conclue Stéphanie Marchand-Marion qui s’intéresse désormais à d’autres régions viticoles. Une étude qui a fait grand bruit… au point d’être relayée par le New York Times !


 Retrouvez tous les articles de La Vigne
Retrouvez tous les articles de La Vigne