



La trentaine intrépide, Adrien Boisnier ne tremble pas devant le défi. « Emisol a fait tout exploser ! » s’exclame le charentais. Peu d’années se sont succédé entre ses débuts en exploitation, puis de mécanicien et sa société éponyme Forge Boisnier comptant une dizaine de personnes qu’il a créé et qu’il dirige depuis maintenant sept ans. « Sorti d’études viti-oeno au lycée de Jonzac, j'ai été employé viticole chez plusieurs exploitants et même chef d'exploitation chez mon dernier employeur, à Chérac. C'est mon rapport conflictuel avec l'autorité qui m'a poussé à prendre les rênes de ma vie professionnelle et à vouloir voler de mes propres ailes. J'ai profité de notre maison de famille située à Celles et de l’opportunité des dépendances qu'elle offrait. Qui plus est, mon grand-père était lui-même exploitant agricole, m'installer sur les lieux de son exploitation était symbolique ! » raconte Adrien Boisnier.
« Je me suis installé mécano à mon compte en 2013 et j’ai rapidement embauché. On fait beaucoup de réparations et de modifications de matériels. En fait, on fait tout ce qu’on nous demande dit-il, le sourire en coin. L’intercep à deux rangs Emisol, c’est moi, un papier et un crayon. Ensuite, j’ai sous-traité le dessin industriel. On a déjà fabriqué 17 modèles. Comme on a amélioré la machine, aujourd’hui, on reprend petit à petit tous ceux qu’on a fabriqués pour les améliorer et pour qu’ils soient au même standard de qualité » décrit Adrien Boisnier.
Mais tout n’est pas rose dans l’histoire de la Forge. Il y a eu des périodes difficiles. « Au tout début de l’intercep Emisol, les viticulteurs n’étaient pas convaincus, ça a été compliqué ». Puis les premiers achats et les démos ont aidé au développement. « Il y a même un client qui en prend un deuxième ! Ça plaît ! raconte, optimiste, Adrien Boisnier. Une autre période difficile a été le Sitevi 2019, tempère-t-il. Il y a eu beaucoup de demandes, difficiles à suivre et à satisfaire. On s'est fait approcher par beaucoup de potentiels distributeurs, c'était difficile de ne pas se faire "embrigader" dans ce monde que l'on ne connait pas. Je veux garder et porter mon projet du mieux possible. Pour l'instant nous travaillons uniquement avec la société Boisumault située à Jarnac. Maintenant, un an après, je me suis assuré que toutes les machines Emisol achetées fonctionnent correctement, je suis serein ». Et Adrien Boisnier peut regarder d’autres horizons. Ce 10 décembre, il rentre du Gard où il vient de mettre en route une machine. « Nous passons la journée à trois personnes. A peine 10 minutes pour la mise en route, le reste pour tester tous les outils du viticulteur : disques, lames, coutres, etc. » Tant et si bien qu’Adrien Boisnier limite la production pour 2021. « 20 machines sont en commande, on n’en fera pas plus, alors même qu’on va embaucher deux ou trois personnes. Il faut que je libère du temps sur la mécanique courante et sur la développement » précise-t-il.
Et justement, Adrien Boisnier ne manque pas d’idées pour assurer l’avenir de sa Forge. « On est en train de sortir des Charentes avec une machine Emisol dans le Gard et une autre près d’Arles, décrit Adrien. On pense bien-sûr à un outil pour vignes plus étroites. Je pense qu’on sortira un prototype d’outil interligne. A voir en fonction des demandes. Mais on réfléchit aussi à un usage sur enjambeur ou porteur de machine à vendanger, en vigne étroite. Il y a une demande en trois rangs, de façon à optimiser l’usage des automoteurs. Sur le modèle Emisol existant, il y a aussi des choses à tester. Le client du Gard voudrait par exemple épamprer ». Adrien Boisnier a du pain sur la planche, ou plutôt de l’alliage de fer à plier et souder !



Du sol à la vigne, il n’y a qu’un pas, que Xavier Cassassolles a franchi il y a cinq ans. Après avoir co-fondé Geocarta en 2001, et après quatorze ans de service en agriculture de précision, y compris pour la vigne, il décide de s’attaquer à la modulation phytosanitaire en 2015. « Avec mon associé René Proharam, nous avons créé Diimotion pour apporter sur le marché de l’équipement une solution pour la pulvérisation de précision, décrit Xavier Cassassolles. Nous avons démarré par l’injection directe, qui permet la modulation de dose en temps réel dans la parcelle. Cela a demandé de travailler particulièrement sur la composante électronique de la pulvérisation. Nous avons travaillé sur le transfert de technologie depuis l’agriculture ». De là est né le fameux module Piix d’injection directe.
Fort de l’intérêt suscité par le Piix, l’équipe s’attèle à une autre tâche. Toujours dans la pulvérisation de précision, Diimotion sort en 2020 la solution Smac de coupure automatique de la pulvérisation en l’absence de feuillage. « Techniquement, c’est René qui porte le produit » précise humblement Xavier Cassassolles.
Lors de l’entretien qu’il nous accorde le 8 décembre 2020, Xavier Cassassolles se trouve néanmoins sur le terrain, dans les Côtes-du-Rhône, entre deux rendez-vous avec des viticulteurs pour l’équipement de leurs pulvérisateurs en coupures de tronçons. « Smac bénéficie d’un très bon accueil se félicite Xavier Cassassolles. Notamment en vignes larges pour les premières versions que nous sortons. En statique, les viticulteurs mettent leurs mains devant les rampes comme si c’était du feuillage et l’enlèvent. Ils voient directement ce qu’est la coupure de buse : pas de feuille, pas de pulvé. La réactivité des vannes les marque. C’est un point clé. Ils comprennent vite qu’en deux saisons, l’appareil est remboursé ».
A la tête d’une entreprise qui compte déjà sept personnes, Xavier Cassassolles et René Proharam explorent plusieurs pistes pour la suite de l’aventure Diimotion : la constitution d’un réseau de distribution de leurs matériels, le transfert de technologie en collaboration avec un constructeur de pulvérisateurs, la miniaturisation de Smac pour enjambeur « D’après les discussions sur le terrain, en vigne étroite, on est perçu comme alternative à la pulvérisation confinée avec panneaux récupérateurs » analyse Xavier Cassassolles, optimiste pour l’usage dans cette configuration.
Seul « hic » cette année, la Covid-19 a chamboulé les plans de Diimotion. « Plusieurs composants n’ont pu être fabriqués et expédiés, explique Xavier Cassassolles. De plus, on n’a pas pu faire de démos en saison de traitements. Les ventes, notamment en médoc, sont reportées ».
Si les contacts commerciaux ont pris un peu de retards, les projets ne sont pas pour autant stoppés. « On se pose aussi la question de développer un pulvérisateur sous notre marque, équipés de nos techniques de pulvérisation de précision, confie Xavier Cassassolles. Des châteaux nous y poussent. C’est une chance d’avoir, grâce à eux, un pied dans les vignes ». En attendant, pour l’année 2021, Diimotion se prépare à équiper 30 pulvérisateurs du kit Smac dans les bassins de Bordeaux, Cognac, Champagne et Languedoc. Pour Diimotion comme pour d’autres fabricants, il y a fort à parier que 2021 sera meilleur millésime que 2020 !



Dans l’Entre-Deux-Mers, il cultive les 50 hectares de vignes des châteaux Chillac et Quillet en agriculture biologique et biodynamique, 35 hectares de céréales, s’occupe de trois gîtes, préside deux CUMA, dont il est également trésorier, siège au conseil d’administration de l’organisme de défense et de gestion de l’appellation Bordeaux, à celui des Gîtes de France, et est membre du Mouvement de l’agriculture biodynamique (MABD). Mais lorsque l’on demande à Laurent Cassy quelle est sa plus grande fierté, c’est à son épouse et à ses deux filles qu’il pense en premier.
Grâce à leur soutien, il a pu accepter la présidence du syndicat des vignerons bio de Nouvelle-Aquitaine en mai 2019. L’occasion parfaite pour « réunir tout le monde autour d’une table, bios ou pas, et de trouver le moyen de rééquilibrer le marché des vins de Bordeaux ». Pas question pour autant de tout mélanger. Quand Bernard Farges, le président du Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB), a proposé cet été la mixité bio/conventionnel dans les exploitations pour sortir de la crise, Laurent Cassy n’a pas hésité à monter au créneau. « La mixité "sans bornes", c’est à nos yeux la voie de la facilité. Nous préférons l’authenticité d’une démarche exigeante », a-t-il retorqué au président de l’interprofession, lui rappelant que le succès de la bio repose sur la confiance que lui porte le consommateur. C’est désormais avec le ministère de l’Agriculture qu’il est en négociation. Laurent Cassy fait son possible pour que tous les viticulteurs obtiennent le droit de lisser le cuivre sur sept ans.



Il a plus d’un tour dans son sac ! Ex-vendeur en concession, formateur tractoristes et ex-agriculteur sur l’exploitation familiale dans sa jeunesse, Renaud Cavalier a gardé de ses débuts professionnels un goût prononcé pour le machinisme au contact des producteurs, notamment de ses frères (l’agriculteur Edouard et le viticulteur Jean-Benoît). Aujourd’hui expert en agroéquipement de la Chambre d'Agriculture du Gard, il continue de mélanger savamment les genres, entre démonstrations au champs, développement de solutions techniques et expertise nationale sur la pulvérisation.
Savant fou ? Pas du tout ! Renaud Cavalier sait où il veut aller. Et il y va. « Je rentre dans la Chambre en 1998 se souvient le natif de Fourques, en rive droite du Rhône. C’est une époque où on commence à parler des problématiques pulvé. Mon rêve était alors de fabriquer le premier banc de réglage pour pulvérisateur en France, car je voyais beaucoup de soucis dans les vignes. On y est arrivés en 2000 avec une subvention de la Région. C’était un banc de mesures mais aussi pédagogique, pour que les résultats parlent aux viticulteurs ». Ensuite, tout s’enchaîne. Le service de traitement spécialisé Adivalor l’appelle pour discuter des bidons mal rincés. L’initiative donne naissance à Rincotop. Puis à la fin des années 2000 arrive Lavotop : Renaud Cavalier met au point une solution pour laver les pulvérisateurs sur la parcelle. Son obsession reste l’écoute du terrain. « Mon souci, c’est de concevoir des solutions que les constructeurs ne font pas » explique-t-il. C’est pour cette raison qu’il développe ensuite d’autres systèmes, comme par exemple un contrôle des débits droite et gauche d’appareil, au lieu d’un seul à l’achat de la machine. Tout comme un simulateur de conduite de tracteur, à destination des jeunes, avec l’aide de Claas, de Groupama et de la MSA.
Dernière innovation en date, cette année 2020, la barre de guidage Matrix 430 VF. Renaud l’a développée en collaboration avec la société Teejet. « Le travail de nuit peut être une vraie galère. Il fallait une solution pour être sûr de savoir dans quelles rangées on a déjà travaillé, et inversement ». Depuis 2013, tous les développements de produits sont accessibles sur commande depuis le site internet Top-Pulvé de la chambre d’agriculture du Gard. « La Chambre m’a toujours laissé la possibilité d’être créatif. C’est grâce à cette ouverture qu’aujourd’hui on a des papiers hydrosensibles les moins chers, qu’on a Top’incorpo, un mélangeur et incorporateur de bouillie que j’ai développé en 2009, à la suite d’une remarque de mon frère sur la hauteur des outils et le risque à utiliser des échelles. L'enjeu pour l'agriculture aujourd'hui, c'est de produire mieux avec moins de produits. Cela ne sera possible qu'avec une pulvérisation irréprochable, en conventionnel comme en biologique. Toute ma carrière, je me suis efforcé de trouver des solutions techniques efficaces, accessibles financièrement pour les agriculteurs et compatibles avec les attentes sociétales et environnementales ».
A l’avenir, Renaud Cavalier veut défricher encore d’autres domaines. Outils connectés, hybridation désherbage mécanique et chimique, pulvé ZNT moins coûteuse, pulvé anti-dérive proche de la végétation sont pour lui autant de terrains de recherche. Mais celui qui le tient particulièrement à cœur c’est le « tracteur tonneau ». « Je vois encore trop de monde l’été, des conducteurs en tracteur sur la route, qui roulent à fond avec l’arceau de sécurité en bas. Ça me fait trembler. Ils n’ont pas conscience du danger. Je veux montrer l’intérêt de porter une ceinture, grâce à un tracteur tonneau sur remorque, avec arceau ».
Courtisé ailleurs par des constructeurs, l’enfant du pays est resté fidèle à son département et à sa chambre d’agriculture. « Je suis appelé sur des démonstrations dans le Var, en Corse, dans le Vaucluse, etc. Je rencontre des viticulteurs de toute la France et je suis heureux de promouvoir le département gardois, de montrer qu’en Chambre, il y a des gens qui ne comptent pas leurs heures. Ça existe encore les passionnés ! »



Marion Claverie croit beaucoup dans la force du collectif. Arrivée à l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV) en 2002, l’ingénieure de 44 ans, dirige aujourd’hui plusieurs programmes de recherche dans le cadre du plan national du dépérissement du vignoble. Des programmes qui impliquent différents partenaires et nécessitent d’avoir une approche globale, car les dépérissements de la vigne ont des origines multifactorielles. La spécialiste qui exerce au sein du pôle Rhône-Méditerranée, coordonne ainsi le projet Longvi qui vise à développer une méthode pour diagnostiquer et hiérarchiser les causes des bas rendements à l’hectare. Elle pilote aussi le programme Jasympt afin de trouver des solutions pour retarder les contaminations par le court-noué et en atténuer les symptômes. Elle porte le projet Bourgeons, dont l’objectif est de voir si l’ébourgeonnage permet de limiter les symptômes des maladies du bois. Plus récemment, elle a pris la responsabilité du programme Dep-grenache qui vise à appréhender les causes du dépérissement du Grenache noir en région méditerranéenne…Des thématiques au cœur des préoccupations des vignerons. Leur être utile c’est d’ailleurs ce qui stimule Marion Claverie. Monter des projets de A à Z, travailler en réseau et partager les résultats sont aussi pour elle très motivant. « Mutualiser les efforts, ça paye ». Et les premiers résultats sont là…



Matthieu Dubernet à la tête des laboratoires Dubernet, groupe familial installé en Languedoc-Roussillon a un credo : « il faut accompagner le vin et ceux qui le font avec un fil conducteur : la liberté et l’indépendance qui garantissent le rôle scientifique et technique d’un laboratoire comme le nôtre. » Pris dans la tempête médiatique suite à la réalisation des dosages de trace de pesticides pour le compte de l’association Alerte aux toxiques, le laboratoire a su poser et défendre son rôle d’expertise, d’indépendance et de rigueur dans cette affaire.
Mais au-delà des débats qui en ont découlé, le laboratoire est surtout un acteur majeur de la montée en gamme des vins du Languedoc, de leur valorisation et au final de la réussite qu’ils connaissent depuis quelques années. Il se prépare déjà aux défis de demain. « On se rend compte que l’on a besoin de repenser les vins languedociens pour qu’ils soient plus personnalisés, singularisés et qu’ils développent davantage de fraîcheur et de subtilité » commente Matthieu Dubernet.
Ce dernier est également convaincu de l’importance du travail au vignoble, ce qu’il appelle « l’agro-œnologie » qui passe par une meilleure connaissance de la nutrition de la vigne (analyses pétiolaires) et du sol avec notamment un travail innovant pour connaitre la vie du sol, indicateur essentiel de la fertilité du sol. Et sans doute l’un des défis majeurs de la viticulture méditerranéenne dans les dix prochaines années.
Matthieu Dubernet construit une œnologie globale au sein de laquelle l’agronomie est déterminante.



Au terme de vingt ans de réflexions, Jean-Baptiste Duquesne passe à l’action avec une ambition forte : créer une marque cohérente dans le fond et la forme pour participer à la relance de l’attractivité du vignoble bordelais. Ayant repris le château Cazebonne (40 hectares dans les Graves, certifié bio en 2020), cet ancien négociant de la place de Bordeaux (avec une spécialisation dans les vins internationaux) et ancien entrepreneur à succès du numérique (il lance le site de référence pour les recettes de cuisine 750g.com après l’échec de son site de vente en ligne 75cl.com) tire de toutes ses expériences une analyse sans concession des forces et faiblesses des vins girondins.
Jean-Baptiste Duquesne critique ainsi la culture bordelaise des grands vins de garde (poussant les consommateurs à constituer un stock et à ne plus acheter de Bordeaux), des cuvées sous marque unique (un château décliné en premier et second vin, avec l’assemblage lissant la diversité des terroirs), des cépages bordelais indéboulonnables (merlot et cabernet sauvignon notamment, loin de la diversité ampélographique passée)… Prônant des vins à boire en toute occasion, le vigneron adopte une logique bourguignonne avec 11 références à date (de l’entrée de gamme aux cuvées parcellaires) et déploie un conservatoire d’anciens cépages (26 variétés plantées).
Si Jean-Baptiste Duquesne défend le potentiel vigneron de Bordeaux, il regrette l’omniprésence d’intermédiaires, notamment du négoce, empêchant les producteurs d’avoir une vision des réalités du marché et de pouvoir prendre des décisions innovantes. D’où le lancement du mouvement Bordeaux Pirates, un « coup de gueule » pour fédérer un mouvement de vignerons « aux vins authentiques au rapport qualité/prix en adéquation » explique Jean-Baptiste Duquesne, qui assume la provocation, mais pas l’opposition. « C’est un pavé dans la mare. Mais si on s’appellait Bordeaux Renouveau ou Bordeaux Modestes, ça n’interpellerait pas » explique-t-il, balayant toute solution individualiste : « la solution de Bordeaux est dans le collectif ».
Jean-Baptiste Duquesne a été plébiscité par les lecteurs de Vitisphere lors de l’appel à candidature de novembre 2020.






En 1999, Marie Gaudel créait l’agence Clair de Lune spécialisée dans le vin, la gastronomie et l’oenotourisme, après un passage au service de presse de l'interprofession des vins d’appellation des Côtes du Rhône et de la Vallée du Rhône (Inter Rhône). Depuis, elle a hissé son agence au premier rang de son secteur, collectionnant les clients. Sa simplicité et sa créativité font des étincelles.
Malgré une année 2020 des plus compliquées pour son agence, dont une grande part de l’activité consiste à inventer, à organiser ou à faire connaitre des événements, elle n’a pas baissé les bras.
Mi-décembre, elle était à Tain l’Hermitage, avec le syndicat de Crozes-Hermitage, l’un de ses premiers clients pour préparer deux événements : une manifestation artistique pour soutenir les restaurateurs lyonnais entre Noël et Nouvel An et le premier marché du vin de Tain l’Hermitage, en avril cette année, pour le grand public, espérant bien que ce serait le premier salon post-Covid autorisé se tenir. « On me demande de créer des événements virtuels, explique-t-elle. Mais je me dis qu’on perd l’essence de ce que c’est le vin : la rencontre, le partage ».
Toujours en 2020, son agence a imaginé une opération originale pour l’AOC Grignan-les-Adhémar, proposant à des concepts stores de dresser la table idéale pour mettre en valeur les vins de cette appellation. Cette initiative se poursuit cette année où ces concept stores ouvriront des corners dans des caveaux de vignerons pour y exposer leur offre.
A 54 ans, Marie Gaudel pense déjà à assurer l’avenir de son agence. En 2020, elle a associé deux de ses salariées à son capital : Amélie Blumat et Anaïs Marchand après y avoir déjà associé Cécile Luquet.



« On ne fait bien que ce que l’on aime » estime Caroline Frey, la directrice de Paul Jaboulet Aîné (Vallée du Rhône), du château la Lagune (grand cru classé en 1855 du Médoc), du château Corton (Bourgogne) et du Jardin Secret (Suisse). Sans stratégie de communication, l’œnologue partage naturellement sa passion de la photographie sur les réseaux sociaux. Avec 21 500 abonnés sur la plateforme Instagram, « la mayonnaise a bien pris » reconnaît Caroline Frey, qui se réjouit d’avoir réussi à créer une véritable communauté autour de ses projets vitivnicoles.
Ses photos permettent de suivre les pratiques de la biodynamie, démystifiant en montrant le quotidien. « Il y a encore plein de choses à faire. On continue les essais » souligne-t-elle, esquissant les enjeux de relargage du carbone avec des labour trop profonds. En 2021, le château La Lagune sera certifié en biodynamie, la certification est en cours pour Paul Jaboulet Aîné et le château Corton. « La démarche est très évolutive : la progression continue fait partie intégrante de la pensée biodynamie, qui n’est pas figée. Nous devons aujourd’hui produire de grands vins tout en pensant à la pérennité de nos vignobles et des terres alentours » explique Caroline Frey.
Née au milieu des vignes de la montagne de Reims en Champagne (elle précise n’aller que pour le plaisir visiter la maison familiale Billecart Salmon), Caroline Frey aimerait désormais proposer un déjeuner au château la Lagune pour les membres les plus actifs de sa communauté : « des personnes fidèles, même si je ne connais pas toujours leurs vrais noms » conclut-elle.



Ses essais ? David Lafond pourrait vous en parler pendant des heures. Cet ingénieur au pôle Val de Loire de l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV) teste des systèmes de culture très disruptifs. Sa vision ? Avec le mode de conduite actuel de la vigne, les marges de manœuvre pour réduire le recours aux produits phytosanitaires sont très limitées, les viticulteurs ayant déjà fait beaucoup d’efforts. Il faut donc un système de conduite en rupture. Et raisonner à l’échelle d’un territoire. « En arrivant à des paysages plus diversifiés, on va baisser la pression des bioagresseurs et donc les traitements » explique-t-il. Exit donc la monoculture. Place aux arbres de différentes essences, aux haies, aux couverts végétaux variés… en association avec les vignes. Des principes que l’ingénieur éprouve à Montreuil-Bellay, dans le cadre du programme Diverviti.
David Lafond, 42 ans travaille depuis douze ans à l’IFV. Mais c’est dans la production qu’il a démarré sa carrière. « J’avais toujours la tête dans le guidon et n’avais pas le temps de réfléchir à l’amélioration des pratiques » explique-t-il. Or ce qui l’intéresse, c’est d’avoir une vision à moyen et long terme de la viticulture. Il rejoint donc l’IFV où il commence par travailler sur la réduction des produits phytosanitaires, notamment via la modélisation. Puis il passe aux approches systèmes. David Lafond est conscient que de tels changements ne peuvent pas se faire du jour au lendemain. Pour autant, il n’a pas peur de se projeter… Et de tester la vigne du futur.


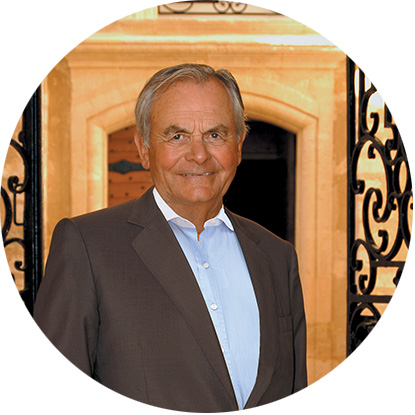
Loin de ralentir, on dirait qu’il accélère. A 84 ans, Bernard Magrez fait preuve d’une curiosité intacte envers les progrès de la science et des nouvelles technologies. En 2020, il a créé un incubateur de startups au château Le Sartre à Léognan, propriété qu’il a acquise en 2017, puis rénovée pour y accueillir une cinquantaine de ces jeunes pousses. « Il y a tout ce qu’il faut pour ceux qui veulent travailler tard la nuit » explique-t-il.
En fin d’année, Bernard Magrez a dévoilé la liste des premières dix entreprises sélectionnées pour entrer dans son incubateur. Pourquoi un tel investissement ? Parce qu’il estime qu’il est de la mission des entreprises d’en aider d’autres à réussir. Par intérêt aussi. Il veut être le premier, « pas le deuxième ni le troisième », à repérer les technologies grâce auxquelles il restera rester leader dans le monde du vin, un secteur où il juge la compétition internationale « colossale ».
Dans le même esprit, en 2017, il a créé le pôle scientifique Bernard Magrez. « Nous y menons 42 recherches différentes. Grâce à cela, nos collaborateurs font des progrès. Ils trouvent toujours un élément nouveau qui les intéresse, les passionne » explique-t-il. Au menu : drones, tracteurs électriques, robots, barriques connectées pour suivre la consume... Qu’est-ce que l’épate le plus ? La capacité des drones à détecter des attaques de mildiou avant l’apparition des taches. « Je suis tellement étonné du travail qui peut se faire. Dans trois ans, on analysera la couleur des grappes sous le feuillage pour savoir si elles sont mûres » prévoit-il.
Pas surprenant qu’il n’ait pas l’intention de ralentir.



Directeur Vignoble et Approvisionnement de Moët & Chandon (groupe MHCS), Vincent Malherbe fait partie des voix qui comptent en Champagne. Œnologue diplômé de la faculté de Reims, il exhorte la Champagne, mais aussi la viticulture française à expérimenter et à innover. Au printemps 2020, il publie un édito remarqué dans la revue Partenaires, envoyée à tous les viticulteurs qui livrent des raisins à Moët & Chandon. Puis il détaille ses pistes de changement dans une interview publiée début juillet dans Vitisphere.
Son crédo ? Que chaque viticulteur et que chaque négociant puisse tester de nouvelles techniques sur 2 à 3 % de son vignoble, sans inclure ces raisins dans l’AOC, mais en conservant la même déclaration de récolte. Cela supposerait une autorisation dans le cahier des charges de l’AOC Champagne. Pas gagné, doit-il penser en substance, lui qui regrette qu’en France, « nous sommes soumis à des autorisations de multiples administrations. Et il y en a toujours une qui refusera l’essai ». Pendant que nos concurrents, eux, expérimentent.
Il aimerait tester des cépages résistants italiens, mais aussi des cépages blancs méridionaux dont la maturation est plus lente. A plus court terme, c’est le dossier des vignes semi-larges (VSL) qu’il voudrait faire avancer. « Cela fait vingt ans que nous cultivons des VSL sur plusieurs sites, en relation avec l’interprofession. Les vins issus de ces vignes ne présentent pas de différence gustative. Ce mode de conduite nous permettrait de diminuer significativement nos coûts ». Une modification du cahier des charges autorisant les VSL devrait être rapidement proposée aux vignerons. Maxime Toubart, le président du syndicat général des vignerons, y est favorable.
Pour centraliser les résultats des expérimentations menées sur tous les continents, le groupe MHCS finalise son centre de recherche mondial qui sera implanté à Oiry, près d’Epernay. De quoi nourrir les échanges sur d’autres thèmes sensibles en Champagne, comme celui des essais de machine à vendanger…



Trouver des solutions. Tel est le leitmotiv d’Estelle de Pins. A la tête de sa société Alliandre depuis 2010, cette consultante dynamique conseille les domaines viticoles sur leur stratégie commerciale et leur relation client, notamment pour l’accueil au domaine et l’oenotourisme. « Cela me semble logique que la filière vin porte l’information directement à ses consommateurs. J’apprécie tout particulièrement la relation privilégiée que j’ai avec mes 65 clients » constate Estelle de Pins, auparavant à un poste financier dans le secteur viticole. Et elle ne manque pas d’idée !
« En 2012, j’ai créé un logiciel, GDO.wine, qui permet de gérer plus simplement ses relations clients en centralisant l’emailing, le planning des visites, l’historique des ventes et celles en cours. Avec mes équipes, nous l’améliorons d’année en année. On peut maintenant gérer plusieurs e-boutiques grâce à lui » explique la dirigeante.
Récemment, Estelle de Pins a aussi mis en ligne une plateforme collective, Wine Tour Booking, pour structurer les informations oenotouristiques des domaines sur des sites annexes, comme le Figaro Vin. « Tout le monde a déjà vécu le casse-tête d’organiser des visites pendant ses week-ends ou vacances. Mon but est d’atteindre aussi les syndicats d’appellation pour améliorer leur visibilité et surtout simplifier les prises de rendez-vous dans les domaines de leur appellation » explique-t-elle.
Sur son temps libre, elle est aussi une lady du vin. « J’ai co-créé l’association Ladies Wine il y a 4 ans pour aider les femmes de la filière vin à entrer en réseau » poursuit-elle. Ladies Wine compte aujourd’hui 60 adhérents à Bordeaux et en Provence. Estelle de Pins a été plébiscitée par les lecteurs de Vitisphere lors de l’appel à candidature de novembre 2020.



Bas normand, Matthieu Potin désirait d’abord devenir sommelier ou maître d’hôtel d’un restaurant gastronomique. Diplômé du lycée hôtelier d’Avranches, dans la Manche, il rejoint ainsi un restaurant gastronomique à Paris comme chef de rang, avant qu’un collègue ne lui indique en 2008 qu’un caviste voisin cherchait un vendeur. Rejoignant la franchise la Vignery à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, Matthieu Potin n’a pas manqué depuis une épreuve du concours bisannuel du meilleur caviste, relancé en 2014 par le Syndicat des Cavistes Professionnels (SCP). Butant jusqu’à présent sur les épreuves de présélection (et leurs « connaissances théoriques barbantes »), le caviste a remporté le titre en 2020, son dauphin n’étant autre que son second, Julien Lepage, qu’il a embauché en 2018 à la Vignery de Saint-Germain-en-Laye.
Auréolé de son titre, Matthieu Potin aura tiré parti d’une année aussi perturbé que porteuse pour les commerces de proximité. Resté ouvert pendant le premier confinement (à l’exception d’une dizaine de jours suite à une maladie ressemblant à la Covid-19), sa cave a connu une activité record au déconfinement : « en mai, c’était comme le 24 décembre tous les jours ! Nous avons eu deux grosses périodes d’activité en 2020, le déconfinement et les fêtes de fin d’année. C’est une année commerciale record » résume Matthieu Potin. Les Cafés, Hôtels et Restaurants restant fermés administrativement pour cause de crise sanitaire, le caviste était au rendez-vous. « A part le rayon des champagnes, touché par l’absence d’esprit festif, le reste de nos fournisseurs ont très bien fonctionné » souligne Matthieu Potin, qui estime que « des habitudes resteront. Comme les commandes en ligne avec un retrait en boutique et souvent des achats complémentaires. »



« C’est la journée des bonnes nouvelles. Le blanc doux et le rouge de ma gamme Rebel viennent d’être médaillés au concours Piwi » annonce Mickael Raynal lorsque nous lui apprenons qu’il fait partie du Top 20 du vin 2020. L’an passé, le vigneron a été le premier en France à lancer une gamme de vins à Indication Géographique Protégée (IGP) issue de cépages résistants. « La diversité me passionne » explique-t-il.
Il cultive en effet 32 variétés sur les 14 hectares du domaine de Revel en dernière année de conversion bio. 11 sont des cépages résistants, les autres sont des cépages oubliés ou adaptés au réchauffement climatique. Sa cuvée d’egiodola ravit le consommateur en quête de vins à petit degré, fruités et légers. Son nouvel assemblage de jurançon et d’alicante devrait en faire autant. Son rosé de muscat de Hambourg vendangé tardivement est tout aussi original, « entre un cabernet d’Anjou et un gewurztraminer alsacien ». Mickael Raynal a surgreffé du mauzac à gros grain sur son chardonnay. Trop classique, le sauvignon est voué à la même destinée.
En février, le vigneron ouvrira ses portes à tous ceux qui souhaitent découvrir ses cépages rares. « Je les ai vinifiés séparément et les ai filtrés. On pourra s’amuser à tester plusieurs assemblages ». Le vigneron attend désormais avec impatience l’arrivée des variétés ResDur3 résistantes au black-rot.



Laetitia Sicaud formule un vœu : que les viticulteurs prennent tous conscience « que la prospection flavescence dorée est un travail tout aussi important que la taille de la vigne ». Chargée de mission au BNIC (Bureau national interprofessionnel du Cognac), Laetitia Sicaud anime le groupe technique régional « flavescence dorée ». L’objectif de cette structure créée en 2012 ? Organiser la lutte contre la flavescence dorée dans tout le Bassin viticole Charentes-Cognac.
Aller sur le terrain, être au contact des viticulteurs et chercher des solutions innovantes : c’est ce qui motive Laetitia Sicaud dans son travail au quotidien. La flavescence dorée n’a aucun secret pour elle. La technicienne œuvre à la lutte contre cette maladie depuis 2008, année où elle a démarré sa carrière à la chambre d’agriculture de Charente-Maritime. Elle y restera jusqu’en 2011. Elle rejoint ensuite la Fédération Régionale de Lutte Contre les Organismes Nuisibles (Fredon Poitou-Charentes), puis le BNIC en 2015. Dynamique, elle déploie toute son énergie à la mobilisation des professionnels et au développement de solutions pour leur faciliter le travail de prospection et réduire les traitements insecticides. Dernièrement, elle a mis au point avec la société Advansee un piège connecté pour suivre les populations de cicadelles. Il est en cours de test sur la commune de Triac-Lautrait. Elle travaille également sur les prospections par drones et la proxi-détection avec des capteurs embarqués.



« Ne plus construire nos chais comme les 50 dernières années, mais pour les 50 prochaines ». C’est le but premier de Roland Tournier, œnologue et PDG du bureau d’études d’ingénierie vinicole Ingévin, spécialisé dans la construction de chais. En 2020, en pleine crise sanitaire, Roland Tournier et son équipe ont sorti de terre deux chais innovants : le chai circulaire à Marseillan dans l’Hérault et le chai Eode à Bonnieux dans le Lubéron. Deux réalisations qui répondent en grande partie aux défis du PDG. « Simplifier la chaine d’élaboration tout en respectant la qualité des vins, améliorer l’ergonomie des chais pour des meilleures conditions de travail et réduire l’impact environnemental de nos constructions et de la filière » énumère-t-il.
Depuis 1980, il est au cœur de la production vinicole. « J’ai commencé en tant qu’œnologue chez Imeca Œnologie à Clermont l’Hérault. Ce premier emploi et ma rencontre avec l’œnologue Claude Humbert ont dicté toute la suite de ma carrière. Il m’a transmis sa volonté d’établir une œnologie préventive au lieu d’une œnologie curative » constate Roland Tournier. Travaillant ensuite à titre indépendant, puis pour un tonnelier et enfin chez Air Liquide, il décide de créer son cabinet d’études en 1998, guidé par son plaisir de concevoir, organiser et agencer le travail en cave. « J’ai eu le recul nécessaire dès 1998, en voyant la filière se générer elle-même des problèmes. Chaque technologie venait résoudre le problème d’une innovation précédente, en transformant les chais en usines à gaz. Résultats ? Les chais étaient de plus en plus grands, plus hauts, avec des problèmes de trituration de la vendange, de libérations de bourbes, de gestion des températures etc. ».
Aujourd’hui, le PDG d’Ingévin s’éloigne de l’opérationnel. « J’ai la chance d’avoir une équipe performante et complète avec des expertises complémentaires. Cela me permet de passer plus de temps à concevoir nos futurs chais, certainement disruptifs, puisque je pense que dans un avenir très proche ils seront préfabriqués et conçus en usine pour être montés sur site » laisse planer Roland Tournier.



Elle travaillait dans la fonction publique en Charente-Maritime, lui était chef de culture. Il y a bientôt 20 ans, Delphine et Benoît tombent sous le charme de 8 hectares de coteaux vierges, à Lapouyade, en Gironde. Le couple s’y installe pour y créer un vignoble conduit de manière écologique avec du « bon sens paysan ». Loin des codes bordelais, les nouveaux vignerons plantent 6 600 pieds/hectare de merlot taillé en cordon de Royat et tressé, des haies, et quelques arbres fruitiers. La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), le Groupe Chiroptères, Arbres et Paysages 33 et l’Office Insectes Environnement les accompagnent.
Benoît Vinet troque le labour contre l’enherbement naturel et les semis de couverts. Il tond très peu l’inter-rang, « pour avoir un maximum de fleurs et de graines qui alimentent la faune ». Le domaine Emile Grelier devient un laboratoire pour l’agroforesterie et la biodiversité quand il accueille à partir de 2014 les scientifiques des projets Vitiforest et Vitichiro. Il abrite aujourd’hui 570 arbres, 6 mares, 50 nichoirs, 15 plaques à serpents, 7 cabanes à hérissons, 10 gîtes à chauve-souris et 4 hôtels à insectes. Le centre d’études spatiales de la biosphère de Toulouse étudie ses microclimats.
Benoît et Delphine espèrent réussir à atténuer les effets du réchauffement climatique pour continuer à cultiver le merlot dont la cuvée très appréciée par les journalistes a trouvé son public. Les Vinet ne reçoivent pas que des scientifiques. Tous les étés, ils proposent un parcours pédagogique au grand public. Les scolaires découvrent leur domaine lors de chantiers nature, et de nombreux étudiants viennent y faire leur stage de BTS ou de DNO.
Fort de son expérience, le couple se lance désormais dans la prestation de conseils en agroforesterie.





