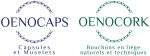lors qu’une diminution des rendements n’avait pas pu aboutir en 2022 et qu’elle était actée en 2023, elle est prolongée en 2024 : est-ce un outil incontournable ?
Damien Gilles : Nous reconduisons les 41 hl/ha pour 2024 en vins rouges et rosés, avec toujours 51 hl/ha pour les blancs. L’acceptation était plus importante pour notre conseil d’administration par rapport aux autres années. C’est une acceptation de la réalité de notre économie et de l’utilité de réguler encore une dernière fois notre rendement avant l’arrachage qui viendrait restructurer notre production. Que l’on ne produise pas pour produire.
Je ne vous le cache pas, cette décision vient aussi s’appuyer sur la réalité sanitaire de notre vignoble. Sur la réduction à 41 hl/ha, il est majoritairement question d’économie, mais il est aussi question du mildiou et de cette situation sanitaire qui s’est fortement dégradée ces dernières semaines. Et qui nous laisse un feuillage assez criblé, il n’y a aucune visibilité sur la récolte que l’on va pouvoir faire. Depuis une semaine le temps a l’air de se lever et on rentre dans la véraison depuis quelques jours, la période la plus importante avant les vendanges.
Cette réduction du rendement a-t-elle pour objectif le rétablissement de l’équilibre entre offre et demande pour arriver à une remontée des cours ?
Depuis la sortie du covid, on n’a jamais été aussi près d’un équilibre entre notre production et notre commercialisation. Aujourd’hui, nous avons enregistré plus de ventes de vins par rapport à l’année dernière sur la campagne en vrac. Tous millésimes confondus, nous étions à 740 000 hl à la semaine 28, contre 720 000 hl l’an passé. Nous sommes en légère augmentation des contractualisations. Nous restons toujours en léger retrait sur les sorties de chais (-5 %).
Nous sommes dans une situation où l’on a quasiment retrouvé nos équilibres. L’an dernier, la baisse des rendements et la campagne de distillation (180 000 hl en côtes-du-Rhône, à 90 % en rouge) ont permis de réduire de plus de moitié le volume libre disponible à la vente (calculé sur les trois derniers millésimes à la vente). En 2023, nous étions à 500 000 hl à cette date sur les trois couleurs (avec 400 000 hl de rouge), aujourd’hui nous sommes à 250 000 hl sur les trois couleurs (le rouge pèse pour 200 000 hl). Notre situation est vraiment différente par rapport à l’année dernière. On a une orientation en termes de production qui commence à se rapprocher de nos commercialisations. Dans ce marathon, on ne pouvait pas se saboter sur le sprint final. Nous ne pouvions pas être encore une fois être malheureusement en surproduction. Nous avons voulu faire un dernier effort pour retrouver bien évidemment notre équilibre et évidemment notre valorisation. Un dernier effort avant une réorientation complète et structurelle de notre production, avec les mesures attendues d’arrachage.
La baisse des rendements est perçue par certains opérateurs comme étant injuste, pénalisant la production de ceux qui s’en sortent commercialement, pourquoi l’outil de réserve interprofessionnelle ne suffit-il pas ?
L’outil interprofessionnel de régulation de marché que j’ai porté est en place dès cette année après avoir été validé il y a deux mois en assemblée générale extraordinaire. Il a été créé de toute pièce et sur mesure pour notre AOC en se basant sur les moyennes de commercialisation des trois années pour les vins rouges de Côtes-du-Rhône (jusqu’aux AOC Villages nommés). Si les volumes au-dessus de la capacité de commercialisation ne sont pas vendus au bout de 12 mois pour les appellations générique/Villages et de 18 mois pour les appellations Villages nommés, ils sont automatiquement mis en vins sans IG ou distillés à charge zéro pour l’opérateur). Cet outil n’a que des qualités, mais son problème est d’avoir comme base de références les trois dernières années. Comme nous gérons de la décroissance perpétuelle, on n’a pas une efficacité redoutable à 41 hl/ha. Dans une année, l’outil sera plus efficace et nous n’aurons plus à jouer avec le rendement.
Vous évoquiez le besoin d’arrachage, mais duquel parlez-vous : celui définitif ou celui temporaire ?
Il n’y a aujourd’hui pas de débat sur la nécessité d’arrachage définitif. Nous sommes moteurs depuis le début de ce type d’arrachage. Moins structurel, l’arrachage différé est nécessaire pour se donner du temps de perception de notre nouveau marché (nouveaux critères d’acceptation du vin par les consommateurs…). L’arrachage temporaire permettrait de meilleures réflexions pour donner des idées d’évolution de l’AOC afin de se rééquilibrer dans le long terme.
Avez-vous un chiffrage des besoins rhodaniens d’arrachage ?
L’enquête de FranceAgriMer a été peu concluante par manque de réponses. Des personnes n’ont pas participé par manque d’habitude de l’outil informatique, parce que l’année est compliquée et, surtout, on ne connaît pas les règles du jeu. Les gens n’étaient pas persuadés que les règles n’allaient pas changer à nouveau. Il y a des questions sur l’enjeu du fermage, de la déclaration de récolte, des couleurs, des tranches d’âge… Quand on n’a pas toutes les règles du jeu, il est compliqué de se prononcer.
Tout juste lancée, l’Association Générale de la Production Viticole de la Vallée du Rhône (AGPV Rhône) doit-elle porter l’impatience sur l’arrachage et les prix rémunérateurs d’Egalim pour les faire avancer rapidement dans le contexte politique actuellement incertain ?
Exactement. La particularité de notre Organisation de Défense et de Gestion (ODG) est de s’étendre sur 6 départements et 3 régions administratives. Il est difficile d’être partout et d’entendre tout le monde. L’AGPV Rhône invite à participer les mêmes représentants que ceux de l’AGPV nationale, avec une entorse, l’invitation des chambres d’agriculture pour une vision transversale.
Lors des manifestations du début d’année, j’étais moi-même mobilisé sur un barrage, nous avions tous signé une lettre de doléance qui a ouvert la porte des discussions d’Egalim. Quand arrive dans un ministère un papier avec 50 signatures d’organisations pour la deuxième AOC de France, ça a du poids. Si cela ne tenait qu’à la production, Egalim 4 serait déjà là. J’ai bon espoir que pour les vendanges 2024 que l’on ait la mécanique [de prix rémunérateur]. Tout n’est pas calé, mais il y a la volonté de la production et maintenant du négoce, qui n’est pas fermé à cette mécanique.
Nous travaillons en concertation avec Bordeaux sur Egalim, nous plutôt sur les indicateurs des prix de production, eux plutôt sur les Organisations de Producteurs. Quand on fait la synthèse de ces derniers travaux et qu’on la met dans la machine Egalim : ça tourne. L’absence de gouvernement ralentit actuellement la mécanique, mais l’administration continue de travailler avec nous, comme elle n’a pas reçu de contrordre. On découvre même des mécaniques européennes de construction des prix rémunérateurs. Je suis confiant dans la mise en place dès 2024 d’une telle mécanique.
Vous espérez que dès le millésime 2024 il n’y ait plus de prix indécents ?
Je ne sais pas comment vont fonctionner l’administration et le gouvernement, mais cette mécanique doit passer par un observatoire et comme Bordeaux et les Côtes-du-Rhône sont à l’origine de la demande, il est possible que nous servions de starter. Nous avons bien avancé, nous sommes quasiment à la rédaction d’un accord entre négoce et production. Si l’administration fait le job et que le gouvernement valide, on peut espérer que la mécanique soit en place dès la fin d’année.
Quand vous évoquez un accord entre production et négoce, est-ce au niveau national ou régional ?
Au niveau interprofessionnel, il n’est pas question d’imposer Egalim à toutes les appellations. Chaque interprofession peut dire si elle accepte Egalim ou pas. Il ne s’agit pas d’accord au niveau des prix avec une interprofession qui dit qu’il ne peut pas y avoir de transaction en dessous du prix X. Mais de justifier ce prix X. Notre observatoire se trouve dans l’interprofession (Inter Rhône), on connaît le coût de production du raisin en Côtes-du-Rhône, on va affiner les chiffres en fonction du rendement, etc. Et chacun pourra construire son prix à partir de cet observatoire.
Les délais pour Egalim 4 et l’arrachage s’allongeant, la grogne reste forte dans le vignoble. Pensez-vous que l’on verra de nouvelles tensions et manifestations dès la fin des prochaines vendanges ?
La problématique actuelle, c’est que la première manifestation n’a pas donné les résultats escomptés. On attend toujours de nombreuses réponses, par exemple sur Egalim. La dégradation du prix du marché cette année laisse les gens avec une rancœur importante. Le millésime compliqué que nous vivons laisse les gens à bout financièrement. Mais aussi à bout de nerfs. La période d’octobre-novembre, de pré-marché pour nous, va être électrique, c’est certain. Maintenant, je suis sûr que les metteurs en marché le savent aussi bien que vous et moi, et vont faire le nécessaire pour qu’il n’y ait pas autant d’électricité que si cela ne devait pas se passer de la bonne manière. Après les vendanges, quand tout le monde sera soulagé d’avoir rentré ce millésime compliqué, il serait possible que certaines propositions de prix mettent le feu aux poudres.
Héritage des manifestations de février-mars, la Fédération des Caves Coopératives du Vaucluse poursuit une grève administrative illimitée. Qu’en pensez-vous, est-ce une initiative à soutenir par l’ODG ?
En tant que coopérateur, je trouve l’idée inédite, intéressante et innovante. C’est une manifestation pacifique qui ne demande pas de temps aux producteurs et montre le ras-le-bol général de la profession. Je salue cette initiative et je ne peux qu’encourager à la multiplication de cette manifestation, avec son clonage dans d’autres départements et dans la France entière.
Avec le mildiou que vous avez évoqué, ce millésime est marqué par des excès d’eau et une forte pression sanitaire : est-ce que cela amène à envisager de nouveaux cépages résistants ?
Depuis mon installation, il y a 15 ans, je m’étais plus inscrit dans le manque d’eau. Aujourd’hui, on n’est pas dans le manque ou le trop d’eau, mais dans l’excès, dans un sens ou dans l’autre.
Nous avons fait rentrer 4 Variétés d’Intérêt à Fin d’Adaptation (VIFA), 2 cépages blancs plus tardifs pour le changement climatique et 2 cépages résistants (un blanc et un rouge) pour faire évoluer les pratiques phytos (et garder nos terroirs au plus près des habitations). Les VIFA seront étudiés par l’Institut Rhodanien : c’est acté et validé. Dès la fin des vendanges, nous allons prendre le temps de nous pencher sur toutes les évolutions nécessaires de notre cahier des charges.
Parmi ces évolutions, la désalcoolication est-elle à l’ordre du jour ?
Bien sûr, c’était déjà dans ma feuille de route. Nous ne voulons avoir aucun regret dans 10 à 15 ans. Il ne faut rien s’interdire et explorer toutes les pistes sur lesquelles on nous attend. Nous sommes capables de produire des vins puissants et élégants avec notre cépage et notre climat. Nous pouvons être attendus sur des vins plus fruités et moins alcooleux. Nous avons une telle diversité de producteurs et de vinificateurs que l’on peut répondre sans problème à tous les besoins d’adaptation.