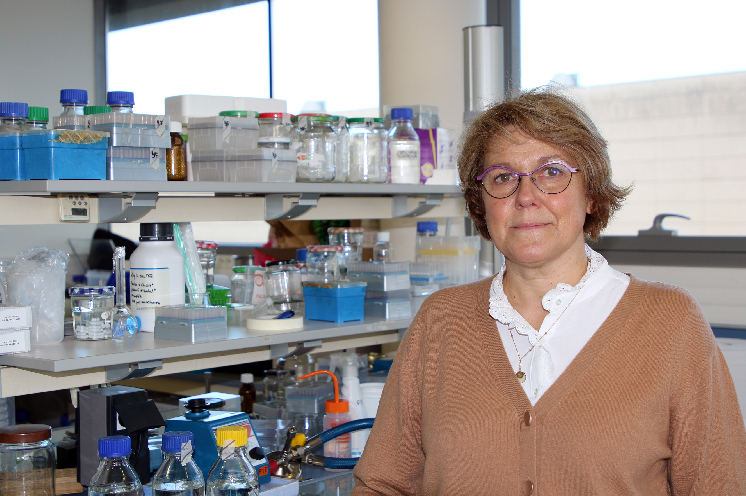uel impact du changement climatique et des pratiques œnologiques sur la flore microbienne présente à la surface des baies ? Et sur celle à l’œuvre lors des fermentations alcooliques et malolactiques spontanées ? Comment ces flores évoluent-elles selon les millésimes ? Autant de questions auxquelles l’Observatoire de la biodiversité des micro-organismes œnologiques créé en 2023 à Bordeaux va devoir répondre.
Isabelle Masneuf-Pomarede, coordinatrice scientifique du projet et professeure d’œnologie à Bordeaux Sciences Agro explique : « Une dizaine châteaux Bordelais se sont engagés à nous fournir, pendant trois ans, des échantillons de moûts de raisins prélevés au moment de la vendange pour étudier la flore à la surface des baies puis des moûts au cours de fermentation alcoolique et malolactique spontanée en cuve. »
Ainsi en 2023, sur 87 échantillons de moûts de raisin issus de 29 parcelles, seulement 33 % contenaient des Saccharomyces cerevisiae, 23% des Oenococcus oeni et à peine 3% des Brett.
Pour Isabelle Masneuf-Pomarede et Marina Bely, maitre de conférence en microbiologie du vin, ces premiers résultats confirment ce que l’on savait déjà. « Les espèces fermentaires sont peu présentes sur les raisins à la récolte et les Brett encore moins. En termes de dénombrement, nous avons obtenu sur cépage rouge en moyenne, 7,5x105 UFC /mL de moût, de levures totales, et 1 à 4x104 de bactéries. Conclusion, les levures à la surface des baies à maturité sont plus nombreuses que les bactéries », expliquent-elles. Autre conclusion : la plupart des fermentation spontanées sont l’œuvre des levures qui persistent dans les chais. Les contaminations par Brett également.
Sans surprise, Saccharomyces cerevisiae mène le bal durant les fermentations alcooliques. Cette espère représente 84 % des populations retrouvées à ce stade. « Nous avons identifié plus d’une centaine de profils génétiques différents. Dans certains cas, la fermentation alcoolique s’est déroulée avec une souche dominante, mais dans d’autres, elles sont plusieurs. Pour le moment, on ne sait pas expliquer ces différences. Le lien avec les pratiques œnologiques reste à faire », souligne Isabelle Masneuf-Pomarede.
Hanseniaspora uvarum et Torulaspora delbrueckii ont également été identifiées. Or ces levures peuvent produire de l’acide acétique ou provoquer des fermentations languissantes. D’où l’importance de s’assurer que les fermentations alcooliques sont franches et rapides pour éviter tout risque de déviation.
Pour les fermentations malolactiques spontanées, les choses sont plus simples. « Sur les 18 échantillons du millésime 2023, prélevés et analysés en milieu de FML, 100 % des bactéries identifiées sont des Oenococcus oeni, relate Patrick Lucas, spécialiste des bactéries du vin. Mais il ne faut pas pour autant négliger les autres bactéries : elles peuvent se multiplier pendant l’élevage et entraîner des défauts ».
Comme pour les fermentations alcooliques spontanées, les analyses ont révélé une centaine de profils génétiques différents d’O.oeni. « Et pour chaque château, nous avons identifié entre 1 et 3 profils génétiques dominants, ajoute Jana Rudolf, experte en microbiologie du vin. Comme pour les fermentations alcooliques, nous allons devoir faire le lien entre pratiques des vinificateurs et profils identifiés pour comprendre pourquoi dans certains cas, une seule souche domine alors que dans d’autres, on en retrouve trois ».
La flore du millésime 2023 étant identifiée, l’équipe de l’Observatoire analyse désormais les échantillons 2024 dont on peut supposer qu’ils contiennent une flore assez différente car l’état sanitaire des raisins était particulièrement dégradé à la vendange et la maturité s’est déroulée dans des conditions plus froide et plus humide qu’en 2023. Les entreprises mécènes bordelaises se sont engagées à soutenir l’observatoire pendant trois ans, mais Isabelle Masneuf-Pomarede espère déjà qu’elles prolongeront pour une petite dizaine d’années.
Dans le cadre de l’Observatoire, les scientifiques étudient également la biodiversité du microbiote à la surface des merrains de chêne pendant 24 à 36 mois de séchage à l’air libre. « Dans un contexte de changement climatique, il est important de savoir comment évolue ce microbiote, façonné par une alternance de période de sécheresse et d’humidité car il joue un rôle primordial dans la qualité du chêne », explique Patrick Lucas, professeur en microbiologie et spécialiste de la biodiversité des bactéries du vin. Les prélèvements et premières analyses de cette flore de champignons filamenteux sont prévus pour 2025.


 Retrouvez tous les articles de La Vigne
Retrouvez tous les articles de La Vigne