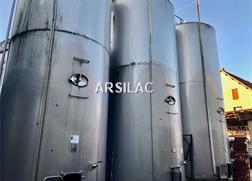n peut voir le verre à moitié vide, ou à moitié plein dans le résumé de cette dernière étude de la revue médicale de référence qu’est the Lancet : « les risques pour la santé associés à une consommation modérée d'alcool continuent de faire débat. De petites quantités d'alcool pourraient réduire le risque de certains problèmes de santé mais augmenter le risque d'autres, ce qui suggère que le risque global dépend, en partie, des taux de maladies de fond, qui varient selon la région, l'âge, le sexe et l'année. » Mais pour ceux se souvenant du tollé causé par le Lancet en 2018, il y a une grande évolution : il y a encore quatre ans, le verre devait être totalement vide. Pas une goutte de vin, bière ou cognac : les risques pour la santé étant présents dès la première gorgée pour l’étude d’alors. Ce qui n'avait pas manqué d'alimenter de vifs débats entre scientifiques. Et même d'inspirer une approche de politique européenne résolument hygiéniste, pour ne pas dire prohibitionniste.
Loin du buzz de l’étude de 2018, la publication cet été du millésime 2022 par la même équipe de chercheurs sur la même base de données actualisée (le "Global Burden of Disease", ou charge globale des maladies*) marque une nuance certaine : la consommation modérée de boissons alcoolisées peut avoir des effets bénéfiques sur la santé (via le suivi de 22 maladies et de la consommation d’alcool dans 204 pays). « Une consommation modérée de vin aurait un effet protecteur vis-à-vis de certaines maladies » commente pour Vitisphere, le professeur Fabrizio Bucella (Université Libre de Bruxelles), ajoutant, pince sans-rire : « ils découvrent la courbe en J des risques relatifs ».
Ayant critiqué la précédente publication du Lancet dans ses ouvrages**, le physicien note l’intérêt d’un nouveau calcul dans l’étude 2022 : l’équivalence pour les non-buveurs (NDE, la quantité d'alcool quotidienne qui donne le même niveau de risque qu'un abstinent). Cela permet plus de subtilité d’analyse que le seul niveau théorique de risque minimum d’exposition (TMREL, la quantité d'alcool quotidienne qui donne le risque minimum d'attraper une maladie).
Désormais plus complexe, l’étude conclut dans la nuance. Ce qui n’empêche pas certains partis-pris hygiénistes, comme le posent des auteurs de l’étude du Lancet sur le site de l’Institut pour la Mesure et l'Evaluation de la Santé (IHME) : « la consommation d'alcool comporte des risques importants pour la santé et aucun avantage pour les jeunes ; certaines personnes âgées peuvent bénéficier de la consommation d'une petite quantité d'alcool ».
Une simplification des résultats que ne valide pas Fabrizio Bucella, qui note un paradoxe de probabilité dans les conclusions 2022 : « les maladies avec le courbe en J sont l’ictus, les maladies cardiovasculaires et même le diabète type 2. Ce sont des maladies qui ne touchent pas les jeunes en fait. Il y a un effet protecteur là où les populations sont touchées. Quand il n’y a pas de maladie, il n’y a pas d’effet protecteur… » De même pour les données géographiques : « en vérité, si on prend une région du globe où les maladies type ictus, cardiovasculaires et diabète type 2 prédominent : que se passe-t-il ? La courbe en J prédomine. » L'étude 2022 gardant des lacunes, il reste difficile d'en tirer des conclusions définitives : « cette étude apporte une nouvelle pièce à un dossier qui n'est pas près de se refermer. Déjà Pline l'Ancien ne savait dire si le vin était plus généralement utile ou nuisible » indique le professeur belge.
Notant depuis 2018 qu’« un risque accru, même avec un verre de vin quotidien, ne doit pas être une recommandation à l'abstinence », Fabrizio Bucella indique que désormais « c'est l'inverse. Le risque diminue (hommes et femmes de plus de 40 ans). » Et d’ajouter que dans les Lois de Platon, l’ivresse était recommandée après 40 ans… On ne peut que voir la coupe pleine.
* : Avec un panel de 204 pays suivis de 1990 à 2020 pour l'édition 2022, et 198 pays de 1990 à 2016 pour la version 2018.
** : « En 2018, j'avais fort insisté dans ma critique sur la précédente étude du Lancet à propos du risque concernant les abstinents. Il était presque aussi élevé que celui des consommateurs d'un petit verre quotidien (0,914 % versus 0,918 %). Le risque des abstinents n'était pas mis en avant (on faisait comme s'ils n'attrapaient jamais les maladies) » rappelle Fabrizio Bucella, qui en traite dans Pourquoi boit-on du vin ? (aux éditions Dunod) et ses Tribulations œnologiques (éditions Flammarion).