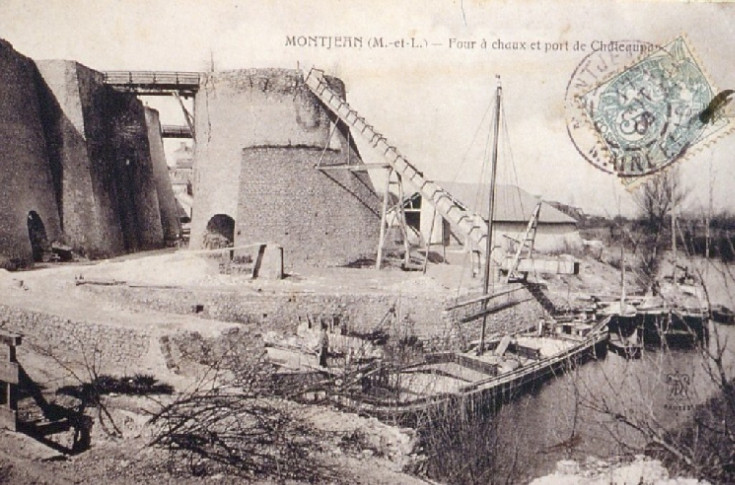ans les années 1840, le développement de fours à chaux autour de Beaune provoque une levée de boucliers des grands propriétaires de vignes et des maisons de négoce. « Le conflit débute réellement en 1844 lorsque les chaufourniers demandent l’autorisation d’installer deux nouveaux fours […] en vue de fournir de la chaux pour la construction du chemin de fer », explique Romain Mainieri, doctorant en histoire à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui a retracé l’histoire de ce conflit (1). Les dix-huit professionnels du vin qui montent au créneau « assurent que les fumées noires épaisses des fourneaux nuisent à la qualité des vins. Ils demandent l’arrêt des fours de la floraison de la vigne jusqu’à la fin des vendanges », continue Romain Mainieri.
La controverse n’est ni nouvelle ni cantonnée au vignoble bourguignon. En 1801, le célèbre chimiste Jean-Antoine Chaptal (2) expliquait déjà le phénomène : « Il suffit qu’une vigne soit exposée à la fumée d’un four à chaux ou de quelque usine où l’on consomme du charbon pour qu’elle s’en imprègne, et transmette au vin un goût détestable. » Avec à la clé une chute des revenus et une atteinte à la réputation des vins concernés.
En 1843, une nouvelle étude menée par Dumas-Aubergier et Lecoq confirme ces conclusions. Romain Mainieri nous le rappelle. Elle montre que loin d’être un « de ces préjugés des campagnes, la fumée est véritablement nuisible aux vignes car elle dépose sur le raisin des matières étrangères capables de se dissoudre dans l’alcool du vin lors de la fermentation. Pour éviter que le vin ait une “saveur détestable”, les deux experts invitent à “l’extinction des fours depuis le 1er mai jusqu’au 20 octobre” ».
Les chaufourniers se défendent. En 1845, une commission d’experts mandatée par le conseil d’hygiène de Beaune n’observe « aucune détérioration liée aux fumées » et conclut que « le chômage [l’arrêt des fours, NDLR] est inutile, qu’il est un “préjugé” des vignerons, “gens fort peu éclairés”, et que l’altération [des vins] s’opérerait seulement sous l’influence “d’agents inhérents au sol” ».
En juin de la même année, le préfet capitule. Il autorise le fonctionnement des fours jusqu’à la fin des travaux du chemin de fer. Mais « une fois les travaux terminés, les industriels continuent à faire fonctionner leurs fours, au mépris des instructions reçues ». La bataille repart de plus belle.
À partir de 1855, le préfet impose le chômage des fours durant six semaines avant les vendanges. Il faut dire que, cette année-là, le premier classement des crus bourguignons est publié. En 1863, nouveau coup de sang des viticulteurs. À la suite de l’installation de nouveaux fours, ils demandent que la période de chômage soit étendue. La réputation du vignoble est en jeu. Le préfet en est conscient. En 1863, il impose l’arrêt complet de toutes les usines pendant quatre mois, de juin à septembre. Mais, ménageant la chèvre et le chou, il autorise les industriels à utiliser du coke (un charbon épuré) à la place de la houille durant cette période. Le sujet n’est pas clos pour autant.
En 1868, l’installation de nouveaux fours met à nouveau le feu aux poudres. Onze ans plus tard, une nouvelle étude scientifique confirme que « les matières goudronneuses » qui se déposent sur les raisins sont bien la cause de l’altération des vins. Les vignerons demandent l’arrêt des fours de mai à fin octobre. Mais la préfecture se contente de confirmer la décision qu’elle a prise en 1863. De quoi ménager la vigne et la chaux.
(1) Pollutions dans les vignes : le vignoble de Beaune au risque des fumées des fours à chaux au XIXe siècle, de Romain Mainieri, in Crescentis — Revue internationale d’histoire de la vigne et du vin.
(2) Traité théorique et pratique sur la culture de la vigne, de Chaptal, Abbé Rozier, Parmentier et Dussieux.


 Retrouvez tous les articles de La Vigne
Retrouvez tous les articles de La Vigne