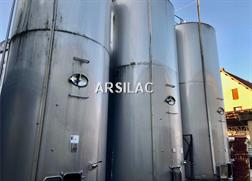ous avez affirmé que l’origine de la surproduction australienne remonte aux années 1990 et que les responsables professionnels n’ont pas abordé le problème jusqu’à présent. Toute la responsabilité de la crise actuelle leur incombe-t-elle pour autant ?
Paul Clancy : Non, on ne peut pas les désigner comme seuls responsables de la crise, il y a de nombreux facteurs en jeu. Néanmoins, lorsque des incitations fiscales ont impulsé une frénésie des plantations, qui a rapidement dépassé la croissance du vignoble planifiée par le secteur lui-même pour répondre à une hausse de la demande à l’exportation au milieu des années 1990, les responsables professionnels manquaient clairement à l’appel. Aucun d’entre eux ne peut expliquer pourquoi les organes représentatifs n’ont pas envoyé des signaux clairs pour indiquer que les nouvelles plantations étaient largement supérieures à la demande et pris des mesures pour freiner cette tendance. Les cyniques vous diront qu’une surproduction de raisins profite aux producteurs de vin car elle a entraîné une chute des prix des raisins et que la forte influence des grands producteurs de vin au sein des instances professionnelles explique le manque d’intervention sur les plantations excédentaires.
Vous estimez que la réaction du secteur vitivinicole face à ses problèmes a été « glaciale », contrairement à d’autres filières. Est-ce un phénomène purement australien ?
Comme je l’ai dit, je soupçonne qu’une surproduction de raisins a profité aux producteurs de vin en plafonnant, voire en entraînant une baisse significative des prix. Je suis certain que l’intervention tardive du secteur s’explique en partie par cette volonté. Je ne saurais pas dire si cela s’applique à d’autres pays. La filière du vin – du moins en Australie – se considère comme un seul secteur mais en réalité il s’agit de deux secteurs se déguisant en un seul. Je n’imaginerais pas, par exemple, les secteurs de la pâtisserie/boulangerie et ceux de la farine s’associer aux producteurs de blé pour se comporter comme une seule entité. L’un répond à la demande de l’autre et il est tout à fait logique que le fabricant souhaite payer le prix le moins cher au cultivateur.
Y a-t-il des secteurs qui pourraient ou devraient servir d’exemple à la filière vitivinicole pour surmonter la crise actuelle ?
Oui, en Australie, les secteurs laitiers, forestiers, piscicoles et celui des agrumes offrent de bons exemples où un effort collégial a permis de redresser la situation. Cela, grâce parfois aux aides de l’Etat mais également au prix de sacrifices très importants consentis par le secteur lui-même.
Selon vous, le secteur dénigre depuis longtemps les vins d’entrée/milieu de gamme en faveur du segment premium. La tendance à la premiumisation est mondialement reconnue, donc pourquoi faut-il les considérer sur un pied d’égalité ?
Parce que le monde consomme des vins d’entrée/milieu de gamme. La réalité, c’est que la plupart des consommateurs en boivent. Pour l’Australie, les vignobles dits « commerciaux » représentent près de 70% de la production et 80% des exportations. Leurs coûts de production relativement faibles, du fait des conditions climatiques et sols propices à la viticulture, de la mécanisation, de l’irrigation et des superficies importantes, notamment dans les zones intérieures, ont permis à l’Australie d’être compétitive sur le marché international du vin à moins de 20 AUD [soit 12 euros]. Plus globalement, allez au rayon vin en supermarché et mesurez la longueur du linéaire dédié aux vins premiums par rapport à celui des vins d’entrée/milieu de gamme. Les pêcheurs pèchent là où se trouvent les poissons et les producteurs de vins doivent élaborer des produits que les gens veulent boire et ont les moyens de s’offrir. Certes, il s’agit d’un segment très concurrentiel, mais c’est aussi le plus grand et de très, très loin. Aux yeux de la plupart des consommateurs, le vin représente une boisson à consommer avec un repas ou dans un contexte social, ni plus ni moins – c’est un bien de consommation courante, comme la lessive. Il n’y pas lieu de se sentir inférieur à un producteur de vin premium – après tout, il faut beaucoup de compétences pour élaborer des millions de litres de vin d’entrée/milieu de gamme d’une qualité telle que votre consommateur l’achète chaque semaine et reste fidèle à la marque. Or, un consommateur qui achète une bouteille de chardonnay au prix de 70 AUD a toutes les chances d’acheter une autre marque la semaine d’après. Le secteur d’entrée/milieu de gamme représente l’élément moteur de la plupart des filières vitivinicoles et il devrait être respecté et considéré sur un pied d’égalité avec le segment premium.
Deux modèles vitivinicoles complètement différents, l’un fonctionnant en toute liberté, l’autre réglementé, ont entraîné une situation de crise et de surproduction. S’agit-il d’un problème de demande ou de problèmes inhérents aux deux systèmes ?
Je pense que la surproduction de raisins – et donc de vins – reste un problème compliqué à gérer. Elle résulte manifestement d’un manque de leadership professionnel. Par exemple, en Australie, il n’existe aucun registre viticole national, aucune donnée fiable sur le nombre d’hectares de tel ou tel cépage ou sur sa localisation. Un registre viticole représenterait un outil précieux pour gérer l’offre et la demande. On ne peut pas gérer ce que l’on ne sait pas mesurer.
Comme tout secteur, la filière vitivinicole suit des cycles. A quoi ressemblera la sortie de crise en Australie ?
L’offre de raisins dépasse d’environ 30% les besoins actuels du marché. Clairement, il faut réduire la superficie du vignoble. Cette réduction est déjà en cours dans certaines régions produisant des vins d’entrée/milieu de gamme. Cependant, il existe des superficies excédentaires importantes dans les régions désignées comme premium et s’il n’y a pas de mesures prises pour arracher des vignes, le processus pour renouer avec un rapport acceptable entre l’offre et la demande sera long… Il faudra des aides d’Etat pour des viticulteurs qui quittent volontairement le secteur.
Enfin, vous avez écrit récemment qu’il faut toujours « tirer profit d’une bonne crise ». Quelles sont les leçons qu’il faudrait en tirer ?
Je ne pense pas du tout que cela s’applique uniquement à la filière vitivinicole, mais deux mots résument les leçons qu’il faudrait tirer de cette période : la complaisance et l’indifférence. Trop de gens font de l’autosatisfaction et ne sont pas vigilants quant à l’évolution de la filière et des conditions du marché. Ils pensent que « quelqu’un » veillera sur eux alors qu’en réalité peut-être que ce « quelqu’un » ne veille pas du tout sur eux. Dans la plupart des secteurs, c’est l’indifférence qui prend le dessus et par conséquent, certains des éléments les plus brillants et performants ne s’impliquent pas dans les affaires sectorielles, préférant s’occuper uniquement de leur propre entreprise. Malheureusement, cela peut conduire à un leadership, des stratégies et des politiques insuffisants.