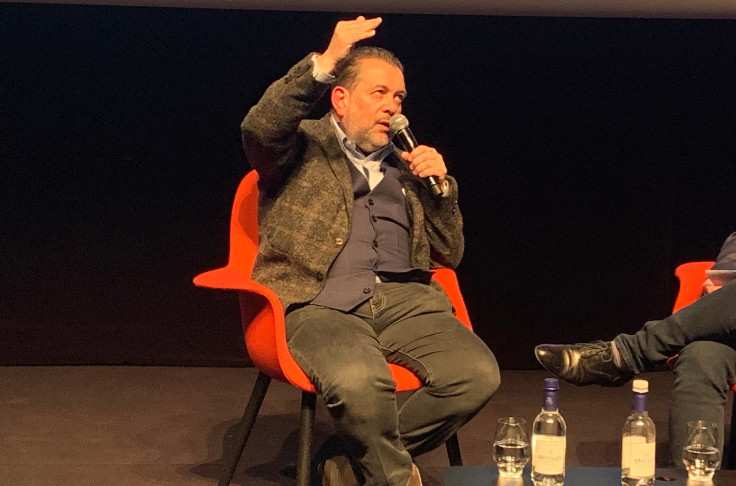ichel Chapoutier le sait et l’assume : l’idée d’ajouter de l’eau dans les vins aux maturités trop conséquentes est une marotte qu’il est bien seul à porter. « Tout le monde se moque de moi, [mais] je ne parle pas de mouillage : je parle de réhydratation » indique le négociant rhodanien lors d’une riche conférence à la Cité du Vin de Bordeaux ce 29 mars (voir encadré pour quelques bons mots et franches saillies). Pouvant sembler iconoclaste, la proposition œnologique de Michel Chapoutier cherche à rééquilibrer les maturités techniques et phénoliques. Car face au changement climatique, « jusqu’où va-t-on monter au niveau des degrés alcooliques ? » pose le négociant, qui fait état d’expériences menées par l’interprofession des vins du Rhône (Inter-Rhône) pour comparer les techniques de désaccharisation, désalcoolisation et réhydratation. Pour Michel Chapoutier, « il n’y a pas photo, sur les trois techniques, la plus simple est la réhydratation ».
« Ce que j’ai essayé de vendre aux Fraudes et à l’INAO c’est que si l’on continue [sur la voie d’un réchauffement climatique], qu’on puisse intégrer le principe de réhydratation » explique Michel Chapoutier, qui détaille : « je suis sur une parcelle qui est à 40 hl/ha potentiel et je vois que pour aller chercher la maturité des tanins, je vais, par évaporation, perdre [du volume] et descendre à 34 hl/ha par exemple. Ces 6 hl/ha que j’ai perdu par transpiration, pourquoi n’aurai-je pas le droit d’en réintroduire 2 hl/ha ? »
Se rappelant la richesse du millésime 2003, « hyper concentré », Michel Chapoutier se souvient d’avoir souvent ajouté en dégustation une cuiller à café d’eau dans le verre pour retrouver légèreté et finesse. Si l’administration n’envisage pas actuellement d’autoriser la réhydratation des vins, Michel Chapoutier peut toujours se rattraper avec l’ajout dans son verre de vin d’eau ou de glaçons. Et d’évoquer le concept de festival Rock’n Rhône qu’il se rappelle avoir proposé il y a quelques années : « on sert un Côtes-du-Rhône avec des glaçons, pour démocratiser. Quand j’étais gamin, on coupait le vin à l’eau dans le Vercors. Mettre des glaçons dans le vin rouge, il faudra y arriver sur des vins décontractés. » L’enjeu pour le négociant étant de trouver de nouvelles modes de consommation alors que la déconsommation gagne du terrain. Et que le consommateur met pour le coup trop d'eau dans son verre à vin.
Défendant l'idée d'une production du vin à la vigne, Michel Chapoutier estime que « faire du vin c’est 95 % d’agronomie. L’œnologie, c’est le papa qui aide sa fille à faire du vélo et est là au cas où, pour rattraper quand ça part en vrille. »
En termes de modestie, « quand on voit un vigneron, il dit toujours que le meilleur vin est dans sa région. Pour nous [en vallée du Rhône], la différence c’est que c’est vrai. »
Concernant le modèle de valorisation français des vins par l’appellation : « le problème des AOC, c’est qu’il y a des locomotives et des fois il y a des suceurs de roue. Je reproche parfois aux AOC d’être devenues l’école des fans de Jacques Martin où tout le monde a 10. Quand on parle de surproduction, c’est parfois plus un problème de sous-commercialisation ou des problèmes de qualité. »
Expliquant son implication forte dans les instances de la filière vin : « le collectif c’est important : on est dans une civilisation qui est extrêmement tournée vers son nombril. J’aurais pu l’être avec le stress. Un jour ma femme m’a dit : "tu deviens con à compter tes sous". C’est vrai, si je n’utilise ma cervelle que pour ça : il faut que je prenne une partie de mon temps pour faire autre chose que gérer ma boîte, autrement je vais me scléroser. C’est là où j’ai commencé à me dire que j’allais rentrer dans le collectif par thérapie. » Et de glisser que « ce qui m’inquiète, c’est que l’on a vraiment l’impression aujourd’hui il y a une vraie crise de vocation » avec moins de jeunes vignerons et négociants s’impliquant dans le collectif.
Ayant lancé un temps un concours de cuisine des vignerons, Michel Chapoutier martèle qu’au vignoble « nous faisons tout pour être marié à un met » : il n’apprécie par les accords mets et vin « machos », reposant sur la notion de « dominant/dominé », mais prône un enrichissement croisé.
Face aux difficultés du vin à se démocratiser : « quand j’entends quelqu’un dire "j’aime bien le vin, mais je n’y connais rien", je lui réponds un peu abruptement : "vous n’avez pas besoin d’être gynécologue pour faire l’amour, donc vous n’avez pas besoin d’être œnologue pour déguster du vin" ». Et d’ajouter que l’« on ne peut pas avoir que des vins snobs, mais les accompagner de vins d’entrée de gamme, de fête, de chouille... Le rouge de 7 heures du matin avec du saucisson. »
Répétant sur le sujet des vins nature que le stade d’évolution naturelle du vin est le vinaigre et que « l’art du vigneron est de s’arrêter à mi-chemin », Michel Chapoutier estime que « c’est un joli challenge de travailler avec moins de SO2, mais si [un vigneron] se gamelle, n’a pas les moyens de détruire le vin qui n’a pas la qualité suffisante, il va mettre en marché en disant que le vin est comme il était dans le temps. Mais dans le temps il n’y avait pas de frigo, le beurre était rance et le fromage de chèvre était piqué. Je préfère manger des choses correctes et pas déviantes. »
Pratiquant la biodynamie, sans préciser s’il en est un croyant, Michel Chapoutier défend les notions de biorésonance et de capacité des plantes à ressentir une intention humaine à leur égard (en s’appuyant sur le livre L’Intelligence émotionnelle des plantes de Cleve Backster) : « laissons de la place au surnaturel dans notre société rationaliste ».
Concernant la déconsommation française de vin : « il ne faut pas se leurrer : la consommation française va continuer à baisser. Le vin n’est plus une boisson, c’est devenu une culture. On va boire de l’eau et goûter du vin à côté. La France est un marché décroissant de manière définitive. Le futur du vin est à l’export. »