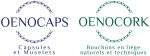ngénieure à l’Institut français de la vigne et du vin (IFV), Laure Gontier a dévoilé lors la journée Terclimpro* organisée à Bordeaux ce 18 février la première méta-analyse de la littérature internationale visant à hiérarchiser les pratiques viticoles selon leur impact sur la biodiversité des sols. Aidée par Lionel Ranjard (Inrae) et Battle Karimi (Novasol Experts), Laure Gontier a exploité 104 articles étudiant les effets de la viticulture conventionnelle, biologique ou biodynamique sur la quantité, la diversité, et l’activité de plusieurs groupes biologiques (macrofaune, mésofaune, microfaune et microorganismes).
Présentant ses résultats dans un diagramme, l’ingénieure remarque d’abord que la diversité biologique au sein des groupes taxonomiques est équivalente entre les modes de production. « En revanche, en viticulture biologique, la biomasse, la respiration, et les activités enzymatiques des microorganismes sont plus importantes. Ce mode de culture favorise aussi les mycorhizes, mais pas les champignons pathogènes, et a tendance à augmenter l’abondance de nématodes, microarthropodes et arthropodes », liste-t-elle. Laure Gontier suppose qu’en viticulture biologique la vie du sol est stimulée par l’apport d’amendement organique et la moindre rémanence des produits phytosanitaire. A l’inverse, elle constate que les viticultures biologique et biodynamique pénalisent de tous points de vue les vers de terre, en le reliant à une intensification du travail du sol, notamment lorsque le désherbage mécanique remplace les herbicides.
Au-delà du mode de culture, cette méta-analyse montre qu’un enherbement temporaire peut doubler la biomasse microbienne et l’abondance de nématodes d’un sol, comparativement à un sol nu. « Un enherbement permanent peut même multiplier la biomasse microbienne par trois et l’abondance de nématodes par quatre », rapporte Laure Gontier, qui voit aussi que les champignons mycorhiziens sont favorisés par une couverture permanente et naturelle du sol par rapport au désherbage chimique ou mécanique.
Concernant le mode de destruction des couverts, Laure Gontier n’a pas vu de différences entre l’utilisation de glyphosate (principale herbicide étudié) ou le désherbage mécanique sur les micro-organismes. En revanche, le glyphosate est très délétère sur les nématodes et les champignons mycorhiziens. Il favorise l’abondance et la biomasse des vers de terre, mais affecte leur activité.
En réalisant cette méta-analyse, Laure Gontier s’est aperçue que certains sujets n’ont pas encore été étudiés. « Nous n’avons rien trouvé sur l’impact des pesticides de synthèse autres que les herbicides, sur celui du cuivre aux doses d’utilisation actuelle, ou sur les différents types de fertilisants et amendements… La recherche a encore du travail ! »
*L'évènement Terclimpro est organisé par l'Unité Mixte de Recherche (UMR) Ecophysiologie et Génomique Fonctionnelle de la Vigne (EGFV), Vitinnov, l'International Viticulture and Enology Society (IVES), et INNO’VIN, avec le soutien de Bordeaux Sciences Agro, de l’Institut National de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), de l'Institut des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV) et de l'Université de Bordeaux, sous le haut-patronnage de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV).