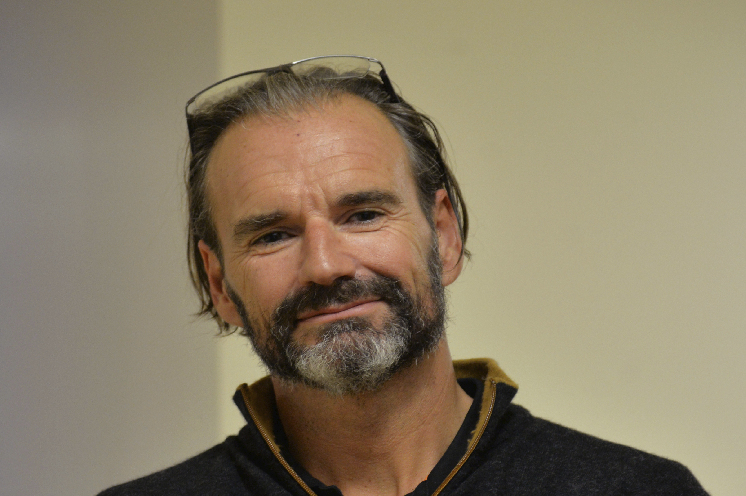Lionel Ranjard : Après s’être penché sur la diversité bactérienne des sols, il nous a semblé intéressant de faire de même pour les champignons, en analysant les mêmes échantillons de sol que nous avions prélevés entre 2002 et 2009, sur les 2 200 sites qui caractérisent la France. La diversité microbienne ne se limite pas aux bactéries. Elle comprend aussi les champignons filamenteux microscopiques. Il faut savoir qu’un gramme de sol contient à lui seul plusieurs dizaines de millions de champignons filamenteux, et quelques dizaines de milliers d’espèces. Il nous aura fallu quatre années pour analyser cette biodiversité fongique, grâce aux techniques de biologie moléculaire et au séquençage d’ADN. Puis, presque trois années pour rédiger l’atlas.
Qu’ils sont pauvres en champignons. Nous avons comparé l’abondance et la diversité en champignons de quatre grandes familles de sols : les prairies, les forêts, les grandes cultures et les vignobles. Résultat, les sols viticoles sont ceux qui contiennent le moins de champignons filamenteux et la plus faible diversité d’espèces. Ceux qui renferment la plus grande diversité fongique sont les sols grandes cultures, devant les forêts et les prairies. Dans les écosystèmes naturels, la biodiversité est stabilisée alors qu’elle se trouve stimulée dans les sols modérément perturbés, comme ceux des grandes cultures. Mais, sur les sols viticoles, la perturbation est telle que la biodiversité s’écroule.
Évidemment, puisque le climat et le type de sol varient selon les régions. Mais aussi parce que les pratiques culturales sont différentes. Par exemple, un sol alsacien très enherbé et peu travaillé présentera une abondance et une diversité fongique plus importantes qu’un sol bourguignon, peu enherbé et très travaillé. Les couverts végétaux favorisent cette diversité.
Nous n’avons pas distingué les agricultures biologique et conventionnelle. Mais il est certain que le recours aux fongicides de synthèse ou naturels et l’augmentation massive du travail du sol contribuent à l’appauvrissement en champignons. À l’origine, les vignobles ont été plantés sur des sols peu profonds, peu actifs et peu fertiles. Les pratiques actuelles ne font qu’accentuer ce manque de fertilité. Au-delà du climat ou du type de sol, ce sont les méthodes culturales qui ont le plus fort impact sur la diversité fongique.
L’atlas est un ouvrage naturaliste qui établit un état des lieux de la situation fongique actuelle dans les sols français. Les vignerons doivent prendre conscience que certaines de leurs pratiques sont destructrices pour la vie des sols. C’est aussi aux pouvoirs publics de s’emparer de ces données pour obliger les vignerons à protéger et conserver cette biodiversité dans les sols. En intégrant, par exemple, dans le cahier des charges des appellations des mesures de diagnostic de la qualité biologique des sols, mais aussi quelques préconisations, comme l’implantation de couverts végétaux qui stimuleraient l’abondance et la diversité des champignons, des bactéries et des nématodes.
Nous venons de lancer une deuxième campagne d’échantillonnage sur toute la France. Cela nous permettra de voir si la biodiversité des sols s’amenuise ou si elle se stabilise.


 Retrouvez tous les articles de La Vigne
Retrouvez tous les articles de La Vigne