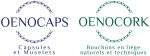omment le changement climatique impacte-t-il la diversité des microorganismes impliqués dans la transformation du raisin en vin ? Comment la réduction de l’usage du dioxyde de soufre modifie-t-elle les communautés fermentaires ? Pour aider les vignerons à préserver la qualité et la typicité de leurs vins dans cette période mouvante, des microbiologistes rattachés à l’Unité de recherche « Œnologie » de l’Université de Bordeaux ont créé en 2023 un observatoire de la biodiversité des microorganismes œnologiques.
« Nous allons y réaliser le suivi pluriannuel des populations dans les échantillons de raisins, de moûts et de vins envoyés par les dix propriétés mécènes* du projet, avec lesquelles nous coconstruisons nos travaux », dévoile Isabelle Masneuf-Pomarede, coordinatrice scientifique du projet et professeure d’œnologie à Bordeaux Sciences Agro, lors du forum des vins de Bordeaux organisé par l’interprofession ce 14 janvier lors de la matinée technique du Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB). Ce jeu de données est complété par des prélèvements dans le réseau de suivi de maturité de l’Institut des sciences de la vigne et du vin (ISVV), « dans les parcelles duquel nous avons placé des capteurs de température et d’humidité », continue l’oenologue. Au vignoble, les microbiologistes prévoient en plus du changement climatique, qui modifie le microclimat de la baie et fait augmenter la teneur en sucres et le pH des moûts, d’étudier l’impact de plusieurs pratiques, « comme l’agroécologie », sur la flore du raisin.
Au chai, à côté de la réduction des sulfites, ils souhaitent identifier tous les facteurs pouvant favoriser l’émergence de microorganismes d’altération. « En 2022, un travail réalisé avec Hennessy nous a permis d’identifier une souche Oenococcus oeni capable de transformer le glycérol en acroléine lors du stockage des vins et de donner un goût amer au cognac après distillation », illustre Patrick Lucas, autre coordinateur du projet et professeur à l’ISVV. L’observatoire doit également permettre le développement d’outils de diagnostic microbien et de caractériser la microbiologie des nouveaux produits, comme les vins no/low.
Plus original, les scientifiques vont réaliser de premiers prélèvements en 2025 pour étudier la flore de champignons filamenteux à la surface des merrains de chêne pendant les 24 à 36 mois de séchage à l’air libre. « Dans un contexte de changement climatique, il est important de savoir comment évolue ce microbiote, façonné par une alternance de période de sécheresse et d’humidité car il joue un rôle primordial dans la qualité du chêne », explique Patrick Lucas.
* : L’observatoire bénéficie du soutien en mécénat du Château Belair-Monange, du Château Coutet, du Château Cheval Blanc, du Château La Conseillante, du Château Palmer, du Château Pichon-Longueville, du Château Rauzan Segla, du Château d’Yquem, du Fonds d’initiatives Lafite et de Seguin Moreau.