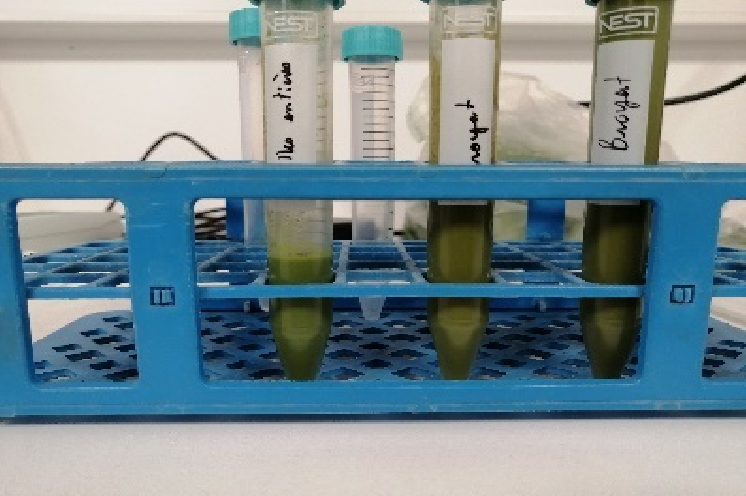eut-on mesurer le potentiel rédox d’un sol ? En Gironde, le laboratoire Excell propose depuis trois ans une analyse dans ce but. Même si elle est normée et qu’elle suit un protocole très strict de préparation de l’échantillon, Vincent Renouf, directeur général du laboratoire, reste prudent quant à l’interprétation du résultat. « Il s’agit d’un indicateur compliqué à lire. Les résultats peuvent varier d’un échantillon à l’autre, pour une même parcelle, selon les conditions de prélèvement et le tassement du sol. Ces analyses ne nous permettent pas de conclure sur la bonne santé ou non d’un sol, mais d’avoir une base de données avec des valeurs de références. Cela nous permet de classer simplement les sols en trois catégories, selon qu’ils sont réduits (potentiel rédox inférieur à 300 millivolts), équilibrés (entre 300 et 500 mV) ou oxydés (supérieur à 500 mV). »
À l’Institut français de la vigne et du vin, Jean-Yves Cahurel, expert des sols, confirme que le potentiel rédox n’est pas indicateur de routine. « Ce n’est pas comme une analyse de terre classique : pour mesurer un potentiel rédox, il faut se rendre sur le terrain, placer une électrode directement dans le sol et prendre certaines précautions, comme s’assurer qu’il n’y a pas de ligne à haute tension à proximité. »
Écho similaire chez Lionel Ranjard, directeur de recherche en agroécologie à l’Inrae. Ce spécialiste a étudié pas moins de 2000 sols différents à travers la France, et il affirme que « la mesure du potentiel rédox ne fait pas partie des analyses de routine, contrairement à la mesure du carbone organique, de la capacité d’échange cationique ou du pH. Les résultats sont très dépendants des conditions d’humidité, de la teneur en matière organique et du tassement ».
« Contrairement au pH, qui est assez stable pour un sol donné, explique Olivier Husson, chercheur au Cirad, le centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, le potentiel rédox peut varier rapidement et de manière importante en fonction des conditions météorologiques. Un sol peut s’avérer réduit lorsqu’il est gorgé d’eau ou très tassé, puis évoluer très rapidement vers l’oxydation. Sur un sol compact, les pluies entraînent en quelques heures une forte chute du potentiel rédox et les racines de la plante se retrouvent rapidement en asphyxie. À l’inverse ; dès que le sol commence à sécher, il s’oxyde. Comme le potentiel rédox est très fluctuant, sa mesure ponctuelle apporte peu d’informations. »
Selon cet expert, « pour la vigne, un sol équilibré est légèrement acide et son potentiel rédox oscille autour des 400 mV. Le couple pH-potentiel rédox conditionne la forme et la biodisponibilité des nutriments, comme l’azote, le fer ou le manganèse. Dans un sol oxydé et alcalin, le fer se retrouve sous forme Fe3 +, insoluble et indisponible pour la plante. À l’inverse, dans un sol réduit et acide, le fer est présent sous la forme Fe2 +, très soluble, pouvant même être en excès vis-à-vis de la plante. L’idéal est donc d’avoir un équilibre, un sol à la fois réduit et oxydé. Ce qui est possible : un sol peut en effet être réduit au cœur de ses agrégats, des endroits préservés de l’air, et oxydé autour. Et en cas de besoin, les exsudats racinaires de la vigne peuvent réduire le sol pour libérer les éléments nutritifs dont elle a besoin ».
La restauration d’un tel équilibre d’oxydo-réduction passe par la décompaction des sols et par l’apport de matière organique, qui améliore leur stabilité structurelle.
Selon Olivier Husson, la mesure du potentiel rédox des feuilles pourrait s’avérer plus intéressante. « On peut imaginer utiliser cette donnée pour connaître l’état d’oxydation de la vigne à un instant T et donc sa sensibilité aux maladies, confie-t-il. Cela permettrait de prévoir, par exemple, l’application d’oligo-éléments sous forme réduite ou d’antioxydants, afin d’aider la vigne à revenir à un état réduit et ainsi limiter sa zone de sensibilité aux micro-organismes. » Reste à prouver le fondement d’une telle idée.
Selon Olivier Husson, chercheur au Cirad, un simple test bêche suffit à comprendre le fonctionnement d’oxydo-réduction d’un sol. « On extrait à l’aide d’une bêche un bloc de terre bien ressuyée et on observe sa couleur, sa porosité et la forme de ses agrégats. Plus le sol est tassé, plus les fluctuations du potentiel rédox sont brutales et favorables au développement des micro-organismes pathogènes. Le travail du sol permet justement de recréer de la macroporosité et de réduire ces variations. »


 Retrouvez tous les articles de La Vigne
Retrouvez tous les articles de La Vigne