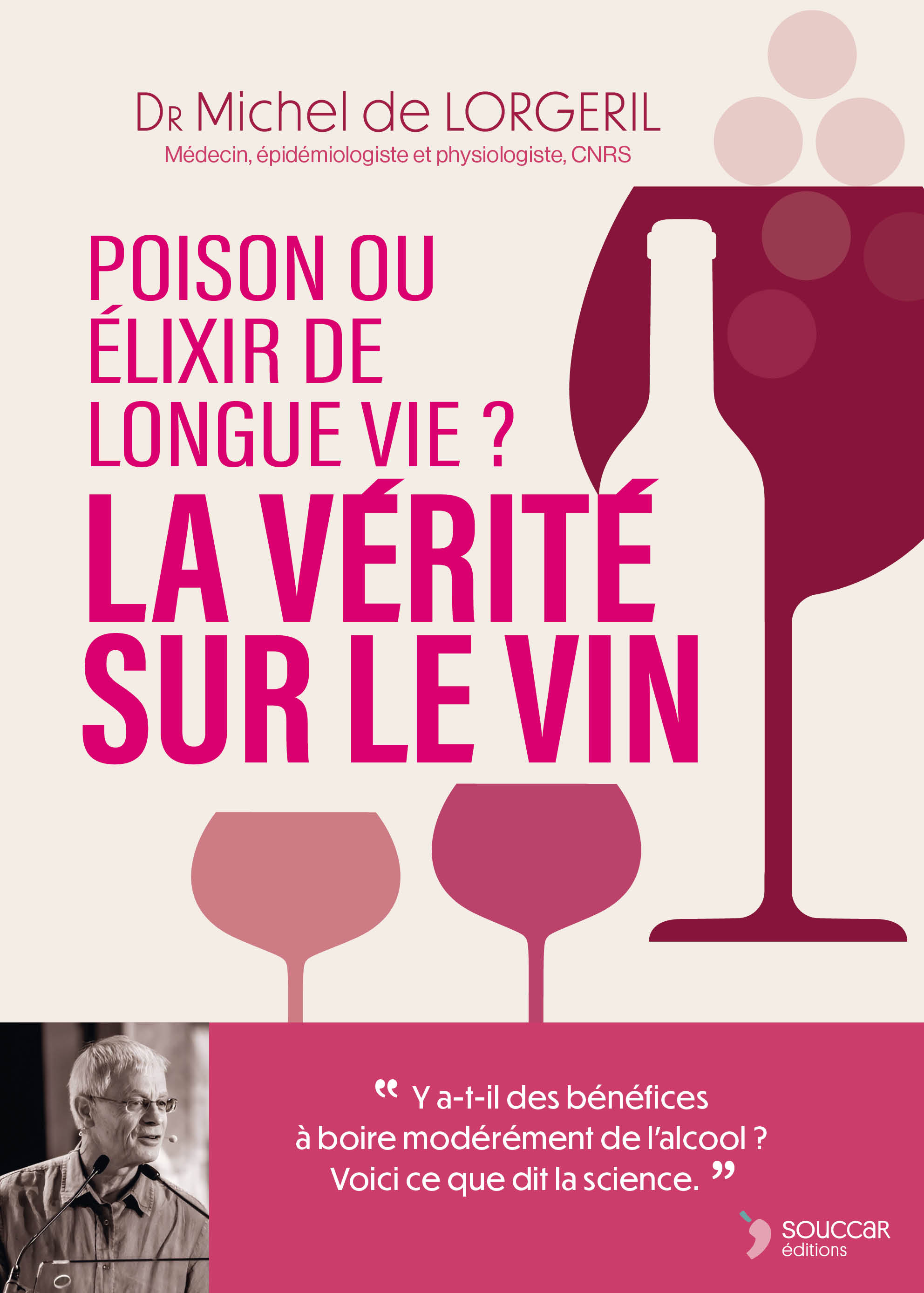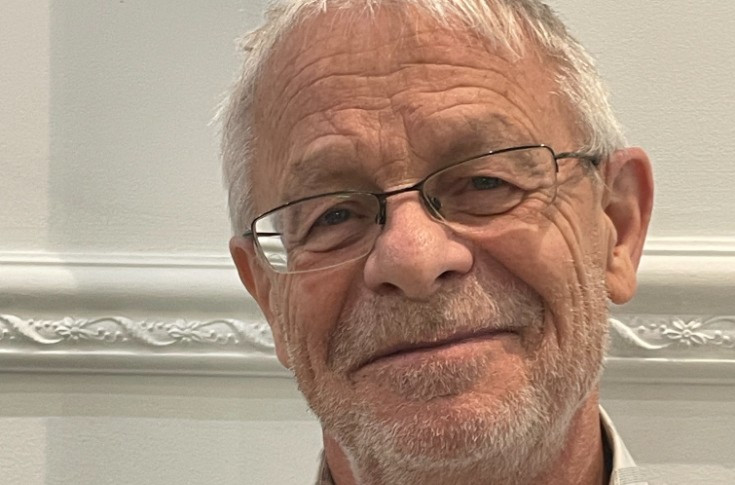Michel de Lorgeril : La question de l'alcool et des vins est complètement secondaire dans mon parcours médical et scientifique. Je travaille sur la prévention de façon générale et en particulier avec la nutrition, et évidemment le vin et l'alcool sont des substances nutritionnelles absolument fondamentales dans nos sociétés. Mais ce n’est pas moi qui ai ressenti le besoin de m'exprimer, c'est mon éditeur. Ce qui l’étonnait, c'était l'incroyable hostilité développée par les médias en général, avec des corporations médicales derrière, et l'absence totale de réaction du monde du vin. Face à ces attaques multiples et stupides, cela ne réagissaient pas, d’où la demande de mon éditeur. Notre impression générale, c'est que le monde de la viticulture est d'une incroyable passivité. Cela ne bouge pas, cela ne se défend pas, cela subit, et je ne comprends franchement pas cette passivité. Mon livre montre qu’il y a des données scientifiques fortes, imparables, pour se défendre. Personnellement, je suis fasciné par le fait que le French Paradox a été complètement oublié, jamais cité, jamais explicité. Je ne suis absolument pas contacté. La filière est masochiste !
L’un des arguments que l’on entend contre le French Paradox, c’est que depuis les années 80, notre mode de vie a changé et cela pourrait remettre en cause vos conclusions…
Mais non, c'est exactement le contraire. C'est l'argument actuel des addictologues, des cancérologues etc qui disent "Ah oui, le mythe du petit verre de rouge qui protège la santé, c'est fini, le French Paradox n’existait pas". Le livre montre exactement le contraire. Le paradoxe d’aujourd’hui y est étayé par de nombreux graphiques et données scientifiques – je ne les ai pas inventés ! Ces données sont dans la littérature scientifique et médicale. Non seulement le French Paradox était quelque chose de très concret et bien démontré, mais il est toujours là ! La mortalité cardiovasculaire en France reste la plus basse de tous les pays occidentaux. J’évoque même le quatuor paradoxal aujourd’hui : il n'est pas exclusivement français, il y a aussi les Suisses, les Belges et les Luxembourgeois qui ont une culture gastronomique assez comparable du mode français. Ce ne sont pas des Méditerranéens, donc il y a quelque chose de spécial, non seulement qui a existé mais qui persiste de façon extraordinaire. Les chiffres crèvent les yeux.
Comment l’expliquer alors que la consommation de vin a beaucoup baissé ces dernières années ?
La consommation de vin dans les années 1950 à 1980 en France – je simplifie – concernait souvent des vins de mauvaise qualité, en raison du fait que le vin était utilisé comme un outil de travail, beaucoup plus qu'ailleurs. Les mineurs, les ouvriers dans la métallurgie, sur les bateaux de pêche, utilisaient le vin plus que n'importe quel autre alcool parce qu’il était bon marché et que la concentration d'alcool était faible, autour des 10 degrés. Ils le consommaient en semaine pour s’hydrater, pour l’apport en énergie et comme euphorisant devant la pénibilité de leur travail, mais ils avaient aussi besoin de leur dose le weekend. Ils étaient addicts. Donc les statistiques anciennes en France concernant le vin et la santé sont non seulement de mauvaise qualité mais aussi ambivalentes : on a pu décrire le French Paradox et l’explication apportée, par nos soins, concernant la protection cardiovasculaire, mais dans le même temps nous avions des pathologies (cirrhose, démences, cancers) qui étaient lies à des consommations déraisonnables des boissons alcoolisées et pas seulement du vin. Aujourd’hui, le monde a changé mais d'une manière telle que la persistance du Paradoxe français s’est imposé, sans avoir les effets nocifs, sans avoir la toxicité, mais avec toujours une même explication concernant la protection cardiovasculaire. Le livre explique bien cette modification du mode de vie et des conditions d’existence : il y a en moyenne beaucoup moins de consommation excessive ou déraisonnable et beaucoup plus de gastronomes qui apprécient les vins de qualité. C’est cette modification des mœurs qui expliquent à la fois la baisse de la consommation et la persistance du Paradoxe français.
Pourquoi alors une telle négation des effets du French Paradox ?
Le French Paradox était initialement un concept de statisticiens britanniques et américains qui constataient une faible mortalité cardiovasculaire en France par rapport au Royaume-Uni et aux États-Unis notamment. Comme ils n’avaient pas d'explications, ils l’ont appelé le « French Paradox » ou paradoxe français. Ce que nous avons apporté [NDLR : avec Serge Renaud] c'est une explication à ces données épidémiologiques. Pourquoi aujourd'hui y a-t-il une telle attaque contre cette idée que l'alcool, et encore mieux le vin, pourrait protéger la santé ? C'est simplement parce que ça va à l'encontre des théories conventionnelles concernant les maladies cardiovasculaires. Avec l’alcool, il y a une augmentation du cholestérol mais une diminution du risque cardiovasculaire, alors que la médecine conventionnelle estime que le cholestérol est toujours mauvais pour la santé. C'est évident que, lorsqu’on consomme de l'alcool de façon modérée et raisonnable, cela protège. Le Polonais qui boit sa vodka pour s'enivrer n'a rien à voir avec un Méditerranéen ou un Français qui boit un verre de vin avec un bon repas.
L'industrie pharmaceutique y est-elle pour quelque chose dans cette négation ?
Il est clair que pour les sociétés savantes, aussi bien le cardiologue que le cancérologue ou l’addictologue, l’idée que la consommation modérée d'alcool puisse être bénéfique est inacceptable. Or, ces sociétés savantes sont complètement dépendantes de l'industrie pharmaceutique. C'est l'industrie des médicaments anti-cholestérol, consommés par des centaines de millions d'Européens et de gens partout dans le monde. Le Paradoxe français va à l’encontre des intérêts de l'industrie pharmaceutique, c’est certain. Mais à mon sens, pour le moment, elle ne s’est pas démasquée. Je ne sais pas si derrière toutes ces campagnes il y a réellement la main du business pharmaceutique. Je vois plutôt des cancérologues et des addictologues qui sont très actifs mais qui surtout, n’étant pas scientifiques, ne comprennent pas cette problématique complexe. Mais il faut pourtant leur répondre, la communauté viticole devrait bouger. Personnellement, je n'ai aucun conflit d'intérêt, mais je suis vraiment très étonné que cela ne réagisse pas.
Les attaques sont passées des maladies cardiovasculaires aux cancers. Pourquoi cette nouvelle orientation selon vous ?
Parce que c'est plus facile. La relation entre la consommation d'alcool et les maladies cardiovasculaires avait été plus ou moins résolue. On a montré l’effet protecteur de l'éthanol même, qui est un antiplaquettaire, un peu comme l'aspirine pour les maladies cardiovasculaires. Il y a aussi l'effet préconditionnant du myocarde, un concept fondamental mais totalement inconnu des conventionnels, y compris des médecins. Il est clair qu’il y a eu une époque où les gens consommaient de l'alcool de manière irrationnelle et les données statistiques des années 1950 à 1980 sont potentiellement suggestives pour un observateur simpliste. Bien sûr, si vous buvez beaucoup et de façon irrationnelle (le binge drinking par exemple), c’est toxique. Si vous ressortez les statistiques des années 1970, vous pouvez faire croire à des lecteurs ou auditeurs naïfs qu’au premier gramme d'alcool vous augmentez votre risque de cancer. Les données épidémiologiques concernant les cancers sont faciles à manipuler mais ne peuvent tromper un vrai scientifique. Si on regarde le tabac et les cancers bronchiques, il a fallu presque 50 ans pour que ce soit accepté par la communauté médicale, puisque les premières données concernant la relation entre le tabac et les cancers bronchiques sont venues des pathologistes allemands après la Première Guerre mondiale. C’est assez facile de créer de la confusion autour de l’alcool. Pour expliquer les choses simplement : pour créer un cancer et pour qu'il devienne cliniquement décelable, il faut plusieurs décennies. Si vous êtes un jeune adulte et que vous consommez beaucoup d'alcool et de manière déraisonnable pendant 10, 20 ou 30 ans, vous créez un cancer, notamment des voies aérodigestives supérieures, surtout si en même temps vous fumez ou que vous inhalez des pesticides etc. Le cancer n’apparaîtra que 30 ou 40 ans plus tard, au moment où votre consommation est devenue plus raisonnable. Le défaut de l’épidémiologie d’observation, c’est qu’au moment où une personne développe un cancer, on constate que la consommation est basse. Donc on en déduit que c’est avec cette consommation basse qu’on développe un cancer, alors que celui qui ne boit pas n’en a pas. D’où l’affirmation fausse que dès le premier verre, ou dès le premier gramme d’éthanol, on développe un cancer. Ce type d’affirmation est non plausible du point de vue biologique et doit être rejeté.
Une partie des affirmations négatives autour du vin résulte-t-elle d’amalgames faits avec d’autres boissons alcoolisées ?
C'est le message fondamental : les boissons alcoolisées ne sont pas toutes les mêmes, les façons de les boire sont très différentes et ce ne sont pas les mêmes buveurs. Ce sont trois points fondamentaux qu’il est urgent de comprendre si on veut défendre le produit de son travail ou de son art. Le buveur de vin boit en mangeant tandis que le buveur de bière est à jeun. Dit autrement, le buveur de bière, de gin, de vodka ou de whisky recherche l’ébriété (quel que soit le flacon) et boit à jeun. En conséquence, les enzymes du foie qui métabolise l’éthanol sont dépassés et l’éthanol passe dans le sang et rejoint le cerveau. C’est la fête ! Le buveur de vin dilue son éthanol dans ses aliments ce qui retarde l’absorption intestinale et laisse le temps au foie de métaboliser, ou transformer, l’éthanol en calories. D’autre part le buveur de vin, outre qu’il peut être un gastronome, a un mode de vie et des habitudes alimentaires spécifiques qu’il soit méditerranéen ou pas.
Quel est le rôle des polyphénols ?
C'est effectivement là que les polyphénols du vin sont extrêmement importants : le buveur de vin n'a pas le même métabolisme du fait de ses goûts, de ses habitudes alimentaires, il n’a pas du tout le même microbiote que le buveur de bière, par exemple. Le métabolisme des polyphénols dépend du microbiote intestinal, qui lui-même dépend des habitudes alimentaires, d’où l’importance du régime méditerranéen. Les Français, les Suisses et les Belges ont cette particularité probablement de métaboliser leurs polyphénols du vin d’une manière particulière du fait de leur microbiote. La plupart des études qui condamnent l’alcool mettent tout dans le même paquet : on rapporte tout au gramme d’éthanol consommé par jour ou par semaine, et on néglige complètement l'importance de la boisson telle qu'elle est bue et encore plus la spécificité du buveur ou de la buveuse. Le buveur de vodka polonais ou russe et le buveur de vin italien ou français sont des buveurs complètement différents, c'est incomparable. Autre problème, c'est qu'il n'y a pas de discussion possible entre les addictologues qui accusent l'alcool dès le premier gramme consommé et puis des scientifiques comme moi qui faisons notre travail, sans qu’on ait le moindre intérêt à défendre le vin. On voit même que l’ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn condamne l’alcool et le vin sans aucun argument scientifique. Normalement quand on est des scientifiques sérieux, on recherche le consensus avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. On ne s'insulte pas mutuellement.
Ce 25 septembre, l’ONU doit émettre une résolution sur l’alcool. Quel est le message que vous feriez passer sur la consommation de vin ?
Le message fondamental, c’est qu’il faut faire la différence entre le vin et les autres boissons alcoolisées. On ne peut pas les mettre tous dans le même sac, c’est absurde. Le vin est un produit mais aussi un art, et ce sont des artistes qui le font. Cela n’a rien à voir avec un industriel de la bière, du gin ou de la vodka. Les producteurs de vins doivent se différencier. Le vin est un produit gastronomique, c'est du plaisir. On ne cherche pas à s'enivrer. C'est une question de civilisation. L’employé de bureau qui sort en fin de semaine pour s’enivrer après le travail n'a rien à voir avec le pêcheur sicilien ou l'agriculteur sarde ou le Français provençal qui ouvre sa bouteille au moment du repas. Or, au niveau politique, on ne voit que les excès, les dégâts de la consommation irrationnelle.
Paru début septembre aux éditions Thierry Souccar, l’ouvrage du Dr Michel de Lorgeril s’appuie sur plus de cinquante ans de recherche en cardiologie préventive et en nutrition pour livrer son analyse sur les effets de l’alcool, et du vin en particulier, sur la santé. Il incite ses lecteurs à repenser leur rapport à l’alcool à la lumière de la science, mais aussi du bon sens…