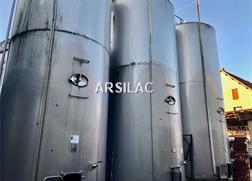a méthode du label bas carbone vigne est en cours de rédaction à l’Institut de la Vigne et du Vin (IFV). « Nous l’attendons pour le second semestre 2022 » révèle ce 20 janvier Emilie Adoir, chargée de mission évaluation environnementale de l’IFV, à l’occasion d’un colloque sur l’agriculture bas carbone.
Pour se faire une meilleure idée des émissions de gaz à effet de serre des exploitations, les techniciens comptent également sur les « Bons diagnostic carbone », et de nouveaux outils de calcul automatisés, tels que GES&Vit, un fichier Excel sorti en 2022.
« Il est à remplir en ligne avec des données connues du viticulteur, telles que la densité de plantation, les distances entre les vignes et le lieu de vinification, les quantités de produits phyto, le nombre de passages, ou le type de tracteur. Ce calculateur est capable d’évaluer des scénarios de changements de pratiques personnalisés et de repérer les leviers les plus efficaces ».
L’IFV accumule les données et sortira prochainement des référentiels par pratiques, modes de production, et par région. « Nous savons déjà que la partie viticulture représente à elle seule environ 20% des émissions » rappelle Emilie Adoir. Pour illustrer ses propos, la technicienne prend l’exemple d’une exploitation de Bourgogne au parcellaire regroupé, avec une densité de plantation de 9 300 pieds/ha sur sol granitique, une fertilisation minérale de 94 unités en un passage, du désherbage mécanique inter-rang sur trois passages, 2 rognages, 10 traitements, sans retour au sol des sarments, et réalisant une vendange mécanique livrée à une coopérative 21 kms plus loin.
« Le diagnostic initial de l’exploitation par GES&Vit montre la part importante de la fertilisation, du fait de leur fabrication et des fortes émissions de protoxyde d’azote, 265 fois plus réchauffant que le CO2. Le poste fertilisation est suivi par la protection contre les maladies et les nuisibles, et par la récolte, avec une utilisation importante de carburant ».
Pour réduire leur consommation d’énergie fossile, les viticulteurs peuvent réduire la densité de plantation, choisir des outils à faible taux de charge, des machines à faible puissance, réduire le nombre de passage diesel en raisonnant les traitements phytos et l’entretien du sol, substituer le diesel à l’électrique ou à l’animal, et penser à coupler leurs outils.
Emilie Adoir compte aussi beaucoup sur l’arrivée des variétés résistantes. « En passant de 10 à 4 passages phytos, elle permettre de réduire environ 14 % des émissions viticoles, soit 300 kg d’équivalent CO2/ha/an ». En substituant l’azote minéral par de l’azote organique, le viticulteur économise 655 kgs.
Délaisser les piquets métalliques pour des piquets en bois ou en matériau biosourcé est un autre moyen d’améliorer son bilan carbone.
Pour stocker du carbone, l’IFV recommande aux viticulteurs de broyer les sarments sur la parcelle (27 % de réduction des émissions), ou de semer des couverts végétaux entre les rangs (20 %). L’Institut chiffrera prochainement l’impact de la plantation de haies et de l’agroforesterie.