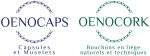e mercredi 11 décembre 2019, les chercheurs de l'Université Savoie-Mont-Blanc présentaient les premiers résultats issus de leur programme de recherche « Vitivalo », auprès notamment des professionnels du secteur. Démarré en 2017, celui-ci consiste à trouver une nouvelle filière de valorisation des déchets bois issus de la vigne et des pépiniéristes, pour en finir définitivement avec leur brûlage à l'air libre (*), une pratique encore répandue : on estime à 15% des 5200 tonnes de déchets viticoles, soit 780 tonnes, la quantité de bois brûlée chaque année à l'air libre par les viticulteurs et pépiniéristes.
Ce programme contient plusieurs volets. Le premier consiste à mesurer plus précisément les polluants émis dans l'air par cette pratique, afin d'évaluer si elle contribue aux épisodes récurrents de pollutions atmosphériques hivernales dans les vallées savoyardes. L'équipe a donc mis au point un « pilote » mobile, une sorte de cheminée installée sur une remorque, qui canalise les fumées émises afin d'en analyser in situ les teneurs en polluants. Les premiers essais réalisés, pour valider ce dispositif, ont permis de chiffrer à 225 kilos la masse de particules fines émises pour 780 tonnes de déchets brûlés. Par comparaison, un trajet en poids lourd de ces derniers vers une déchetterie située à 15 km émettrait 300 grammes de particules fines...
Ce résultat est par ailleurs « sous-évalué par rapport à la réalité dans la mesure où ils ont été réalisés sur bois sec et en conditions estivales, pendant l'été 2019 », précise Christine Piot, l'une des chercheurs du programme. Les prochains et véritables essais auront lieu en Combe de Savoie en janvier 2020 et 2021, pendant deux hivers successifs.
Le second volet du programme consiste à étudier les voies de valorisation possibles de ces déchets végétaux. Dans un premier temps, l'idée est d'en extraire les molécules d'intérêt pour la chimie verte : le resvératrol et la viniférine. Les chercheurs se sont donc attachés à extraire et à mesurer leurs teneurs sur sarments et souches, pour les deux cépages savoyards, la Jacquère et la Mondeuse. « Elles sont présentes en quantités importantes, avec des teneurs comparables à celles du pinot noir », annonce Christine Piot. La suite consiste désormais à trouver le meilleur procédé d'extraction à un niveau semi-industriel.
L'équipe a également cherché à mieux connaître les paramètres qui favorisaient au maximum la présence de ces deux molécules, afin de réunir les conditions optimales, dans l'hypothèse où une filière serait un jour mise en place. La durée de stockage entre la coupe et le broyage, la granulométrie du bois, ou encore l'âge des vignes, sont ainsi apparus comme les principaux facteurs de variabilité.
Après cette première valorisation, ces déchets pourraient ensuite être exploitables une seconde fois ; à ce stade, plusieurs voies sont envisagées : comme bio-matériau pour servir d'isolant, comme amendement pour les sols, sous forme de bois fragmenté, ou encore comme compost, une piste qui semble prometteuse : la Communauté de communes du Grand Chambéry a accepté d'incorporer en 2019 dans son unité industrielle de compostage les trois types de déchets viticoles -souches, sarments et déchets des pépinières – à la ration « habituelle » de déchets verts, à hauteur de 20%. Après 6 mois de transformation, durée du procédé classique de fabrication du compost, les mesures effectuées sur le compost final ont permis de vérifier le bon respect des normes NFU. « Ce sont des résultats encourageants. Nous allons renouveler l'expérience avec des déchets provenant d'un panel plus large », commente la chercheuse.
L'équipe s'est donnée jusqu'en 2022 pour finaliser l'ensemble de ce programme de recherches. Il leur reste cependant à trouver suffisamment de nouveaux financements pour poursuivre, mais la chercheuse se dit confiante, ce projet suscitant l'enthousiasme de nombreux acteurs et entreprises.
(*Le brûlage des végétaux à l'air libre a été interdit par arrêté préfectoral en Savoie depuis décembre 2017. En cause, les épisodes de pollution aux particules fines récurrents l'hiver, dans les vallées savoyardes).