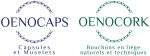e GAEC tient du mariage : dans l’euphorie des noces, les conditions de séparation ne sont pas forcément anticipées, ce qui pose des problèmes de taille quand les membres d’un Groupement Agricole d’Exploitation en Commun sont en guerre ouverte et ne peuvent plus se voir ni se sentir. La ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, en convient ce 11 février au Sénat, notant qu’« on voit combien les mésententes au sein des GAEC peuvent être déstabilisantes, avec des conflits interminables… » Déjà complexes quand ils divisent des amis, des frères ou des sœurs, ces litiges sont encore plus difficiles quand ils opposent un couple en instance de divorce après des insultes, des humiliations, des coups et blessures. Surtout que le GAEC impose un cadre contraignant aux associés s’apparentant à une nasse pour celle qui veut le quitter en retrouvant sa liberté de travailler et de récupérer le produit de son labeur passé.
C’est dans ce piège administratif que se débat Marguerite depuis les vendanges 2022 (son prénom a été changé pour qu'elle conserve l’anonymat après les épreuves qu’elle a vécu et qu’elle continue de traverser). Implantée dans le Jura, cette vigneronne a réalisé une installation individuelle au début des années 2000, puis a fondé à 50/50 un GAEC dans les années 2010 avec son ex-conjoint, qu’elle a quitté en 2022 après des violences conjugales la mettant en péril physiquement (17 jours d’ITT). Une plainte est déposée, pour aboutir à un avertissement pénal probatoire : un stage. Ne percevant pas de remise en question de son ex-conjoint, Marguerite a quitté le domicile et le domaine pour se protéger : « il n’y a pas de choix, on doit fuir. On plaque tout, on part se planquer » partage-t-elle. Mais la vigneronne demande la reconnaissance de sa vingtaine d'années de travail : elle souhaite se réinstaller en exploitation individuelle. Demandant au GAEC qu’un règlement intérieur soit formalisé et qu’elle reçoive une rémunération lui permettant de se loger décemment, elle déchante face aux contraintes inattendues de cette structure atypique. Notamment l'obligation imposée à tout associé de travailler de manière exclusive et permanente au service du GAEC. Comment une femme peut-elle être interdite de travailler par celui qui l’a violentée ? En étant vigneronne en GAEC.
Voyage Ubu de la nuit
« La société GAEC a des statuts spécifiques. C’est fiscalement une forme de société très intéressante pour les petites exploitations (la base d’imposition est basse), par contre, dans les statuts de la société, un associé doit demander le droit aux autres associés pour pouvoir travailler à l’extérieur » indique Marguerite, qui raconte avoir « relevé la tête après six mois d’arrêt maladie. J’ai décidé de travailler, mais pour ça il faut demander à monsieur. Il ne répond pas. C’est une emprise complète pour que je revienne, alors qu’il a la main mise sur l’outil de travail, le domicile conjugal et ma capacité à travailler… » En somme, « on se retrouve dans une situation où l’on est totalement inféodée au GAEC. Beaucoup d’administrations auxquelles j’ai montré mon dossier sont estomaquées par l’emprise que peuvent générer les GAEC » relate la vigneronne. Ses actions administratives ont déclenché une prise de conscience de la préfecture, qui a interpelé les services de l’Etat et les institutions du monde agricole. Qui n’ont pas donné suite aux sollicitations de Vitisphere, comme nombre d’organismes de la filière.
« En 2025, si un associé ne veut pas que sa femme travaille à l’extérieur, il peut le faire. On n’a pas de droit au travail, même en cas de violences conjugales » pose Marguerite. Demandant à son ex-conjoint (une procédure de divorce est en cours) de négocier son retrait de la société, Marguerite souhaite « s’installer de nouveau, j’ai envie d’être vigneronne, de reprendre 1,5 ha de la propriété et du matériel. Mais lui s’y oppose (refus d’assemblée générale, rejet des conciliations…) » comme elle a fondé et participé activement à la gestion et la réussite du domaine. Une parade partielle a cependant permis d’améliorer la situation : Marguerite ne travaillant plus sur l’exploitation du GAEC depuis de longs mois, son agrément fiscal a été retiré par la préfecture du Jura, ce qui lui a permis d’accéder à un tiers de temps (536 heures maximales annuelles).
Dernier paradoxe, Marguerite reste cogérante et co-responsable d’une société où elle ne met plus les pieds depuis trois ans. Malgré la précarité de sa situation, « mon slogan est je suis debout, je suis vivante, je suis militante. Il ne faut plus que cette situation existe. Qu’on ne demande plus à une agricultrice de demander l’autorisation de travailler à celui qui l’a violentée » martèle Marguerite, qui porte ce témoignage lors d'une table ronde du premier salon Paye Ton Pinard ce dimanche 6 avril à Belleville-en-Beaujolais (Rhône).
Ayant recueilli un témoignage similaire dans un autre vignoble, Isabelle Perraud, la porte-parole de l’association Paye Ton Pinard, ne pense que l’histoire de Marguerite face aux statuts du GAEC soit un cas particulier : « ce qui est particulier, c’est qu’elle en a parlé et a souhaité alerter pour expliquer ce qui peut se passer sur un GAEC. Souvent quand il y a une séparation après des violences conjugales, les femmes font le choix de s’en aller plutôt que de se battre pour ses droits, de se mettre en danger personnellement et financièrement. Elles ont rapidement compris qu’elles n’auront pas tant de soutien de la profession. Elles ne font pas de bruit et s’en vont, changent de métier et s’éclipsent. Elles repartent de zéro après des années de travail sans reconnaissance. Ça n’arrive qu’aux femmes. » Se retrouvant coincée par le statut d’un GAEC qui n’est pas dissous, Marguerite espère prévenir les autres vigneronnes qui pourraient être confrontées à la même situation. En attendant une évolution de la législation ?
Contacté via son avocat, l'ex-conjoint de la vigneronne partageant ce témoignage n'a pas donné suite à date de publication.