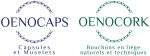Ce n’est pas une technique miracle, mais elle contribue à réduire l’exposition des bourgeons au gel. » Installée avec son frère à Chaudefonds-sur-Layon, en Maine-et-Loire, sur 16 ha en bio, Marie Dubillot a adopté un mode de conduite innovant sur une nouvelle vigne de 0,5 ha, plantée dans un secteur extrêmement gélif.
« Durant l’hiver 2021, nous avons établi cette vigne de grolleau à 95 cm du sol, contre 50 cm dans le cas de nos vignes classiques », indique-t-elle. Objectif : éloigner la zone fructifère du sol où les températures sont plus basses, afin de réduire le risque de gel. « J’ai eu connaissance d’un essai de l’Inrae à Bordeaux sur le sujet (lire l’encadré), et j’ai voulu tenter l’expérience », précise la vigneronne.
Depuis le début, Thomas Chassaing, conseiller viticole de l’association technique viticole du Maine-et-Loire (ATV 49), suit cette parcelle afin de s’assurer de l’intérêt du rehaussement des troncs. Pour cela, il a placé des thermomètres à 50 et à 95 cm du sol. Trois ans de suite, cette parcelle a subi des gels de printemps.
« En 2021, lors d’une nuit de gel, nous avons relevé dans cette vigne - 5,7 °C à 50 cm du sol, et 0,5 °C de plus à 95 cm, se souvient Marie Dubillot. L’hygrométrie était aussi légèrement inférieure à 95 cm du sol qu’à 50 cm. » De quoi amoindrir les dégâts de gel. Cela n’a malheureusement pas suffi : les bourgeons partis du sommet des tout jeunes troncs ont tout de même gelé.
Même topo l’année suivante. « Lors d’une nuit de gel, en avril 2022, alors qu’il faisait - 3 °C à 50 cm du sol au petit matin, la température relevée à 95 cm était supérieure de 0,3 °C, évoque Thomas Chassaing. Ce petit écart peut faire la différence face au gel, en limitant les dégâts causés aux bourgeons. » Mais faute de témoins, aucun cep n’ayant été établi à la hauteur habituelle, impossible de mesurer l’impact sur les bourgeons de cette conduite à 95 cm du sol.
En 2023, nouvelle catastrophe. « Près de 100 % des bourgeons ont été touchés par le gel, décrit Marie Dubillot. Puis en 2024, la température est descendue à - 1 °C. Cette fois, environ 15 % des bourgeons ont gelé. Dans mes autres vignes, nous n’avons pas subi de dégâts car il a fait moins froid. En fait, le principal levier qui nous permet de continuer à faire de la vigne dans ce secteur très gélif, c’est le cépage, le grolleau, dont les bourgeons secondaires sont très fructifères. De plus, nous pratiquons la taille tardive. »
Sur le millésime 2023, la parcelle a donné une « récolte normale » grâce aux bourgeons secondaires « miraculeux » du grolleau. « En 2024, les plants étaient très chargés, avec un potentiel de 80 hl/ha. Je les ai éclaircis et récolté 45 hl/ha », relate la viticultrice, qui n’a pas constaté d’impact du rehaussement du tronc sur la maturité des raisins ni sur la vigueur de la vigne.
S’il présente des avantages, le rehaussement des troncs n’est pas sans coût. « Une année supplémentaire a été nécessaire pour allonger les troncs alors même que nous avons choisi un porte-greffe vigoureux, le gravesac », indique Marie Dubillot. « Comme nous taillons à trois yeux supplémentaires en hauteur, la vigne doit avoir une vigueur suffisante », ajoute Thomas Chassaing. De plus, il peut être nécessaire pour soutenir les jeunes plants d’utiliser des tuteurs plus longs, donc plus chers.
Autre point à prendre en compte : chez Marie Dubillot, l’allongement du tronc a entraîné une diminution de la hauteur du feuillage car elle n’a pas souhaité investir dans des piquets de palissage plus haut. Ceci afin de limiter ses coûts, mais aussi pouvoir passer avec ses machines dans cette parcelle comme dans les autres. « En conséquence, cette vigne n’entre plus dans les critères de l’AOC Anjou. Elle devra certainement passer en vin de France », confie la vigneronne, qui précise qu’elle tresse le feuillage sur le fil de tête « afin de ne pas trop perdre en surface foliaire et d’avoir moins d’entrecœurs ».
En contrepartie, « cette vigne est plus agréable à travailler car on y est moins courbé pour la taille, les travaux en vert et les vendanges », se satisfait-elle. Et ce mode de conduite semble aussi avoir un intérêt en cas de canicule. « Lors d’un pic de chaleur de juillet 2023, nous avons mesuré 37 °C au niveau des grappes, contre 40 °C à 50 cm du sol, soit 3 °C de moins », souligne Thomas Chassaing. Un atout en plus selon Marie Dubillot, en quête d’arômes de fruits frais sur son grolleau.
Mené par Laure de Rességuier, un groupe de chercheurs de l’Inrae a mis en évidence un « gradient vertical de température » au sein des vignes. Lors du gel du 27 avril 2017, dans la partie enherbée d’une parcelle de merlot, la température est tombée à - 3,5 °C à 30 cm du sol, et seulement à - 1,8 °C à 1,20 m de hauteur. Dans la partie travaillée de cette parcelle, le gradient est bien moins prononcé, passant de - 3 °C au ras du sol à - 2,1 °C à 1,20 m de hauteur, soit 0,9 °C d’écart. L’herbe crée une sorte de matelas isolant qui retient la chaleur stockée dans le sol. Selon les chercheurs, un gradient de température comparable s’observe lors des chaudes journées d’été. Le 23 juillet 2019, dans la vigne enherbée, ils ont relevé plus de 2 °C d’écart entre la température à 30 cm du sol et celle à 1,20 m, plus fraîche. « L’augmentation de la hauteur du tronc est un bon moyen pour limiter les impacts des températures extrêmes sur ces parcelles », concluent les chercheurs.


 Retrouvez tous les articles de La Vigne
Retrouvez tous les articles de La Vigne