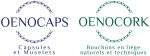rracher sans aides : "aujourd’hui il faut une coupe franche" par Caroline Teycheney, vignobles Jade, possédant le château La Loubière (Montussan).
« Nous sommes dans une période assez compliquée. C’est un choix difficile pour nous » reconnaît Caroline Teycheney, à la tête du château La Loubière (60 hectares en conversion bio). Qui résume son choix de mettre un terme à des fermages et d’arracher de la vigne par elle-même pour réduire sa surface de moitié à 30 ha : « mieux vaut se couper un bras que de fondre les plombs ». Et d’ajouter : « on fait le choix de ne pas faire appel aux aides du Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) et de l’Etat, parce que ça n’a pas de sens de se reconvertir en céréalier ou en oléicultueur (nous avons des oliviers, ce n’est pas un terroir pour olives…) »
Se souvenant que son père avait 25 ha en production, Caroline Teycheney a augmenté progressivement son vignoble avec le départ à la retraite de voisins. Mais les difficultés commerciales et économiques l’ont rattrapée : « on est dans le ventre mou des Bordeaux et Bordeaux supérieur. Il n’y a pas de demandes en face. On est en surproduction, avec 5,2 millions hl alors que l’on n’en vend que 3,9 millions hl. Aujourd’hui on n’y arrive pas. On n’arrive pas à parler avec les vignerons ou les négociants pour avoir une stratégie globale. Quand on me dit que 1 400 € le tonneau en développement durable c’est bien valorisé… »
Espérant pouvoir augmenter sa rentabilité en réduisant sa surface de production, Caroline Teycheney se projette sur l’avenir : « ma volonté est de perpétuer une viticulture bordelaise vertueuse… Réduire pour mieux transmettre. Le tout c’est de faire perdurer nos terres AOC et en vivre. Je reste optimiste : faire moins, mais mieux valorisé. » Possédant le château Fleur de Lisse à Saint-Émilion qui se développe dans l’accueil touristique, la famille Teycheney compte miser sur les synergies (en proposant des vins blancs et rosés de Bordeaux, l’appellation Saint-Émilion ne produisant que du rouge). Mais pour le vignoble bordelais, Caroline Teycheney en est persuadée : « aujourd’hui, il faut une coupe franche : on a 110 000 ha, pour être raisonnable il faudrait 80 000 ha. Avec 9 000 ha, on a fait une mesurette. »
Avec l’arrachage sanitaire : « je n’aurais pas de regret si ça ne marche pas, j’aurais tout tenté » pour Christophe Québec, vignobles Québec (Rauzan).
« Je fais un choix stratégique pour arrachage de la vigne, de manière définitive ou temporaire » explique Christophe Québec, à la tête des vignobles éponymes (44 hectares à Rauzan, en bio et conversion : tout sera certifié bio en 2024). Le vigneron bio rapporte la mise en danger de la pérennité de son entreprise familiale « avec le marché du vrac figé, la bouteille en net recul, le contexte économique défavorable et des méventes de lots à bas prix (700 euros le tonneau pour des lots conventionnels sur les surfaces en conversion). Le négoce n’étant pas structuré pour, je ne peux pas écouler toute ma production bio en vrac à un prix intéressant. Ce qui m’oblige à vendre mon vin moi-même, mais avec 44 ha de vignes je suis trop pris au vignoble et au chai. 44 ha, c’est trop. D’où l’idée de recalibrer l’exploitation. Je travaillais jusqu’en mai avec un temps plein sur le domaine qui est parti pour raisons personnelles. Ce départ m’autorise à réduire ma surface. Je saisis la balle au bond. »
« Je vais utiliser l’arrachage sanitaire pour 15 ha en diversification. J’ai posé une demande de précandidature pour être dans le premier jet » indique le vigneron, qui n’a pas encore « arrêté ma surface à arracher, qui dépendra des retours de ma banque par rapport à mes encours (avec un Prêt Garanti par l’État contracté). Je pense passer de 44 ha à 25 ou 30 ha. Moins un tiers, ce qui correspond à ce que je vends de manière opportuniste (le domaine commerciale 10 % de ses volumes en bouteilles, 60 % en contrat avec le négoce et 30 % de ventes spots en vrac). Quand je vends 700 € le tonneau, c’est catastrophique. La vente à perte est regrettable dommage que nous ne soyons pas protégés par la loi Egalim. »
Actuellement, son idée est d’« arracher les vieilles vignes, sur les terroirs les moins qualitatifs, pour être plus mobilisé sur la commercialisation de mes bouteilles et envisager une conversion en biodynamie » explique Christophe Québec. Qui note un besoin de soutien : « sans appui des pouvoirs publics, pour les filières bio et conventionnelles, je ne vois pas comment nous pourrons continuer à exister dans l’Entre-deux-Mers. » D’autant plus après les fortes perte de récolte liées au mildiou non-prises en charge par les assurances. « Je me suis assuré pour le climat et la grêle, à 28 000 € pour 44 ha avec des subventions de l’Etat. J’ai déclaré un sinistre pour excès d’humidité (avec une perte de récolte faisant tomber le rendement à 15 hl/ha), on a eu un climat tropical (taux d’humidité de 85 à 100 % les matinées de fin mai à fin juin). Mais l’assureur ne prend pas la perte en charge comme cela dépend du mildiou. Ça risque d’être un coup fatal : un point final, j’aurais pu avoir 110 000 € d’indemnité » rapporte le vigneron.
« L’idée est de passer cette crise incroyable, la plus forte depuis 100 ans au moins, pour faire encore du vin dans 5 à 6 ans » pose Christophe Québec, qui reste optimiste : « je n’aurais pas de regret si ça ne marche pas, j’aurais tout tenté. Je reste plein d'espoir et d'enthousiasme quant à ma situation professionnelle personnelle et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour assurer tous mes confrères de mon soutien et pour saluer le courage de tous les viticulteurs girondins qu'ils soient indépendants, coopérateurs, bio ou conventionnels. »