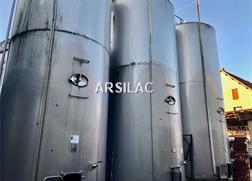’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) rend un rapport plus que mitigé sur l’utilisation de drones pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques.
Ses conclusions sur la qualité des traitements se basent sur 26 essais réalisés en conditions réelles chez des viticulteurs dans le cadre du projet « Pulvédrone », et sur 13 autres mis en œuvre sur la parcelle artificielle EvaSpray Viti de l’Institut de la Vigne et du Vin (IFV), entre 2019 et 2021.
Concernant la qualité (quantité et homogénéité) des dépôts de bouillie et l’efficacité biologique sur le mildiou, l’oïdium, ou le black rot, l’Anses indique que « la pulvérisation par drone se caractérise par des gradients de dépôt haut-bas et extérieur-intérieur pouvant affecter l’efficacité de traitements phytopharmaceutiques destinés à protéger la zone des grappes et/ou les étages foliaires les plus bas ».
Par ailleurs, les mesures de dépôts analysées à l’échelle d’une feuille montrent une très forte hétérogénéité de la pulvérisation, la majorité des dépôts se concentrant sur la face supérieure. Les experts précisent que les buses à granulométrie fine améliorent la pénétration de la bouillie au sein de la végétation tandis que l’utilisation de buses à plus forte granulométrie diminue l’hétérogénéité des dépôts entre ceps.
Pour l’Agence, la qualité de la pulvérisation par drone semble plus faible que celle obtenue avec du matériel terrestre classique, de type chenillard aéroconvecteur ou pulvérisateur à dos. « A un stade végétatif avancé, des comparaisons directes entre pulvérisations par drone et par atomiseur ont révélé, à l’échelle d’un cep, une couverture de 3,6 à 7,1 fois plus faible de la zone des grappes en cas de traitement par drone » assurent les experts, qui soulignent l’absence de répétitions ainsi que les limites des protocoles.
L’Anses a eu à sa disposition 6 essais présentant un jeu de données permettant de bien analyser la fréquence ou l’intensité des maladies. Plusieurs programmes incluant des fongicides à base de cuivre et de soufre ont été testés, de même que l’utilisation de produits à base de COS-OGA, soufre, huile d’orange douce, et de décoction de prêle.
« Les applications par drone s’avèrent dans l’ensemble moins efficaces que celles par pulvérisateurs classiques (pulvérisateur à dos, voute pneumatique, ou canon fixe), notamment en cas de fortes pressions en mildiou ou en oïdium » observe l’Anses.
En cas de très fortes pressions, l’efficacité des traitements par drone s’est révélée insuffisante, aboutissant à des pertes notables de rendement. « Toutefois des performances comparables entre les traitements par drone et par pulvérisateurs terrestres ont été notées dans le cas de faibles pressions en maladies » nuance le rapport.
L’Anses s’est également penchée sur la contamination environnementale des pulvérisations par drone, en comparant la dérive de à celle générée par des applications avec du matériel de référence utilisé dans les parcelles agricoles en pente.
Sur vigne artificielle, les profils de dérive aérienne pour les pulvérisations par drone équipé de buses à granulométrie fine sont semblables à celui de la dérive générée par l’atomiseur à dos de référence. Le profil de dérive aérienne observée pour les applications avec le chenillard de référence est en revanche plus homogène sur toutes les hauteurs de fils.
« Les valeurs de dérive aérienne mesurées pour les pulvérisations par drone sont toutes supérieures à celles mesurées pour les applications avec le chenillard de référence, quelle que soit la hauteur considérée. Pour les hauteurs de mesures basses, jusqu’à 2,5m du sol, elles sont 4 à 10 fois supérieures, en considérant des buses à granulométrie équivalente » détaille l’Anses, sachant que les buses anti-dérive donnent des valeurs de dérive 2 à 3 fois inférieures à celles obtenues avec des buses à granulométrie fine, se rapprochant des performances d’un atomiseur à dos.
Le point de départ du drone et sa hauteur de vol jouent aussi sur la dérive des phytos.
Lors de la préparation des bouillies, du remplissage des pulvérisateurs ou des drones, de la pulvérisation ou du changement de batterie, l’Anses a comparé l’exposition de 8 opérateurs équipées d’une combinaison lors d’une application du fongicide Lycedix 50 Ew avec un chenillard ou un drone.
« Les résultats indiquent que l’exposition de l’opérateur utilisant un drone est environ 200 fois plus faible que pour un opérateur utilisant un chenillard. La différence majeure de contamination, malgré des rechargements multiples, est observée lors la phase d’application, avec une contamination totale plus élevée pour un chenillard (15804.87 µg/opérateur) comparé à une pulvérisation avec un drone (71.59 µg/opérateur) » précise l’Anses.
Lors de la phase de chargement, la contamination pour les drones est cependant plus élevée (232.43 µg/opérateur) car le drone nécessite d’être rempli plusieurs fois, à l’inverse du chenillard (15.20 µg/opérateur), à raison de 11 opérations de chargement contre 3 pour une quantité de substance active pulvérisée quasi identique.
Les experts ont finalement évalué l’exposition des riverains à la dérive de pulvérisation a été estimée à l’aide de mannequins disposés à 3, 5, ou 10 mètres des parcelles.
« A l’exception d’un mannequin placé à 5 mètres, les niveaux de contamination sont toujours supérieurs dans le cas d’une pulvérisation par drones en comparaison à ceux avec chenillard et ce, quelle que soit la distance de la pulvérisation. Toutefois, on note une très forte variabilité entre les mesures pour une même distance avec le même matériel de pulvérisation » concluent les experts, qui auraient besoin de données complémentaires.