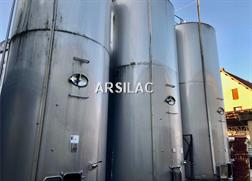En achetant un vin bio, que cherche le consommateur : une action pour l’environnement ou pour sa santé ? » pose Yann Raineau, ingénieur à l’école Bordeaux Science Agro, ce 20 novembre lors d’une conférence du salon Vinitech (Bordeaux). Pour apporter une réponse, le chercheur présente les premiers résultats d’une dégustation où les consommateurs ont une connaissance progressive des vins présentées afin de connaître les ressorts d’achat.
Réalisée auprès de 200 dégustateurs en 2016*, l’expérience a réuni un vin bio et nature, un vin bio sans sulfites ajoutés, un vin bio, un vin réduit en sulfite et un vin conventionnel. À l’aveugle, Yann Raineau souligne que les vins nature sont globalement préférés (même si cela n’est pas significatif). Cette préférence va croissante à mesure que les informations sur les vins sont dévoilés (sans sulfites, bio, nature…). Alors que les vins bio en bénéficient moins. Pour le consommateur, « il y a plus de différences entre des vins sans et avec sulfites qu’entre des vins bio et conventionnels » souligne Yann Raineau, qui résume : « l’information sur la bio est moins discriminante que celle sans sulfites ».
En termes de valorisation, l’étude estime que pour un vin bio, le consommateur est prêt à débourser, en moyenne, 1,56 euro en plus si la bouteille présente la mention nature. Et +0,98 € si le vin est sans sulfites ajoutés. La dévalorisation est de -0,87 € si le vin est conventionnel. « En situation de comparaison, le vin bio est concurrencé par le vin sans intrants sur le champ de la naturalité » estime Yann Raineau. « Derrière l’appétit altruiste pour l’environnement, les attentes individuelles propres l’emportent » conclut le chercheur.
* : L’expérience vient d’être reproduite en 2018 avec les mêmes vins, conservés depuis 2016. Les résultats n’ont pas encore été traités.
Prenant de la hauteur par rapport au débat, et au succès des vins nature, Axel Marchal, maître de conférence à l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, pose une question : avec le vin, boit-on une idée ou un goût ? En disciple de Denis Dubourdieu, le chercheur estime que l’absence d’intervention peut confiner à « un abandon du vin », avec des développement d’acidité volatile et/ou la présence d’éthyl-phénols qui voilent les qualités aromatiques du vin, et donc sa spécificité.
Pour Axel Marchal, le vin nature repose sur « la vision rousseauiste que la nature est bonne et bienveillante, alors que l’homme la pervertit. C’est une idée agréable à penser. Mais le vin est-il issu d’une activité naturelle ou culturelle ? » Son exposé rappelant qu’il n’existe pas de vin sans homme, alors que la vigne est une liane qui n’a pas naturellement tendance à pousser palissée.
L’œnologue craint plus globalement une approche de valorisation des vins par le mode de production plus que par le lien au terroir : « avant, on avait l’habitude de distinguer les vins de cépages des vins d’origine. Les premiers étant plus de marque, les seconds plus identifiés à un endroit donné. Depuis quelques années, on voit l’apparition [sur les étiquettes] d’éléments de valorisation sur la façon de produire le vin. Un palier a été franchi avec le vin nature, prenant parfois toute la place, alors que l’appellation est reléguée tout en bas. »