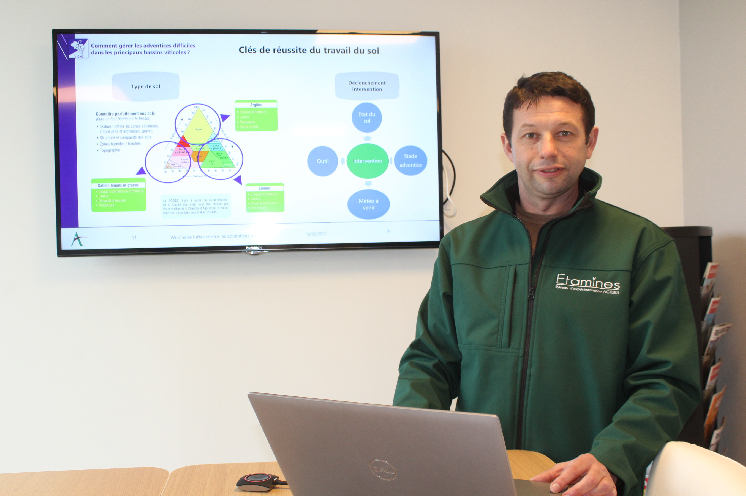Richard Marchand : La demande a été formulée par nos négoces et coopératives adhérents, qui voulaient un support technique pour accompagner les viticulteurs dans leur entretien du sol dans un cadre de restrictions réglementaires. Le désherbage combinatoire, qui associe chimique et mécanique dans un même itinéraire, est relativement nouveau, et le manque de repères a pu donner lieu à des échecs. Dans cette étude, nous montrons que cette pratique n’est pas un simple mélange de chimique et de mécanique, mais une stratégie à part entière, avec ses clés de réussites.
R.M. : Nous avons commencé par identifier les adventices les plus problématiques du vignoble : ray-grass, érigéron, géranium, chiendent. Pour chacune de ces adventices, nous proposons trois itinéraires composés de deux à trois interventions dans l’année. L’idée est de choisir parmi ces trois propositions en fonction des moyens de l’exploitation et de la parcelle concernée. La plupart de ces itinéraires commencent par un travail du sol à l’automne. La suite comprend en moyenne deux autres interventions, une chimique et une mécanique, ou deux chimiques. Par exemple, face à l’érigéron qui est une plante qui se développe toute l’année, le meilleur itinéraire détaillé dans notre étude consiste en un travail du sol à l’automne avant les froids, un second en prédébourrement – essentiel notamment en cas d’hiver doux et humide, propice aux levées échelonnées d’érigéron – puis, dans les huit jours qui suivent, une application de 40 à 65 g de flazasulfuron sous le rang.
R.M. : Nos itinéraires fonctionnent aussi sur flores variées car les produits que nous conseillons ont plutôt des spectres larges. D’ailleurs, avoir une flore variée est plutôt bon signe. Cela signifie que les espèces problématiques n’ont pas pris le dessus, la situation sera donc plus facile à gérer. Il n’y a que dans les parcelles envahies de chiendent ou de ray-grass que nous proposons d’employer des antigraminées au spectre assez étroit.
R.M. : La plus importante de toutes ces bonnes pratiques est l’anticipation : toujours intervenir sur adventices jeunes. C’est la clé de la réussite, en mécanique comme en chimique. Exemple : il faut passer le glyphosate sur plantules, nos résultats sont clairs sur ce point. En termes d’organisation, cela veut dire qu’il faut débuter le plus tôt possible, en général dès l’automne. On évite ainsi d’entrer dans un cercle vicieux. Or pour intervenir au bon moment, il faut disposer d’une vision globale de l’exploitation. Quelles sont mes parcelles à problème ? Comment les prioriser ? Quelles sont les parcelles difficiles d’accès, sans couverts ? Ces questions sont les bases d’une organisation optimale.
R.M. : En conditions exceptionnelles, on passe en travail mécanique dès que le sol est ressuyé, et dans les huit jours qui suivent, on applique un herbicide.
R.M. : C’est un levier complémentaire, surtout sur des parcelles très hydromorphes, avec des problèmes de portance. Mais il faut raisonner en fonction de l’objectif : si on vise plus de portance, on ne sème pas le même mélange que pour obtenir de la biomasse. Pour la portance, on s’oriente plutôt vers un couvert permanent. Encore une fois, la décision doit être prise parcelle par parcelle. Et il faut faire ce choix en amont, en saison N-1. Décider, au dernier moment, de retarder la destruction d’un couvert hivernal pour avoir de la portance en début de saison peut s’avérer dangereux, en termes de concurrence.
R.M. : En désherbage chimique, l’optimisation de la pulvérisation est essentielle, comme en protection phyto. Il faut adjuvanter ou acidifier la bouillie si nécessaire, ajuster la quantité d’eau… En mécanique, il est nécessaire d’adapter ses outils au type de sol. Exemple : sur sols à dominante argileuse, les outils rotatifs peuvent poser des problèmes de structure. Il faut aussi passer dans de bonnes conditions : un travail du sol effectué en conditions trop humides peut, par la suite, mettre en échec le programme herbicide.
R.M. : Vous abordez un point clé : un itinéraire combinatoire est certes plus coûteux à court terme, mais pas à moyen terme. C’est ce que nous allons marteler, désormais. Oui, un passage mécanique coûte cher. Mais quand on vient à bout de l’herbe dans une parcelle à problème, c’est autant de récolte sauvée. Nous avons chiffré à 40 % les pertes maximales liées à la concurrence des mauvaises herbes. Sans parler des éventuels déclassements liés à l’érigéron. Et plus on combine les techniques de désherbage, moins on a de pression de sélection. Le recours au travail préalable du sol peut redonner de l’efficacité aux programmes herbicides. Encore une fois, le raisonnement est le même qu’avec un produit phyto.
R.M. : Le 100 % chimique peut encore fonctionner dans certaines situations. Mais techniquement, il faut réaliser un sans-faute : choix du produit, doses respectées, qualité de pulvérisation…
R.M. : Dans ce cas, les solutions combinatoires gagneraient encore en importance. Je ne dis pas pour autant que les pouvoirs publics doivent continuer à supprimer des solutions.
Né en 2015, le groupement d’achat Actura fédère 139 négoces et coopératives d’agrofournitures. Cette fédération s’est rapidement dotée d’un réseau d’expérimentation qui rassemblant ses experts techniques, nommé Étamines, qui a mené l’expérimentation « Comment gérer les adventices difficiles dans les principaux bassins viticoles », de 2018 à 2023. Le résultat de ce travail a été synthétisé dans une plaquette qui explique comment lutter contre les adventices les plus problématiques en France, document réservé aux équipes technico-commerciales des entreprises du réseau Actura.


 Retrouvez tous les articles de La Vigne
Retrouvez tous les articles de La Vigne