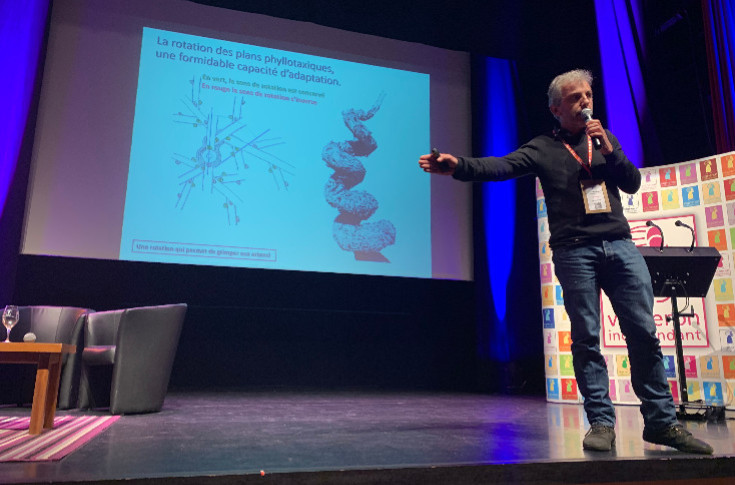echnicien passionnant, Marceau Bourdarias, le fondateur des Architectes du vivant (12 formateurs sur toute la France), sait surprendre son public, comme lors de sa participation aux Rencontres des Vignerons Indépendants ce mardi 26 mars à Thuir (Pyrénées-Orientales). Rappelant que la vigne est une liane, le conférencier souligne que « cette plante a une caractéristique particulière. Comme elle doit grimper aux arbres (ne produisant pas de fruit à l’ombre), elle a construit une manière de développer ses sarments année après année qui est en forme de spirale. » S’appuyant sur une taille traditionnelle suisse en tire-bouchon, « qui prend comme parti d’utiliser cette rotation annuelle des plans phyllotaxiques » dans le Valais.
« D’une génération à l’autre des yeux, la position des yeux sur les sarments évolue. J’ai réussi à modéliser cette histoire-là et je me suis aperçu que c’est une rotation qui correspond au nombre d’or » poursuit Marceau Bourdarias, précisant immédiatement que « ça peut sembler ésotérique, ça ne l’est pas du tout. Pour ceux qui ont lu Da Vinci Code, c’est la divine proportion » (soit (1+√5)/2, environ 1,618033…). Se retrouvant dans de nombreuses spirales botaniques (mais aussi minérales), le nombre d’or se « retrouve dans la vigne. Imaginez que si la vigne emmenait tout le temps ses bourgeons dans le même sens, elle aurait tendance à s’éloigner de l’arbre sur lequel elle a germé. Au lieu de ça, tous les ans elle fait une sorte de mouvement vers l’intérieur » explique Marceau Bourdarias, qui note que « déjà tous vos entrecœurs poussent vers l’intérieur de la plante. Puis année, après année, il y a une rotation de 42,49° qui s’opère d’une génération de sarment à l’autre, c’est vraiment fantastique. » 42,49° étant l'angle entre la différence entre l'angle d'or (222,49° = 360°/1,1618033...) et le plan du bras de vigne (180°). D'abord mesuré en Suisse, cet angle se retrouverait empiriquement sur d'autres cépages (notamment du Rhône pointe Marceau Bourdarias : marsanne, roussanne, viognier...), sans être totalement généralisable (des effets de clones et de millésimes semblant jouer).
Concrètement, cette approche géométrique du fonctionnement de la vigne « nous permet de comprendre pourquoi nos ceps de vignes sont tordus (en alternant les angles de bourgeons qui pivotent). Parce qu’au lieu de prendre le parti de jouer de cette orientation et de monter en spirale (premier œil franc sur premier œil franc sur premier œil franc…), on prend le bourgeon qui nous arrange ou l’orientation du sarment qui nous arrange » note Marceau Bourdarias, pour qui « il suffirait pour piloter la forme que prend la plante de regarder l’orientation des bourgeons et non des sarments. Un sarment qui pousse dans le rang a toujours des bourgeons dans l’axe du fil. Alors qu’un sarment qui pousse dans l’axe du fil a une orientation des bourgeons dans l’axe du fil. C’est extraordinaire : en voulant viser le fil, on l’évite. Plus vous regardez l’orientation des bourgeons, plus vous pilotez la forme de votre cep. Les Suisses ont magnifiquement utilisé ce système pour monter le moins vite possible et garder la plus grande surface foliaire le plus longtemps possible. Et accepter que cette plante bouge. » Une approche iconoclaste sensible à l'orientation des bourgeons qu'il indique avoir acquise à partir de cette découverte du nombre d'or dans la croissance de la vigne.
Alors que des débats sur les vidéos d’influenceurs viticoles et les approches de la taille de Marceau Bourdarias existent, le technicien souligne que s’il « partage beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, par générosité tout simplement pour ne pas garder pour nous des choses, pour faire évoluer les perceptions, ces petites vidéos que l’on partage il ne faut surtout pas les prendre pour argent comptant. Ce sont des choses pour vous faire évoluer, pas forcément pour changer votre avis, mais d’ajouter un nouvel avis au votre, un nouveau regard pour progresser dans une meilleure appropriation des techniques. » Pour lui, « il est important de se faire accompagner pour mieux connaître la plante et s’adapter. Il n’y a pas de recette dogmatique. »