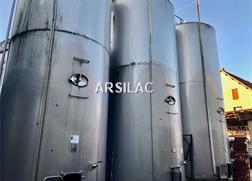En 1693, Guy-Crescent Fagon devint chef de la maison médicale du roi. Louis XIV appréciait le champagne, mais Fagon lui trouve des défauts médicaux : « l'abondance de tartre dont il est chargé, qui lui conserve le goût agréablement piquant dont la langue et le palais sont pénétrés même avec beaucoup d'eau, mais dont les nerfs sont aussi dangereusement frappés que la langue en est flattée ».
Il tente de convaincre Louis XIV de boire du bourgogne. Le roi s'y refuse. Fagon profite d'une nouvelle crise du roi : « sur la fin de ce mouvement de goutte, dont la douleur et l'incommodité avaient mieux persuadé le roi de toutes les raisons que j'avais eu souvent l'honneur de lui représenter pour l'engager à quitter le vin de Champagne et à boire du vin vieux de Bourgogne, il résolut à vaincre la peine qu'il lui faisait au goût, et d'essayer s'il s'y pourrait accoutumer. J'entendis cette déclaration avec une grande joie. »
Un médecin qui se réjouit de la souffrance de son royal patient pour le convaincre à changer de régime, c'est Panoramix et la crise de foie d'Abraracourcix dans Le Bouclier Arverne (tome 11 d'Astérix le Gaulois).
Peut-on boire le vin de Montesquieu ?Le père de l’Esprit des Lois est jeune baron, il a vingt-quatre ans à peine que le voilà investit de la possession de La Brède à Martillac. Il y a deux successeurs au vignoble historique du penseur des Lumières. Le château de la Brède, seuls vins autorisés à porter ce nom (AOC Graves) et le château de Rochemorin, rattaché au XVIIe siècle à la seigneurie de La Brède (AOC Pessac-Léognan). Rochemorin constituait une partie du vignoble de Montesquieu.
Dans son ouvrage majeur, le philosophe établissait une fonction de l'ivrognerie avec la latitude : « l'ivrognerie se trouve établie par toute la terre, dans la proportion de la froideur et de l'humidité du climat. Passez de l'équateur jusqu'à notre pôle, vous y verrez l'ivrognerie augmenter avec les degrés de latitude. Passez du même équateur au pôle opposé, vous y trouverez l'ivrognerie aller vers le midi, comme de ce côté-ci elle avoit été vers le nord. »
Unanimité contre le saucissonnage ?
Le projet de loi relatif à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, porté par le ministre de l'époque Claude Évin, ne fut pas un parcours de santé devant le Sénat. Lors de la séance du 11 octobre 1990, le débat devait être saucissonné* (comme le décrit le compte rendu intégral) entre les questions orales et deux textes sur la pêche et la conchyliculture. En guise de provocation, Claude Évin avait proposé de faire siéger les sénateurs la nuit, suscitant l'ire de l'assemblée.
Le président de l’assemblée avait fait remarquer, en souriant, que le Sénat se prononçait à l'unanimité contre le saucissonnage. Les sénateurs ne ménageaient pas les métaphores : « pensez-vous réellement, mes chers collègues, que la jeunesse se laisse convaincre par des interdits, surtout lorsqu'elle a conscience que ces interdits sont dictés par des pharisiens ? »
Un Sénat de pharisiens contre le saucissonnage, voilà qui est original.
* : Le saucissonnage est une pratique parlementaire fractionnant l'étude d'un dossier pour fatiguer l'opposition et en diminuer la mobilisation.