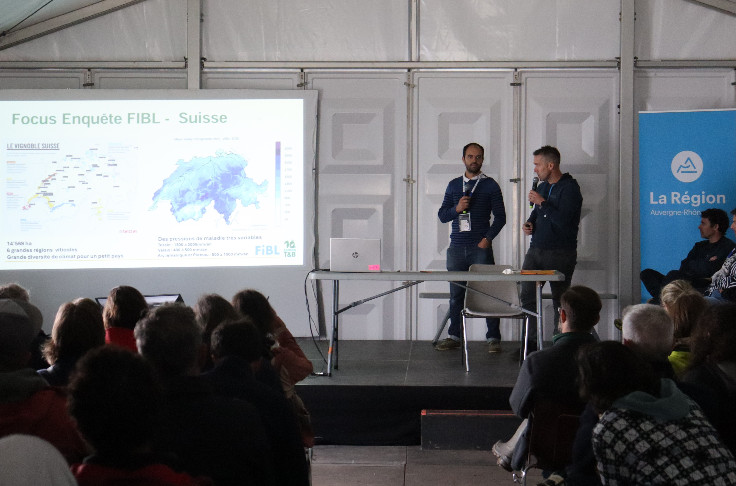ace à la forte pression mildiou en 2024, les viticulteurs bio suisses ont fait comme leurs homologues français : ils ont apporté plus de cuivre et plus fréquemment. Soit 3,44 kg/ha en seize passages, quand la moyenne lissée sur cinq ans est de 2,5 kg/ha/an et douze traitements, d’après les chiffres de l'Institut suisse de recherche de l’agriculture biologique (FIBL) présentés sur le salon Tech & Bio le 25 septembre à Bourg-les-Valence (Drôme). Cette même année, d’après l’Institut Technique de l'Agriculture Biologique (Itab), les vigneons bio français apportaient en moyenne 3,72 kg/ha en treize passages, au lieu de 2,7 kg/ha/an et 9,22 traitements en moyenne quinquennale. Et la nouvelle Aquitaine battait les records avec 4,78 kg/ha en 16,8 passages… Au terme de cette éprouvante campagne, un tiers des Français enquêtés déplorait plus de 20 % de dégâts de mildiou sur grappes, dont la moitié plus de 40 %. En Suisse, les pertes moyennes dues au mildiou étaient évaluées à 24 %.
« Nous avons un petit vignoble de 15 000 hectares, dont 20 % en bio, avec une très grande diversité de terroirs et climats, donc des pressions maladies très variables », explique David Marchand, du FIBL Suisse, venu présenter les points clé de la lutte contre le mildiou pour la viticulture bio suisse. La prophylaxie d’abord. « Il faut vraiment tout mettre en œuvre pour limiter la pression maladie, à chaque étape. Cela commence par des sols vivants, puis le choix des cépages à planter. Ensuite, la hauteur du feuillage : comme le champignon se développe à partir du sol, on constate que remonter le fil retarde les premières contaminations. Ensuite on veille à équilibrer la vigueur de la vigne car plus elle est vigoureuse, plus elle est sensible – cela passe par la gestion de la fertilisation, des couverts végétaux, l’entretien du sol… L’épamprage est aussi un point central pour ne pas offrir au champignon de tremplins entre le sol et les feuilles. De manière générale, les travaux en vert sont très poussés en Suisse : on épampre, on effeuille et on enlève les entrecoeurs pour aérer à l’extrême la zone des grappes. »
Ces travaux en vert « précoces et rigoureux » permettent, selon lui, de limiter les apports de cuivre. Mais ce métal reste incontournable. « Il y a peu d’alternative en cas de forte pression », reprend David Marchand, qui insiste sur deux facteurs de réussite : la qualité d’application et le positionnement des traitements. « Les viticulteurs suisses apprennent des années à forte pression : on voit que la tendance est à l’augmentation du nombre de traitements. En 2024, la majorité des viticulteurs bio suisses avaient fait entre 13 et 20 passages, avec un maximum à 28. Cela pose la question de la gestion du sol car il est crucial de pouvoir revenir rapidement dans les parcelles après une forte pluie. »
Mais même les années à faible pression ne laissent pas les pulvérisateurs au hangar. Courbe à l’appui, Benoît Laurent, de l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), constate que « quand la pression est dix fois plus forte, l’IFT n’est "que" deux fois plus élevé, car on ne veut pas prendre de risque ». En cause : la difficulté des outils d’aide à la décision (OAD) à prévoir un départ épidémique. La France et la Suisse ont décidé d’aborder cette difficulté par le même angle : en captant les spores de mildiou dans l’air pour anticiper le risque épidémique. Les approches des deux pays sont complémentaires. En Suisse, un gros capteur faisant appel à l’intelligence artificielle pour reconnaître les spores de mildiou présente l’avantage d’offrir une vision en direct, mais avec une fréquence non négligeable de faux positifs (mildiou annoncé alors qu’il n’est pas présent). En France, l’approche moléculaire avec analyse PCR induit un délai de 2-3 jours mais la fiabilité est élevée, même si les spores de mildiou mortes sont également détectées.
Les essais menés depuis quatre ans dans des châteaux partenaires en Bordelais ont permis de diminuer les doses de cuivre chaque année sans impact sur la récolte. Mais il s’agit de tests sur des parcelles expérimentales. Pour un déploiement à grande échelle, il faudrait connaître le modèle de dispersion du mildiou afin de savoir où positionner les capteurs. Une thèse est en cours au sein de l’IFV.