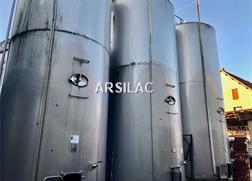ans la quête d’alternatives au Pyrévert, souvent critiqué pour sa cherté et son large spectre insecticide, les désenchantements semblent être monnaie courante. Pour les produits alternatifs, en complément ou remplacement, « les efficacités sont inexistantes ou non-significatives pour nos premiers essais d’argile, huiles essentielles, macération d’ail… » résume ainsi Thomas Suder (AgroBio Périgord). Le technicien va cependant reconduire les essais réalisés l’an dernier en introduisant de nouvelles modalités (oviphyte, talc…).
Même constat avec des essais de traitements au saccharose, parfois qualifié de solution miracle par la bibliographie. « Après une année d’études [en 2014], il n’y a pas eu d’efficacité prouvée du saccharose sur la présence de cicadelles » rapporte Sophie Bentejac (GDON des Bordeaux).
Même constat sur la piste des biocontrôles, qui ressemble fort à une impasse. « Je n’ai pas de bonnes nouvelles à vous annoncer. Les essais de contrôle biologique restent infructueux » rapporte le docteur Julien Chuche (université de Maynooth, Irlande). Malgré de nombreux parasitoïdes (Pipunculidae, Anteoninae, Dryinidae, Gonantopodinae…) mis à l’épreuve, les taux de parasitisme reste inférieur à 1 %. Et les prédateurs ne donnent également pas de résultats probants.
Dans cette succession d’échecs expérimentaux, une seule lueur d’espoir persiste : la confusion sexuelle. « Il n’y a pas de phéromones chez les cicadelles. Mais il y a une communication par vibrations pour l’accouplement » explique Fabien Chuche. Le chercheur note qu’« il existe déjà une confusion sexuelle naturelle, qui est mise en place par les mâles pour brouiller les vibrations des autres concurrents. »
Stationnaire sur la plante, la cicadelle femelle répond aux appels des mâles se posant à proximité (que ce soit sur la même branche/feuille, ou sur une autre voisine, pour peu qu’elles soient proches de quelques centimètres). Cette piste est actuellement défrichée par les travaux italiens de Valerio Mazzoni (Istituto Agrario di San Michele all Adige Iasma). Avec son équipe, le chercheur a créé un prototype diffusant des vibrations perturbant la bonne reproduction des cicadelles. Mais la portée de ce boîtier est la principale limite de ce projet prometteur, la proximité étant impérieuse pour transmettre correctement les vibrations.
Actuellement en développement, ce projet reste une solution envisageable, pour un coût estimé à 300 euros par hectare, et un fonctionnement de 18 heures par jour entre mai et septembre. Il reste encore du travail sur ce sujet, surtout que l'« on ne sait pas quels seraient les effets de ces vibrations sur la plante » conclut, prudemment, Fabien Chuche.