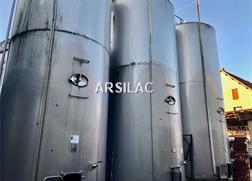i l'on avait mauvais esprit, on dirait que la soupe est pleine... Très citadine à défaut d'être urbaine, la dernière sortie médiatique de la députée écologiste Sandrine "je n’en ai rien à péter de leur rentabilité" Rousseau n’en finit pas de heurter les agriculteurs en général et viticulteurs en particulier. Expliquant que son propos a été mal résumé, mal interprété et surtout monté en épingle par ses opposants politiques, l’élue parisienne précise sur ses réseaux sociaux qu'elle critique la quête de rentabilité de l’agroindustrie en particulier et qu'elle défend le revenu de la paysannerie en général : il faudrait sans doute que Dieu reconnaisse les siens… A priori, on reste dans le ton péremptoire sans grande nuance dans le fond ni grande volonté dans la forme d'embarquer toute la ferme France vers un projet d'avenir. Il n'y aurait qu’un anathème pour les uns et un bon point pour les autres. Mais pas de main tendue aux premiers pour rejoindre les vertueux désignés, qui ne sont pas plus avancés. La différence entre le bon et le mauvais agriculteur doit être criante pour les spécialistes de la galinette cendr…ine.
Si « tout ce qui est excessif est insignifiant » selon Talleyrand, cette polémique et cette saillie de Sandrine "c’est pas le sujet quoi" Rousseau n’irait pas plus loin qu’une énième illustration de l’animosité avec laquelle la France agricole se sent maltraitée par les élus de la Nation. Même s’il s’agit d’un discours automatique, idéalisant la préservation de l’Environnement et diabolisant tout recours aux phytos chimiques (qui saliraient l’argent gagné selon la députée), ces propos oublient que sans l’entretien des parcelles agricoles et de leurs abords, les campagnes tiendraient de la friche plus propice à la propagation d'incendie qu'à l'expression de la biodiversité.
Sans volonté d’apaisement visible après sa phrase choc, Sandrine "ce n’est pas de la rentabilité en fait, c’est de l’argent sale" Rousseau déclare dans un communiqué être partisane d’un concept de « socialisation partielle » du revenu pour les agriculteurs et confirme que « l'objectif de l'agriculture n'est pas d'être rentable ». Reste que la paysannerie sait bien qu’il n'existe pas de déclarations d'amour, seulement des preuves d'amour. Et on serait bien en peine de dire quel parti politique a mis durant cette session parlementaire la priorité sur la révision d’Egalim ou l’utilisation de tout autre véhicule législatif pour assurer un revenu décent à une viticulture dans le dur. Malgré les dénégations et tentatives d’explication, le fossé ne peut donc que se creuser entre l’électorat de ville et l’électorat des champs. Ce dernier pouvant être fermé, pour ne pas dire hostile, à la volonté citadine d'imposer un cadre environnemental : les insultes sexistes et misogynes proférées en juin 2023 à l'encontre de la députée parisienne dans les vignes de l'Aude en témoignant douloureusement.
Il demeure que la réalité économique de la terre semble dans le meilleur des cas méconnue, dans le pire méprisée, et en toutes circonstances passée par pertes et profits. Un comble, alors que des prix d’achat toujours plus bas des vins défraient la chronique, pour les bio comme les conventionnels, accentuant la détresse des producteurs pour continuer à financer leur activité à défaut de pouvoir en vivre. On ne peut décemment mettre un tel vent à l’épidémie de suicides qui frappe et menace toutes les bouts de parcelles. Si « entre le sarcasme et l’ironie il y a la même distance qu’entre un rot et soupir » selon Hugo Pratt, entre le sandrinerousseauisme et le voltairianisme*, il y a le même fossé qu’entre une pétarade et une perle. « Mais quoi ! Loin de Paris se peut-il qu'on respire ?
Me dit un petit-maître, amoureux du fracas » rapporte Voltaire dans un poème sur l’Agriculture (épitre à Madame Denis, 1761), où il prend des airs bucoliques de Virgile : « La France a des déserts, ose les cultiver ;
Elle a des malheureux : un travail nécessaire,
Ce partage de l'homme, et son consolateur,
En chassant l'indigence amène le bonheur ».
Car « c'est ainsi qu'on peut vivre à l'ombre de ses bois,
En guerre avec les sots, en paix avec soi- même ». Alors, voltairien à péter ?
* : Si les philosophes Jean-Jacques Rousseau et Voltaire ne manquent pas de points d’opposition, ils partagent le même respect pour l’Agriculture. Le premier écrivant dans l’Émile que « l'agriculture est le premier métier de l'homme : c'est le plus honnête, le plus utile, et par conséquent le plus noble qu'il puisse exercer ». Le second affirmant dans le Sottisier : « on a trouvé, en bonne politique, le secret de faire mourir de faim ceux qui, en cultivant la terre, font vivre les autres ».