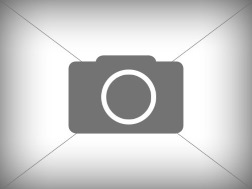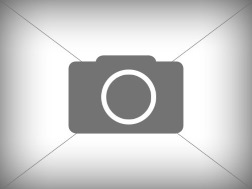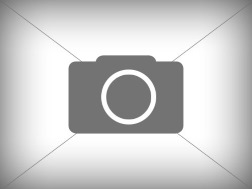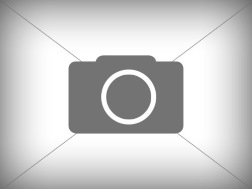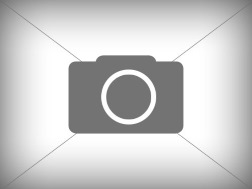l est entré à l’IFV de Nîmes (nommé à l’époque « l’ITV ») le 1er avril 1978 et n’en est plus jamais parti… Après trente-huit ans en tant qu’expert français en biologie des parasites et protection du vignoble, Bernard Molot a gagné le droit de prendre sa retraite. Il quittera donc définitivement l’Institut à partir du 1er mai prochain. C’est son collègue Éric Chantelot qui prendra sa suite. Mais après presque quarante années passées au contact du vignoble français, quel regard porte-t-il sur la viticulture vis-à-vis de l’usage des produits phytosanitaires ? Quels progrès, mais aussi quels échecs a-t-il connu ? Entretien avec ce spécialiste quelques semaines avant son départ définitif.
Bernard Molot : Trois grandes périodes ont marqué mon parcours. Quand je suis arrivé à l’IFV, en 1978, c’était encore l’aire du « tout chimique » : à un problème correspondait une solution chimique. À cette époque, il s’agissait pour moi de poser les premières pierres de la modélisation. En 1983, le premier modèle mildiou sortait. Les années 1980 correspondent donc à la période pendant laquelle ont été jetées les bases de la protection raisonnée ; on prenait conscience qu’il était possible de diminuer les quantités de produits utilisées. Lors des années 1990, la protection raisonnée était entrée dans les mœurs, avec la recherche de diminution des phytos, devenue une problématique de la filière. Au cours de cette décennie, nous avons réussi, grâce à la protection raisonnée (confusion sexuelle, auxiliaires pour la lutte insecticide, connaissance des seuils de nuisibilité, etc.) et à l’emploi des modèles maladies, à diminuer de 50 % les quantités utilisées au niveau français !
Concernant la troisième période enfin, les années 2000, l’objectif a été donné, par le plan « Ecophyto », de diminuer de 50 % l’usage des produits phytosanitaires… Mais nous savions que nous allions dans le mur. Refaire ce que l’on a déjà fait, on ne sait pas faire… Cet objectif est très difficile à atteindre. D’ailleurs, les derniers chiffres du ministère de l’Agriculture le confirment.
BM : Il y a encore une marge de manœuvre avec le réglage et la qualité de la pulvérisation de l’ordre de 20 à 30 %. Mais concernant les interventions, nous sommes rendus au minimum du minimum en terme de protection antimildiou et anti-oïdium. L’absence de solutions alternatives aux phytos dignes de ce nom me fait dire que nous sommes au bout de la baisse.
BM : Le bio n’est pas une alternative crédible à cause de la toxicité du cuivre. Trouvez-moi un produit de remplacement, et je signe tout de suite ! Le discours politique vis-à-vis du bio n’est pas rationnel.
BM : Nous sommes dans une période où l’attente est sociétale : vis-à-vis du consommateur, il faut supprimer tous les pesticides, et seul le bio est bon… C’est devenu irrationnel et parfois risible. La priorité ne devrait-elle pas être plutôt donnée à éduquer le consommateur lui-même ? Nous sommes tombés dans une paranoïa antipesticides et à deux doigts de connaître des impasses techniques, avec la menace de suppression des fongicides multisites antimildiou : folpel, mancozèbe, etc. Si on les enlève, qu’est-ce qui va rester ?
Les grands médias publient régulièrement des reportages à charge… Mais ce n’est pas du travail de journaliste : il ne s’agit pas d’enquêtes mais de véritables prêches. Les consommateurs sont donc sensibilisés sur ces aspects noirs, sans avoir conscience de l’évolution positive. Il y a donc un énorme besoin que la filière communique sur ce qui se fait dans le vignoble.
BM : Le grand ménage des produits phytosanitaires : les organochlorés, comme le lindane, et les organophosphorés. Il fallait le faire, cela a été très bénéfique. J’ai également pu constater l’augmentation considérable du niveau de formation des viticulteurs en deux générations. Les fils ou filles de vignerons qui s’installent aujourd’hui ont un bagage technique et scientifique qui est loin d’être ridicule ! Nous assistons à une véritable professionnalisation et à une spécialisation du métier.
BM : Mon plus gros constat d’échec, douloureux, est celui de la flavescence dorée. Nous en sommes réduits au même point qu’en 1983. La lutte contre cette maladie n’avance pas, je ne vois pas l’ombre d’une solution de remplacement des traitements insecticides chez nous.
BM : Je compte bien en profiter… Je vais voyager ! Je garderai une petite activité d’expertise si on a besoin de moi. Je conserve aussi toutes les bonnes adresses de vins que j’ai accumulées. Mon activité m’a permis de générer des amitiés durables et profondes avec des vignerons, à force de temps passé dans les caves ! En viticulture, les relations sont plus faciles à tisser que dans les autres filières agricoles, cela a été un aspect non négligeable de mon travail.