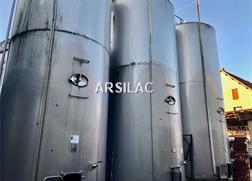En Europe et en France, les changements ont commencé à être significatifs au cours des trente dernières années. C’est alors que nous avons commencé à remarquer que les degrés alcooliques augmentaient, notamment dans le Sud, et qu’il y avait des étés relativement chauds par exemple. Quant à la prise de conscience par les viticulteurs, elle est difficile à situer dans le temps. Initialement, lorsque je parlais de changement climatique aux viticulteurs, ils réfutaient cette hypothèse. On évoquait surtout la variabilité du climat d’une année sur l’autre, mais pas de changement climatique. En dix ans, la situation a beaucoup évolué : le discours a changé plus particulièrement dès 2003, qui a été un véritable indicateur, notamment dans le Sud de la France. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, 2003 n’était pas la seule année chaude et sèche : 2004 et 2005 ont été des années très sèches dans le Sud et il y a eu des dégâts sur la vigne liés au stress hydrique. On a donc commencé à se poser des questions.
Assistons-nous à une accélération de ce phénomène ?
Il y a une accélération depuis la fin des années 80. Lorsqu’on fait une analyse statistique des données des températures des 100 dernières années, on constate une véritable rupture statistique vers la fin des années 80 avec une augmentation plus intense des températures.
Selon les projections du climatologue américain Lee Hannah, publiées en 2013, la surface viticole européenne se réduira de 39% au mieux et de 89% au pire à l’horizon 2050. Etes-vous d’accord avec ces prévisions alarmistes ?
Nous avons fait une réponse à son article. Ce que nous avons critiqué, c’est que son article était uniquement basé sur des sorties de modèles. Il avait affirmé, par exemple, qu’en 2050, il n’y aurait plus de viticulture dans le Bordelais. Or, il n’avait nullement pris en compte toute la capacité d’adaptation du vignoble. Nous avons répondu qu’en se basant sur ce même modèle, dès aujourd’hui, l’on ne pourrait plus faire de pinot noir en Bourgogne parce que ce cépage ne serait plus adapté au climat. Dans les faits, il y a une certaine plasticité pour s’adapter.
Quelles sont les zones viticoles dans le monde qui sont les plus touchées à l’heure actuelle ?
En Europe, c’est le Sud, principalement lié à des problèmes de sécheresse. Les vignobles d’Afrique du Nord souffrent de plus en plus. Aux Etats-Unis, la Californie également commence à connaître des difficultés, le déplacement du vignoble vers les côtes est là pour le démontrer. Dans l’Hémisphère sud, l’Australie est touchée, l’Argentine aussi, à Mendoza notamment. Ces difficultés sont liées à des problèmes de disponibilités en eau car la viticulture dans ces pays est tributaire de l’irrigation. La forte diminution des précipitations neigeuses sur les Andes a engendré une baisse significative du niveau d'eau des lacs de barrage. Comme l'eau vient en priorité pour la population, les restrictions d'eau ont été mises en place pour la viticulture. Cela engendre de nombreux conflits et les « gros viticulteurs » commencent à planter de la vigne dans d'autres régions où les effets du changement climatique sont moins néfastes, du moins au niveau des températures, le problème de l'eau restant encore présent. Ces zones se situent plus à l'ouest (Vallée de Uco) dans des secteurs plus en altitude afin d'avoir des conditions thermiques moins extrêmes. En France, nous ne sommes pas touchés de la même manière parce que nous avons la possibilité de faire de la viticulture sans irriguer.
Selon vous, quels sont les aspects du changement climatique qui menacent le plus la culture de la vigne ?
Le manque d’eau et l’augmentation des températures maximales sont les principaux facteurs concernés car ils engendrent une hausse des degrés alcooliques et des niveaux de sucre. Pour ce qui est des événements extrêmes, rien ne prouve encore que nous allons assister à une progression du nombre de phénomènes à cause du changement climatique. C’est encore à l’étude et cela reste des événements généralement localisés.
Dans votre livre « Changement climatique et terroirs viticoles », vous citez Vaudour qui évoquait en 2003 une frange supplémentaire de 100 km vers le nord dans chaque hémisphère vers 2020-2050. Etes-vous d’accord avec cette analyse ?
Encore une fois, il s’agit d’une analyse basée sur les limites théoriques de la vigne. Dans les faits, on s’aperçoit qu’il y a effectivement un déplacement du vignoble vers le nord à l’heure actuelle. Il suffit d’observer ce qui se passe en Angleterre ou au Danemark par exemple pour s’en convaincre. En Angleterre il y avait déjà de la vigne mais on constate une amélioration de la qualité des vins depuis vingt ans. Dans l’Hémisphère sud, les plantations en Patagonie ou en Tasmanie ainsi que le succès des vins néo-zélandais soulignent le déplacement du vignoble. De là à considérer qu’il se déplace à l’échelle décrite par Vaudour, cela reste très théorique.
Le développement de vignobles dans des pays comme le Royaume-Uni ou la Belgique tient-il uniquement du changement climatique ou de l’utilisation de clones/pratiques culturales plus adaptés ?
Certes, il peut y avoir d’autres facteurs, mais si je prends l’exemple de la région du Sussex en Angleterre, là où auparavant les vignerons observaient un ou deux bons millésimes tous les dix ans - les températures maximales n’arrivant pas à des niveaux suffisamment importants pour obtenir une bonne maturité – aujourd’hui, les blancs et les effervescents sont très intéressants. Ce n’est pas encore le cas des rouges.
Avez-vous constaté, jusqu’à présent, une délocalisation importante de vignobles vers des zones plus fraîches ou est-ce que cela reste plutôt anecdotique ?
En France, cela n’a pas été le cas parce que nous ne sommes pas encore dans des conditions extrêmes. Il y a des pays où, sans changement climatique, la viticulture est déjà compliquée. Citons la région de Mendoza en Argentine : sans irrigation, il n’y aurait jamais eu de vigne dans cette région désertique. Ainsi, on assiste à un développement important de la viticulture en altitude, surtout dans le Nord du pays, à Cafayate et Salta. Dans le même temps, on plante de plus en plus en Patagonie. En Afrique du Sud, les conditions étaient déjà à la limite et ces dernières décennies, on observe une remontée des plantations de vigne sur les versants des montagnes dans la région de Stellenbosch. Les conditions thermiques deviennent trop élevées dans les vignobles situés en plaine et vallée, les viticulteurs recherchent plus de fraîcheur plus en altitude. Enfin, en Australie, l'exemple le plus flagrant est la décision de viticulteurs du sud de planter de la vigne en Tasmanie afin de rechercher des conditions thermiques moins extrêmes en termes de vagues de chaleur et sécheresses.
A court et moyen terme, ils peuvent jouer sur les pratiques culturales – le travail du sol ou celui du végétal. On a eu des exemples avec l’été chaud en 2015, les vignerons ont beaucoup moins effeuillé de manière à garder de l’ombre sur les grappes. Pour prendre le cas spécifique de l’Argentine, la situation est plus complexe car si les gros producteurs se déplacent vers d’autres zones, les disponibilités en eau s’améliorent pour les petits producteurs qui restent. Dans la région de Mendoza, les gros producteurs avaient essayé de mettre en place un système d’irrigation au goutte à goutte mais l’expérience s’est soldée par un échec parce qu’il n’y avait plus lessivage et la salinisation des sols s’est développée.
Voit-on une évolution de l’encépagement ?
En France, des recherches dans le Bordelais se penchent sur les cépages du futur. On expérimente avec des cépages portugais, par exemple. En Argentine, aussi, une chercheuse de l’INV étudie tous les cépages. De notre côté, nous travaillons sur le Nord du pays pour voir comment les cépages actuels réagissent par rapport au changement climatique, notamment dans des vignobles en altitude, sachant que le développement de ces vignobles constitue l’un des objectifs des Argentins. C’est un axe marketing important pour le pays.
Dans quelle mesure le changement climatique provoque-t-il une recrudescence de maladies/parasites dans le vignoble ?
Pour l’instant, nous sommes encore dans le doute. Nous sommes incapables de savoir si, par exemple, les maladies du bois sont liées au changement climatique ou s’il n’y a pas de lien.
Vous préconisez une approche à échelle très fine pour aborder l’impact du changement climatique sur le vignoble mondial. Or, les décisions sont souvent prises à une échelle bien plus grande. Comment concilier les deux ?
Je coordonne un projet européen sur ce thème-là – le projet ADVICLIM – dont l’idée est de travailler à l’échelle d’appellations en Europe de manière à en ressortir des préconisations au niveau européen. Dans un contexte global de changement climatique avec des scénarios à horizon 2050-2100, on vise à élaborer des préconisations au niveau régional en intégrant l’aspect local qui parle beaucoup plus aux vignerons que l’aspect global.
Le changement climatique remet-il en cause tout le concept de terroirs développé depuis des siècles au niveau européen ?
Il fait évoluer le terroir mais le climat est l’une des composantes du terroir. Le climat varie mais sa variation ne date pas d’aujourd’hui – il y a cinquante ans il avait déjà un impact. La différence aujourd’hui c’est que l’évolution est beaucoup plus rapide et intense.
Au final, l’arsenal de techniques – dans le vignoble et en cave – semble suffisamment important pour lutter contre les effets du changement climatique en France, voire dans d’autres pays. Est-ce qu’on ne fait pas beaucoup de bruit pour rien ?
Pour citer un exemple, j’ai eu une discussion avec un vigneron dans l’appellation Quarts de Chaume. Il était ravi par l’augmentation de température au cours des trente dernières années parce qui cela lui permet d’arriver à un très bon niveau de maturité et d’observer une régularité dans les bons millésimes. Deux degrés de température supplémentaires ne posent pas de problème, mais à plus quatre degrés, comment cela se passe-t-il ? A cette température-là, le chenin n’est plus cultivable. Si on le remplace par un autre cépage, ce n’est plus du Quarts de Chaume. Actuellement, différentes pratiques culturales permettent de s’adapter au changement climatique mais une plantation de vigne se fait pour une durée minimum de trente ans, et le vigneron ne peut se permettre de se tromper. Il faut raisonner à court et à moyen terme mais aussi à long terme. Pour résumer, à horizon 2030 voire même 2050, il existe des méthodes qui paraissent utilisables. Au-delà, s’il faut changer de cépages et de localisation, nous ne parlons plus des mêmes produits.