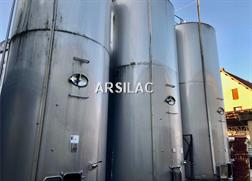Si un acheteur ne cherche que des prix, c’est simple : notre offre est morte ! » résume Isabelle Pangault, la nouvelle responsable oenologie et ambassadeur de la cave de coopérative languedocienne de Foncalieu (commercialisant la moitié de ses 250 000 hectolitres produits en vrac). Sur le salon international des vins en vrac d’Amsterdam, les exposants français ne se font pas d’illusion sur l’attractivité et la qualité de leurs concurrents d’Espagne, d’Italie et du Nouveau Monde. Mais si le modèle de production français ne peut pas les rendre compétitifs en terme de prix, il justifie un surcoût avec un discours de valeur ajoutée. « On sort de la guerre des prix en adaptant nos plans de vinification à la demande des marchés, en proposant des qualités constantes, et en quantité (sauf accident, comme l’an dernier…) » précise Isabelle Pangault.
« On a un différentiel de prix de 15 à 20 euros l’hectolitre avec les cours mondiaux du sauvignon blanc, du colombard… Si l’on challenge la qualité des vins néo-zélandais, on doit se battre contre les prix sud-africains. En espérant faire mieux qu’au rugby ! » lance Eric Lanxade, le directeur commercial des Caves et Vignobles du Gers (380 000 hl exclusivement en vrac). S’il plaisante, il n’en prend pas moins au sérieux l’arrivée des vins de l’Hémisphère Sud : « on a soudainement eu de vrais concurrents, ce qui est toujours bon pour réveiller le business ». En réaction à cette compétition sur le marketing et les prix, les vins de l’ancien monde ont dû faire peau neuve. Et « rendre compatibles les avantages et inconvénients d’une production non délocalisable » explique Eric Lanxade.
Si le vignoble français est géographiquement ancré, il ne lui est pas interdit d’évoluer. Notamment avec la catégorie des Vins de France (ou Vins Sans Indication Géographique). « Il ne faut pas avoir peur d’aller vers des profils plus modernes et sortir des sentiers battus » avance Julie Fernandez, la responsable export du négociant méditerranéen Raphaël Michel (800 000 hl traités en vrac chaque année, en Languedoc-Roussillon, Provence, Vallée du Rhône…). « Les AOP et IGP doivent évidemment conserver leurs identités, mais il faut être à même de répondre aux exigences de nos clients avec de la thermovinification des rouges, des profils aromatiques thiolés pour les blancs… A la néo-zélandaise. »
« Ici, on parle de profils produits, entre professionnels » ajoute Philippe Hébrard, le directeur général de la cave coopérative bordelaise de Rauzan (80 % de ses 165 000 hl d’AOC Bordeaux vendus en vrac). Présentant des vins 2015 en cours de vinifications (ni collés, ni filtrés, ni même assemblés), il organise une sorte de primeurs avant l’heure. Avec un positionnement sur le haut de gamme du vrac. « On n’est pas là pour écouler des produits, on est là pour présenter les produits le plus en amont de la campagne, pour stimuler les achats » explique Philippe Hébrard. « Il est intéressant de voir hors de la place, pour avoir la perception extérieure de nos rapports qualité-prix. Et souvent, on nous dit que l’on ne pensait pas que Bordeaux était aussi accessible… »
Sur l’année mobile s’achevant en juin 2015, le cours moyen des vins français exportés en vrac s’est élevé à 132 €/hl. Ce qui est loin derrière les performances néo-zélandaises (246 €/hl), mais devant celles allemandes (123 €/hl), américaines (114 €/hl), argentines (82 €/hl), italiennes (72 €/hl), espagnoles (37 €/hl)…