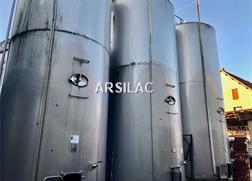e Languedoc comptait 10 appellations en 1982, il en compte 50 aujourd'hui. Pourquoi une telle progression ? Ces appellations n'ont pas fleuri parce que chaque commune du Languedoc a voulu son appellation, cette floraison d'AOC/AOP correspond à une réelle progression de la qualité de la production en Languedoc sur les trente dernières années.
Sur le socle de son appellation régionale (AOC Languedoc), le Languedoc s'est doté d'appellations correspondant à autant de zones climatiques et géologiques identifiées (AOC Carbardès, AOC Clairette du Languedoc, AOC Corbières, AOC Faugères, AOC Fitou, AOC Malepère, AOC Muscats (de Frontignan, Saint-Jean de Minervois...), AOC Saint-Chinian...) .
Au sein de ces appellations (dont certaines demeurent très vastes et variées), les efforts des producteurs et leur connaissance de leur terroir ont permis d'isoler des terroirs spécifiques depuis reconnus comme des appellations :
Minervois la Livinière a ouvert le bal en 1999, située au nord du Minervois sur les contreforts de la Montagne Noire, dotée d'un climat plus frais et plus venteux que le sud du Minervois qui permet des maturations plus lentes des raisins et donc des arômes différents et des structures plus denses qui justifient cette distinction géographique et qualitative.
2005 a vu la reconnaissance de Corbières-Boutenac (où les vieilles vignes de Carignan sont reines), de Saint-Chinian-Berlou et de Saint-Chinian-Roquebrun, qui correspondent à deux villages au nord de l'appellation Saint-Chinian, qui font presque déjà partie du massif des Cévennes.
Dans la continuité de sa stratégie de hierarchisation des vins des appellations du Languedoc, l'Interprofession (CIVL) entend poursuivre ce mouvement.
Quels seront les prochains terroirs reconnus au sein des appellations du Languedoc ?
Le CIVL a confié à Matthew Stubbs MW la tâche de présenter quatre cas à l'étude.
Cazelles en Minervois : un climat à part pour un terroir à rouges comme à blancLe Minervois est l'une des plus grandes appellations du Languedoc et ne connaît pour l'instant qu'un terroir identifié de plus près en son sein, qui est celui de la Livinière. Cazelles mérite également l'attention, avec une aire de production située sous le plateau de Saint-Jean de Minervois, au nord-est de l'appellation, sur les contreforts de la Montagne Noire, à 200 mètre d'altitude sur un plateau argilo-calcaire avec de l'eau à 4,5 m sur un sol calcaire tendre et friable qui favorise les infiltrations d'eau et l'enracinement jusqu'à ces réserves. C'est un terroir ensoleillé mais frais et venteux.
Pour l'illustrer, nous avons choisi la cuvée Roc de Bô en blanc, du Château Cabezac (35 hectares de vignes à Cazelles).
On note sur cet assemblage de Grenache Blanc (notes d'agrumes et texture onctueuse) et de Roussane (qui donne les notes délicates de êche blanche et de chevrefeuille) toute la fraîcheur apportée par le terroir : l'altitude, qui lui confère l'acidité et la finesse dans la définition des arômes.
En rouge, Matthew Stubbs MW présente le domaine La Ciaude de la célèbre vigneronne bourguignonne Anne Gros, qui a choisi ce terroir pour venir de Vosne Romanée s'associer à Jean-Paul Tollot et travailler les rouges en vendange manuelle, les macérations se font en cuve inox ouverte avec pigeage manuel, les fermentations sont faites pour moitié par levures indigènes, l'élevage en bois neuf dure 12 mois. « Devant cet assemblage de Grenache, Carignan, Syrah, on attend de la puissance, on a de la finesse et de l'élégance, une puissance subtile et retenue : il est plus facile d'être soit puissant soit léger, ce vin atteint l'idéal d'une complexité qui emprunte aux deux registres. On a indiscutablement affaire à un vin de soleil né en Languedoc, mais il a en plus pour lui la marque fraîche du terroir (ce plateau calcaire en hauteur et face au vent).
En rouge comme en blanc, les vins de Cazelle se distinguent et la reconnaissance de ce terroir spécifique serait une bonne nouvelle pour le Minervois, qui est une grande appellation (5 000 ha) et qui pourrait bénéficier de la reconnaissance d'un deuxième grand terroir pour accompagner la progression de la qualité de sa production.
Sommières : déjà une dénomination complémentaireSommières ne produit que des vins rouges, c'est le terroir le plus au nord-est du Languedoc, compris intégralement dans le département du Gard. Ce n'est pas une appellation à elle-seule puisque la mention Sommières est une Dénomination Géographique Complémentaire de l'appellation AOC Languedoc-Sommières. Pour ajouter Sommières à l'AOP Laguedoc, les producteurs doivent respecter un cahier des charges précis qui requiert notamment un élevage minimum de 15 mois (qui n'est pas nécessairement fait sous bois)
L'aire de la dénominaiton Sommières couvre 250 ha sur 18 communes. Les cépages amjoritaires (Syrah, Grenache, Mourvèdre, minimum 70 %) et minoritaires (Carignan, Cinsault, maximum 30 %) ont moins la différence avec d'autres appellations que l'influence des Cévennes qui creuse l'amplitude thermique jour/nuit et l'influence du mistral (on est plus près du Rhône que des Corbières et de la tramontane), ainsi que le sol friable de calcaires et d'éboulis. Toutes ces particularités font de Sommières un très sérieux prétendant à l'accession au titre de
Le vin du Château l'Argentier illustre ce contraste avec une syrah très mûre, très savoureuse et épicée, un fruit de cerise rouge et noire, une maturité affirmée, relevée par une belle acidité en finale. Cette faîcheur épicée est renforcée par les notes de garrigue qui font l'identité essentielle des vins du Languedoc, leur marqueur immédiatement perceptible et reconnaissable
Corbières-Durban : poursuivre la qualification des terroirs des CorbièresL'appellation Corbières est la plus grande (14 000 ha) et donc, peut-être, la plus hétérogène des appellations du Languedoc. Sur de trop nombreux marchés, des vins à bas prix ont associé, dans l'esprit du consommateur, cette appellation à des vins rustiques aux tanins durs. A l'heure actuelle, les Corbières redécouvrent leur potentiel et la diversité de ses vins, directement reliée à celle de ses sols, que l'auteur James E.Wilson, dans son ouvrage Terroirs, qualifie de « cacophonie géologique »
La zone de Corbières-Durban s'étend sur 1400 ha compris entre le Pic de Pied de Poul (600 m) à l'ouest, qui bloque les influences maritimes et le Pic Saint-Victor à l'ouest, qui protège de la tramontane. Les sols sont schisteux et donc très draînants mais mâtinés de calcaire fracturé, qui permet un enracinement profond et la constitution de réserves d'eaux essentielles contre la sécheresse dans une zone de faible pluviométrie (449 mm/an, à la limite de survie de la vigne ; par comparaison, le Pic Saint-Loup reçoit 900 mm/an).
La zone reçoit annuellement 2613 heures d'ensoleillement, 200 jours de tramontane (vent de secteur Nord-Ouest) et 100 jours de marin.
Au cœur de cette zone, se trouve la cave coopérative d'Embres et Castelmaure, célèbre pour la qualité de sa production. Cette cuvée N°3 se distingue par son fruit très noir et gourmand, presque fumé, gras, dense et toasté, très long en bouche. Son côté sauvage ait son charme.
C'est un vin à vous faire changer d'avis du tout au tout si vous imaginiez que les Corbières ET les caves coopératives étaient incapables de glamour !
Faugères : du terroir schistes au Grand TerroirL'appellation Faugères couvre 2000 ha, en AOC depuis 1982, partagée entre 85 % de rouge 13 % de rosé et 2 % de blanc.
Sur les contreforts des Cévennes, à une altitude de 450 mètres, dans un climat venteux, Faugères doit cependant sa typicité à son sol de schistes, qui procure à ses vins toute leur intensité tout en leur conférant une réelle fraîcheur. Autre élément essentiel de al typicité de Faugères : un volonté collective de bien faire et de tirer la qualité vers le haut, partagée par sa cave coopérative et les 53 vignerons indépendants de l'appellation. Et des initiatives inédites, comme celle de Ludovic Aventin, créateur du Mas Angel aux côtés d'Angel Salvi, dont le grand-père, Marius, a planté les vignes du Mas Angel, sur la Montagne de Faugères. Le Mas Angel est détenu en copropriété par des rugbymen, dont Sylvain Marconnet et Pieter de Villiers et produit des cuvées caritatives comme la cuvée Marius, dont les bénéfices sont reversés aux hôpitaux pour enfants malades.
Les prochaines étapes pour la reconnaissance des terroirs du Languedoc sont la constitution d'un dossier de candidature qui devra ensuite être validé par l'INAO. Problème de vocabulaire : l'INAO a déjà fait savoir qu'il ne saurait être question de « crus », les Dénominations Géographiques Complémentaires ne sont satisfaisantes qu'un temps, comme le montre le cas de Sommières, le CIVL s'interroge donc dès aujourd'hui sur la bonne place à attribuer à ces appellations en devenir dans la hiérarchie des vins du Languedoc.