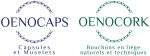Sans doute parce qu'il s'imagine que c'est la Nature qui fait le vin, le profane reçoit mal les mots qui suggérent de manière trop précise une ingérence de la main de l'homme » avançait Emile Peynaud dans son ouvrage le Vin et les Jours (Bordas, 1988). Le père de l'œnologie moderne soulignait que le vigneron était lui-même à l'origine de cette image d'Epinal, « banissant soigneusement de son vocabulaire commercial les mots suspects ». Ce mythe vitivinicole serait (entre autres) à l'origine des réticences de la filière vin à s'approprier les innovations techniques, préférant l'amélioration discréte à la rupture affichée.
Mais face aux enjeux d'avenir de la filière vin (réduction des intrants, changement climatique...), il semble que cette stratégie doive être révisitée. Sinon le jeu de dupes avec les consommateurs pourrait se conclure par un retour de bâton, avec la soudaineté de théâtre de Guignol. « Il ne faut plus faire croire aux consommateurs que la vigne et le vin sont étanches à l'innovation. » tranchait Hervé Hannin, en cloture de la sixième journée scientifique de l’Institut des Hautes Etudes de la Vigne et du Vin (Montpellier). « Sans innovation, la crise du phylloxéra aurait été fatale au vignoble il y a 140 ans, de même pour surmonter la crise de 1907, pour développer les vins bio... » Ces remarques sont soutenues par la publication d'une tribune, qui plaide pour une stratégie de filière audacieuse (car innovante) et un rapprochement de la production avec la recherche. Si ce manifeste est ancré dans le Languedoc-Roussillon, il touche bien toutes les régions de production françaises. En attendant vos commentaires, rappellons que la tradition est une innovation qui a réussi. Ou pour citer Jean Jaurès, « la tradition c'est comme une flamme. Il faut en garder les braises et non les cendres ».
Voici ci-dessous l'intégralité de la tribune « Viticulture du Languedoc-Roussillon : Innover ou disparaître ? », signée par Hervé Hannin (directeur de l'IHEV, photo) et Jean-Marc Touzard (directeur de recherche à l’INRA, co-animateur du programme national sur l’adaptation des vignobles au changement climatique).
Le changement climatique qui mobilise la recherche scientifique depuis plusieurs années commence à secouer le monde viticoleUne étude récente publiée dans la Revue de l’Académie des Sciences des Etats-Unis (Hannah et al., PNAS 2013) prévoit en effet que « 68% des surfaces en vigne de l’Europe méditerranéenne ne seront plus aptes à la production de vin en 2050 ». En France, les vignobles du Languedoc, du Roussillon et de Provence, sans doute les premiers concernés, connaissent déjà les effets de ce changement : depuis les années 80, les vendanges y sont en moyenne plus précoces d’une quinzaine de jours ; les déficits hydriques de la vigne se sont accentués durant les périodes estivales, ce qui influe sur les rendements et le potentiel qualitatif des raisins ; les vins ont vu leur profils se modifier, avec notamment une augmentation du taux d’alcool et une moindre acidité ; enfin les conditions climatiques variant davantage d’une année à l’autre, les effets millésimes sont plus prononcés. Ces évolutions vont s’accentuer au cours des prochaines années. Y aura-t-il encore de la vigne en Languedoc Roussillon en 2050 ?
Pour autant, de multiples leviers d'adaptation existent, déjà expérimentés par les viticulteurs ou étudiés par les chercheurs :planter de nouveaux cépages plus tardifs et résistants à la sécheresse; choisir des parcelles moins exposées, bénéficiant d’une plus grande fraicheur ou de réserves hydriques plus importantes ; changer les modes de conduite de la vigne, en régulant l’ombrage par exemple ; irriguer en raisonnant les apports en eau selon les besoins qualitatifs ; adapter les pratiques œnologiques pour réduire les taux d’alcool et orienter les profils aromatiques… Les combinaisons entre ces innovations démultiplient encore les solutions possibles pour s’adapter aux nouvelles conditions climatiques. Elles concernent tous les vins depuis les vins de terroirs jusqu’aux plus technologiques ou standardisés.
Mais au fait, pourquoi se préoccuper du maintien de la viticulture en Languedoc ?L’arrachage définitif a réduit de moitié la surface du vignoble en 25 ans et les viticulteurs ne sont plus qu’une minorité professionnelle dans les villages. Non, la vigne et le vin conservent un rôle stratégique en Languedoc-Roussillon: la viticulture y est un des rares secteurs exportateurs, qui injecte de la valeur dans son économie; elle a des effets positifs importants sur le tourisme, autre secteur stratégique, à travers sa contribution aux paysages, au patrimoine culinaire et culturel, à l’attractivité et l’identité du territoire ; la viticulture reste aussi un secteur intensif en travail, qui induit près de 100 000 emplois directs et indirects (selon une étude réalisée en 2009), et peut jouer un rôle d’inclusion sociale dans une économie résidentielle exposée au chômage.
S'adapter au changement climatique est alors pour notre vignoble un défi supplémentaire, mais pas insurmontableSon histoire depuis plus de 2300 ans est une succession continuelle d’adaptations aux évolutions de son environnement naturel, économique et politique. Faut-il rappeler comment il s’est sorti fièrement de la crise phylloxérique, puis des crises de surproduction à commencer par le terrible épisode de 1907 ; comment il a engagé à partir des années 1980 une révolution de la qualité et conquis de nouveaux marchés consommateurs, parfois de pays lointains comme la Chine ; comment il répond de mieux en mieux aux demandes de pratiques plus respectueuses de l’environnement, et en produits labellisés « biologiques » (20 000 hectares en bio et reconversion en 2012, première région viticole française)? Dans tous les cas, son adaptation a résulté d’un mouvement social d’innovation technique et organisationnelle. Or aujourd’hui le potentiel d’innovation est remarquable en Languedoc-Roussillon : la grande diversité des terroirs, des styles de vin et des viticulteurs favorise aujourd’hui une multiplicité d’expériences, de pratiques et connaissances, assez unique en France ; la région dispose aussi de l’une des concentrations les plus importantes au monde de chercheurs et d’enseignants-chercheurs impliqués sur la vigne et le vin ; des entreprises innovantes intervenant en amont ou en aval de la production du vin ont réussi à s’implanter, à se fédérer et ouvrent leur activité à l’international. Un tel potentiel ne demande qu’à être activé.
Les professionnels de la filière sont désormais engagés dans de nouvelles démarches qui devraient favoriser l'innovationCertes les difficultés de valorisation du vin limitent les capacités de financement de l’innovation, mais en réponse au travail de prospective impulsé par le Conseil de bassin présidé par le Préfet de région, les professionnels n’ont-ils pas choisi de construire ensemble une « viticulture plurielle » ? Les interprofessions ne se sont-elles pas engagées à former une organisation commune capable de renforcer les nombreuses collaborations initiées entre viticulteurs, entreprises, instituts techniques, centres d’enseignement et de recherche. Ce sont ces liens de coopération qui constituent le principal levier d’adaptation. L’urgence est donc de les renforcer par une Stratégie Régionale de l’Innovation et le renouvellement des politiques structurelles européennes. C’est à ce prix que le vignoble languedocien se renouvellera et s’épanouira en 2050, contredisant les prévisions des chercheurs américains. Certes les changements climatiques annoncés paraissent importants car d’une ampleur encore inégalée, mais en impulsant une nouvelle fois un grand mouvement d’innovation, les vignerons et leurs alliés sauront s’y adapter et faire de la région l’un des foyers majeurs de la nouvelle économie mondiale du vin.