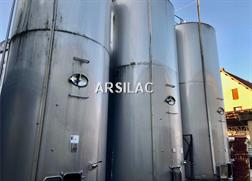e conseil national du réseau CER France, qui réunit des centres comptables et de gestion dans tous les vignobles du territoire, a rendu publics les résultats de la cinquième édition de son observatoire de la santé financière des exploitations viticoles,financé par France AgriMer. Les données étudiées concernent la campagne de commercialisation de la récolte 2009, qui va de septembre 2009 à août 2010.
Les exploitations étudiésLe baromètre comprend 500 exploitations réparties à raison d’une cinquantaine pour chacun des départements Maine et Loire, Loire Atlantique, Gironde, Gers, Tarn, Aude, Gard, Drôme, Var et Saône et Loire. La plupart des grands vignobles sont donc représentés, sauf la Champagne et la Cognac, dont les cas sont trop particuliers et fausseraient les conclusions finales.
Ces 500 entreprises se répartissent entre viticulteurs en cave coopérative (165), vraqueurs (139) et embouteilleurs partiels ou totaux (186). Dans chacune des catégories, sont faites des distinctions selon le produit viticole par hectare : pour les coopérateurs, moins (groupe « Coop1 ») ou plus (« Coop2 ») de 4130 €, pour les vraqueurs, moins (« Vrac1 ») ou plus (« Vrac2 ») de 4800 €, pour les metteurs en bouteilles, moins de 10020 € (« Condt1 »), entre 10020 et 16500 € (« Condt2 »), plus de 16500€ (« Condt3 ») par hectare. Les valeurs retenues sont des valeurs médianes de revenu, qui permettent de classer les domaines en groupes à peu près égaux.
La surface des exploitations étudiées se situe entre 20 et 30 hectares, on s’intéresse donc ici à des viticulteurs professionnels. Par catégorie, les rendements par hectare et la main d’œuvre utilisée sont assez variés, cette dernière allant par exemple de 1,9 personne en moyenne pour le groupe Coop1, à 8,5 pour les Condt3.
La rentabilité des exploitationsLes experts comptables ont, pour chaque catégorie, calculé le produit viticole moyen, le prix de vente par hectolitre, le résultat courant après déduction des charges, et déduit de celui-ci une rémunération standard de l’exploitant (égale à 17700€, soit 1,5 smic brut) pour estimer le résultat économique, ce qui reste au bout du compte.
On constate que chez les coopérateurs, ceux qui touchent moins de 4130 €/ha (Coop1) vendent leur vin en moyenne à 52€/hl, perdent de l’argent (plus de 16000€ à l’hectare), et il manque 11€/hl à leur revenu pour qu’ils atteignent l’équilibre final après s’être rémunérés. La situation est semblable chez les vraqueurs dont le produit est inférieur à 4800€/ha (Vrac1), et chez les metteurs en bouteille dont le produit est inférieur à 10200€/ha (Cond1).
Les vraqueurs qui sont au-dessus du seuil médian (Vrac2) arrivent juste à l’équilibre, tandis que les coopérateurs au-dessus de 4130 €/ha (Coop2) ont un résultat économique final positif de 10€/hl, semblable aux metteurs en bouteille de la catégorie moyenne (Condt2). Seuls les metteurs en bouteille dont le produit est supérieur à 16500 €/ha (Condt3) se situent franchement au-dessus du lot, avec en moyenne 53€ par hl vendu restant au final, après rémunération de l’exploitant.
Selon les experts comptables, tandis que les catégories Coop1 et Vrac1 vendent en-dessous de leur coût de production, les Coop2 sont situés sur des appellations à plus haute valeur ajoutée, et/ou ont consenti des efforts commerciaux de longue date. Quant aux embouteilleurs, les deux premières catégories sont dans des situations où la part de la production vendue en vrac est souvent déficitaire, et les efforts commerciaux pour la vente en bouteilles s’amortissent sur un nombre encore insuffisant de cols.
La crise 2004-2009Sur la période couverte par les cinq éditions de l’observatoire du réseau, seuls les embouteilleurs de la catégorie située au dessus de 16500€/ha (Condt3) ont été bénéficiaires tous les ans. La catégorie intermédiaire des embouteilleurs (Condt2) a connu un déficit uniquement en 2008.
Viennent ensuite deux groupes :
-Les Coop2 et les Vrac2 qui ont surtout souffert de déficits en 2004-2006, et ont vu leur situation se rétblir à partir de 2007 ;
-Les Coop1, les Vrac1 et les Condt1, soit 219 exploitations ou 43% de l’échantillon, qui subissent en moyenne des déficits tous les ans depuis 2004.
Le CN CER complète cette vision de la crise en précisant que, en décembre 2009, le prix des Mercuriales autant pour les IGP Merlot rouge (57,8€/hl), pour les vins sans IG rouges et rosés (45,7€/hl), pour l’AOC Côtes du Rhône rouge (98€/hl) ou encore le Costières de Nîmes rouge (75,8€/hl), ne couvraient pas l’essentiel des coûts de revient pour la quasi-totalité des exploitations étudiées.
La stratégie financière des exploitantsQuand le viticulteur est en déficit, ce dernier se reporte dans le bilan de son entreprise, dont les fonds propres diminuent, sauf apport d’argent extérieur. Quand a contrario il réalise un résultat positif, le viticulteur dispose de trois possibilités : soit investir dans du matériel sans avoir recours à l’emprunt (autofinancement), soit augmenter les capitaux propres, soit enfin prélever de l’argent à titre privé.
En observant les comportements des entreprises qu’ils suivent, les experts comptables en ont déterminé quatre grands types :
-le « déclin » : le bilan se dégrade, et il n’y a pas d’investissement ;
-la « croisière » : pas de dégradation mais pas d’amélioration du bilan, et un degré minimum d’investissement juste pour renouveler l’équipement ;
-le développement : on privilégie le renforcement du bilan sur l’investissement (comportement de placement financier);
-le développement rapide : on privilégie l’investissement dans l’appareil de production sur le renforcement du bilan.
Sur les campagnes 2007 à 2009, l’observation des catégories citées précédemment permet de diagnostiquer que 24% des Coop1, soit 12% des coopérateurs étudiés, sont en situation de « déclin », de même que 34% des Vrac1 (soit 17% des vraqueurs étudiés) et 12% des Condt1 (soit 4% des metteurs en bouteilles étudiés). 13% des Vrac2 sont cependant aussi dans ce cas. Au total, 14% des exploitations de l’échantillon de 500 entreprises sont sur trois ans dans cette situation de dégradation de bilan sans investissement, avec une situation particulièrement préoccupante pour les vraqueurs dans leur ensemble.
Quant aux autres entreprises, 43% sont dans une situation de croisière, 28% sont en situation de développement, et 14% en développement rapide.
Enfin, quand on étudie l’évolution des capitaux propres des entreprises à la fin de la campagne 2009-2010, on s’aperçoit que la catégorie dont la capitalisation baisse le plus vite est celle des Vrac1, tandis que les Coop1, même s’ils gagnent peu ou perdent de l’argent, arrivent à en limiter l’impact sur leur bilan. A contrario, les Coop2, s’ils gagnent plus d’argent que les Vrac2, en consacrent moins à augmenter les capitaux propres de l’entreprise. Enfin, au sein des metteurs en bouteilles, même si les deux catégories supérieures de revenu sont en situation de profit, celui revient à 75% pour les Condt2 et 80% pour les Condt3 dans les capitaux propres (sous forme d’investissement ou de placement), le prélèvement à titre privé étant donc limité à moins d’un quart du profit (toujours après rémunération).
Quelques idées de stratégieL’étude se termine sur quelques pistes esquissées pour permettre aux exploitations les plus menacées de retrouver le chemin de la rentabilité.
D’une part, le chemin de la réduction des coûts semble déjà avoir été bien utilisé par les entreprises suivies par les experts comptables. Pour beaucoup, c’est donc uniquement du côté de l’augmentation des revenus que le salut réside.
Il faut espérer que la remontée des prix de la campagne actuelle va permettre mécaniquement à certaines entreprises d’améliorer leur situation, mais les cours sont encore à des niveaux peu élevés sur des séries de long terme. Pour beaucoup, c’est donc un changement de stratégie qui s’impose. Pour les coopérateurs et vraqueurs, le passage à la mise en bouteille est un développement coûteux, qui ne donne des résultats qu’à moyen et long terme : en effet, les experts comptables estiment que dans le coût d’une bouteille rentrent pour un tiers les coûts de production du vin, pour un tiers ceux du conditionnement, et pour un dernier tiers ceux de la commercialisation. Passer du vrac à la bouteille, c’est donc multiplier les coûts non par deux, mais par trois, ce qui est difficile à faire en période de trésorerie insuffisante et de capitaux propres faibles.
Pour beaucoup, l’amélioration à court terme passe donc plutôt par une augmentation des rendements à l’hectare : quand on observe les rendements des catégories étudiées, les Coop1 ont une moyenne de 58hl/ha alors que les Coop sont à 66hl/ha, les Vrac1 sont à 57hl/ha contre 62hl/ha pour les Vrac2, et les Condt1 présentent 50hl/ha contre 53hl/ha pour les Condt2. Seuls les Condt3 arrivent à concilier réussite économique et rendements faibles, avec une moyenne de 49hl/ha.
Une conclusion qui paraît évidente sur le papier, mais qui ne l’est pas autant dans les faits, en période de sécheresse et de réduction des intrants…