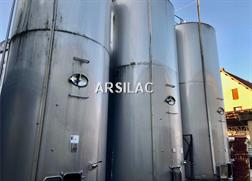lotte dans l'actualité de cette semaine un air de provocation. Tandis que l'Europe a renoncé au rosé coupé, un Anglais, David Cobbold, chroniqueur vin sur BFM, propose dans son blog une recette : « comment faire un (bon) vin rosé ? Après avoir expliqué dans son livre la déchéance gastronomique de la France, Michaël Steinberger fait l'éloge de la notion française de terroir. Tandis que les trublions du club « L'honneur du vin » ont fait mettre au pilon les 70 000 exemplaires de la brochure de l'Inca affirmant, entre autres, que le premier verre de vin est cancérigène, un blogger blagueur s'est amusé à compiler les dépêches de l'Agence France Presse liées au vin et à la santé. Les Italiens se découvrent à leur tour aussi fraudeurs. Buveurs et ripailleurs, les Gaulois n'en entretenaient pas moins une relation au vin ambiguë. A chacun son miel.
Catherine Bernard
C'est par le blog de la revue belge in vino veritas , que je suis arrivée à cette information qui n'en est pas vraiment une, mais traduit l'ambivalence, et du débat sur le rosé, et de la dégustation à l'aveugle. David Cobbold, citoyen britannique, auteur de livres sur le vin et chroniqueur sur la radio BFM propose donc sur Eccevino sa recette pour « faire un (bon) vin rosé ». A mon tour, je vous la livre : « Prenez un bon blanc du sud, de Vacqueyras par exemple, dans une proportion d'environ 85% de la mesure requise. Puisque ce vin manque un peu de peps (acidité), ajoutez un bon 10% d'un blanc bien vif, du type Bourgogne Aligoté. Enfin, pour donner de la couleur et une pointe de fermeté à votre rosé d'assemblage, 5% d'un bon rouge de Provence fera l'affaire. Attention, si votre rouge est très coloré, il faudra tempérer un peu cette dernière proportion, selon la tonalité que vous souhaitez obtenir ». Il poursuit : « Est-ce une blague ? », Et répond : « pas du tout. Je l'ai testée récemment sur un groupe d'élèves d'un des mes cours sur le vin. ». Je vous laisse lire la suite, mais d'emblée, on la devine. Non seulement les élèves n'y ont vu que du feu, mais en plus ils ont préféré le « mélange » de David Cobbold au rosé traditionnel.
Terroir ou pas terroir ?La semaine dernière, je vous invitais à vous plonger dans la lecture de l'essai sur la gastronomie de Michael Steinberger (Au revoir to all that), chroniqueur du site américain d'informations générales Slate. La version française de Slate propose cette semaine un article de ce même Michael Steinberger faisant l'éloge du vin français. Ne cherchons pas à comprendre, lisons, et surtout rassurons-nous. Sa chronique commence ainsi : « Ne foulons pas aux pieds le sort de la France ; malgré ses déboires, dans le domaine du vin elle se maintient au sommet, et elle n'est sans doute pas près d'être détrônée ». Ouf ! A nous qui doutons, il dit mieux encore : « Pourquoi les Français font-ils du si bon vin ? L'une des raisons est qu'ils en font depuis bien plus longtemps que nous. Mais comme de nombreux amateurs, je suis convaincu que c'est également un produit de la philosophie qui guide leurs efforts. Au cœur du système vinicole français repose le concept de terroir[1] : l'idée que le vin est principalement un produit de l'environnement physique (la terre, le microclimat) dans lequel le raisin a poussé, et que marier le bon cépage et le bon sol est la première étape essentielle vers un vin de qualité. Un vin ne doit pas se contenter d'être bon : il doit aussi dégager un sentiment d'appartenance géographique. Cette idée, née en France au Moyen-âge, est restée le principe de base de la viticulture française ». Je retiens aussi ce beau mot qui, mieux qu'une traduction de notre mot « terroir », réputé intraduisible, en est tout à la fois une interprétation et une appropriation : « somewhere-ness » (quelque partitude). Dans le même temps, il faut hélas aussi lire les résultats d'une enquête dont les résultats sont commentés par Rebecca Gibb dans Decanter cette semaine: « Moins de la moitié des consommateurs de vin britanniques pensent que la région d'origine est importante dans l'achat d'un vin ». Il s'agit d'un sondage commandé par la Spirit Trade Association. « Ils accordent de l'importance au profil du goût du vin, au cépage, clairement identifiable au goût, la buvabilité et un juste rapport qualité/prix ». Ce n'est pas très réjouissant, mais c'est aussi la réalité.
Pieds de nezFondé après la publication par l'Institut national contre le cancer (Inca), le club Pour l'honneur du vin remporte « sa première victoire », annonce le site Agriculture environnement. En voici les termes : « les 70.000 exemplaires de la brochure ?Nutrition & Prévention des cancers : des connaissances scientifiques aux recommandations?, réalisée par le réseau National Alimentation Cancer Recherche (NACRe), qui affirme que le risque de cancer s'accroît dès le premier verre d'alcool, n'ont jamais été envoyés aux médecins ». Par décision de justice, la brochure, objet de polémique au printemps, a donc terminé sa vie au pilon. Pendant ce temps, mine de rien, un blogger blagueur, Ivan Couronne, jeune journaliste à l'Agence France Presse, s'est amusé cette semaine à compiler dans son blog les dépêches publiées par son agence sur le vin et ses impacts sur la santé depuis cinq ans. Alors bon ou mauvais le vin ? Son commentaire est sobre : « La majorité des articles assure que le vin permet de vivre plus longtemps, sans cancer et avec une bonne mémoire. Quelques études montrent le danger du vin dès le premier verre. Et bien sûr, des petits malins font des rapports qui prouvent, au choix, que leur alcool est bon (Sardaigne, Bordeaux) mais que celui du voisin (Géorgie) est mauvais. Chacun trouvera dans cette liste l'argument qui lui convient pour le prochain débat enflammé à table?. Le déroulé factuel qu'il propose donne le tournis. Je ne retiens que deux exemples : Risque pour la santé dès le premier verre: un rapport qui fait débat (25 avril), ou bien Combattre le cancer avec des noix, du vin et des pamplemousses (21 avril).
Mauvaise limonade dans le BrunelloJe ne lis pas bien l’Italien, mais il me semble comprendre que la limonade a le goût des vrais-faux pinots languedociens, ou des Beaujolais chaptalisés. Le quotidien La Republica révèle dans son édition du 19 juillet que 130 000 hl (au lieu de 1,3 millions, aprés rectificatif de notre lecteur!) de Brunello rouge de Montalcino, appellation (DOCG) phare de Toscane a été déclassé pour cause de fraude sur l’origine des raisins, des cabernet sauvignon et des merlot ayant été substitués au san giovese, seul cépage autorisé, entre 2003 et 2007. L’émoi ne serait peut-être pas si grand en Italie si la fraude ne concernait pas aussi des maisons prestigieuses : Banfi, Argiano, Frescobaldi, Antinori, Casanova dei Neri. Le site vineux lavinium a donné à cette fraude un nom : brunellopoli. L’article est illustré d’une photographie qui ne laisse planer aucun doute. L’information n’est pas arrivée chez nous, mais elle n’a pas échappé aux Canadiens. Faut-il soulever le couvercle ?
Les Gaulois aimaient-ils le vin ?C'est l'été dans les pages du Monde. Le quotidien consacre une « série » à « nos ancêtres les Gaulois ». Cette semaine, le sang et le vin. Le décor est planté : la dernière bulle des albums d'Asterix. « Ces formidables agapes ont-elles seulement existé ? interroge le journaliste. 'Non seulement elles ont existé, mais à dire, comme Uderzo et Goscinny, qu'en Gaule 'tout commence et tout finit par un banquet', on ne doit pas être très loin de la réalité, répond dans Le Monde l'archéologue Matthieu Poux (université Lyon-II). L'activité religieuse, funéraire, les victoires militaires, mais aussi les 'campagnes politiques' de certains aristocrates, sont autant d'occasions de banqueter.' Néanmoins, nos ancêtres ont eu « eu des relations au vin compliquées et changeantes ». Il semble que le vin ait disparu des tables pendant trois siècles. La responsabilité en incomberait aux druides. L'article propose un raccourci sans doute un peu caricatural sur le sujet, mais il en a l'efficacité : nous avons aussi nos druides.