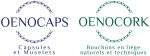ur le marché international, la mode est aux vins fruités qui, selon la définition de Bruno Kessler, des Grands Chais de France, sont des « vins faciles à comprendre et à consommer, adaptés aux consommateurs non avertis ». Ils constituent le cœur de gamme du marché, dans une fourchette de prix de 2 à 6 € la bouteille. Ce thème des vins fruités à été au cœur des débats des Entretiens viti-vinicoles Rhône Méditerranée, organisés par ITV France et l’INRA le 31 mai dernier à la Grande Motte. Daniel Granès, Directeur Scientique de l’ICV et Caroline Bonnefond, chargée de mission à la Direction scientifique de l’ICV, ont fait le point sur la gestion des vinifications en rouge pour l’expression fruitée des vins.
Favoriser une extraction précoceLes composés les plus intéressants pour l’obtention des notes fruitées dans les vins sont extractibles tôt, lorsque la teneur en alcool est encore faible. Il faut donc travailler le raisin le plus tôt possible, soit par des macérations pré-fermentaires à froid, soit avec des outils de thermo-traitement de la vendange pour favoriser ces extractions. Le problème posé à l’œnologue, c’est que les notes végétales sont également renforcées par des extractions précoces. L’idéal est donc de travailler sur des raisins bien équilibrés et à parfaite maturité. En cas de maturité défaillante, il convient alors de limiter au maximum les triturations du raisin : éviter le foulage des raisins. Mieux vaut évoluer vers des éraflures-fouloirs qui éraflent la vendange avant de la fouler, évitant ainsi la dilacération des parties végétales (et donc la libération de composés indésirables) tout en ouvrant la voie (sans trituration) à la libération des composés recherchés. utiliser les techniques d’extraction telles que délestage, remontage, pigeage, rotation (cuves spécifiques) qui, toutes, permettent d’obtenir du jus tôt et en quantité suffisante pour favoriser les échanges. Le délestage sera à privilégier dans le cas de vendanges limites en maturité car il permet une extraction douce et sans trituration. Il est par ailleurs d’une grande souplesse de mise en oeuvre, car il offre la possibilité d’apporter le l’oxygène, à dose contrôlée, sur tout le volume du moût, de refroidir ou de réchauffer, d’adoucir ou d’accentuer les extractions en envoyant le jus par le fond ou le haut de la cuve. En revanche, les cuves rotatives ou les cuves à remontage assisté présentent l’avantage de pouvoir enchaîner un grand nombre d’extractions les plus douces possibles alors que le chapeau de marc n’est pas encore formé ou en cours de formation, Mais la trituration est plus accentuée qu’avec un délestage ou un remontage. Les actions ultérieures ou concomitantes comme les apports contrôlés d’oxygène ou les mises au propre bien conduites permettent de corriger une grande partie des conséquences négatives de la trituration. bien gérer les presses. Pour un objectif de vins fruités, il convient de pratiquer des cuvaisons courtes. Il reste donc une quantité notable de moût à extraire du chapeau en fin de macération. Il faudra donc veiller à séparer le jus de coule des presses : 1000 mbar est la pression au-delà de laquelle il convient de ne plus réincorporer les presses avec les coules, pour des cuvaisons courtes. Sur les ateliers de thermo-traitement de la vendange, la qualité du pressurage est de moindre importance sauf dans le cas des macérations pré-fermentaires à chaud conduites ensuite en phase liquide : on retrouve plus de verdeur et de végétal (donc moins de sensation « fruité ») quand on utilise des systèmes qui triturent fortement comme les pressoirs continus ou à impulsion. Le recours aux enzymes qui favorisent l’extraction. En agissant sur les pectines mais aussi sur les parois pecto-cellolosique de la pulpe et de la pellicule, les enzymes favorisent la libération des composés aromatiques ou des précurseurs d’arômes. Elles ont par ailleurs un effet clarifiant en fin de fermentation alcoolique, ce qui permet de réduire le pressurage et de rendre plus efficaces les mises au propre et les soutirages, ce qui est essentiel pour se prémunir contre les odeurs soufrées. Les enzymes « indigènes » s’expriment à leur maximum après un à trois jours de cuvaison, donc à un moment où l’alcool est déjà présent et où une partie des extractions a déjà été conduite. L’enzymage à l’encuvage est donc recommandé pour l’obtention de vins fruités, car il favorise les extractions précoces et contribue au renforcement du profil fruité. des températures de macération entre 23 et 25°C Le régime thermique a un impact indirect mais primordial sur les extractions : il ralentit ou accélère le rythme d’accumulation d’alcool qui joue sur la solubilité de nombreux éléments et il ralentit ou accélère les activités enzymatiques. Vinifier à basse température par exemple favorise l’extraction de composés à dominante fruité mais aussi « herbacé » et modifie largement les extractions polyphénoliques. Mais on constate également que macérer 5 jours à 23°C oriente le profil des vins vers des types plus fruités et plus structurés comparativement à une macération à 28°C. En zone méditerranéenne, c’est une erreur de croire qu’il est absolument nécessaire de macérer chaud pour extraire. La maturité cellulaire, qui conditionne la fragilité des parois, est souvent très avancée dans nos régions : sauf à macérer et fermenter aux alentours de 20°C ou en dessous, on ne constate que rarement des différences significatives de couleur ou d’IPT. 5 à 7 jours de macération La durée de macération qui assure le meilleur compromis entre fruité/volume en bouche/ intensité tannique et astringence est de 5 à 7 jours après le début de la fermentation alcoolique (FA). En-deçà, on manque de couleur et de volume, au-delà l’agressivité tannique est excessive sauf à cuver plus longtemps (plus de 15 jours) ou faire la fermentation malo-lactique (FML) sous marc, ce qui fait également évoluer le profil aromatique vers des notes plus « confiture » ou « pruneau ». l’ajout de copeaux les copeaux, désormais autorisés après la fermentation alcoolique, libèrent des composés qui participent aux sensations de fruité. La variabilité entre fournisseur est importante, il convient donc de se reporter aux conseils d’utilisation de chaque fabriquant pour décider du type de bois à utiliser (chêne américain ou français), le moment de mise en contact, la durée, le grain, le rapport masse de bois/ volume de vin, et la chauffe.
Stabiliser les notes fruitées après l'extractionLes deux éléments qui permettent de stabiliser les notes fruitées, mais aussi le volume et la rondeur sont les levures et l'oxygène. Mais le régime thermique aura également son importance dans la mesure où il conditionne les cinétiques de réaction et favorise ou ralentit la stabilisation. Après décuvage, l'expérience montre qu'un travail autour de 20°C favorise l'expression fruitée tout en restant conforme aux exigences des bactéries lactiques responsables de la fermentation malo-lactique. Par la suite, une température stable autour de 16 à 18°C, en évitant les dissolutions non maîtrisées d'oxygène, permet de conserver le fruité. Le choix de la levure : Les levures ont un impact évident sur le profil organoleptique des vins. Le choix d'une levure adaptée doit se faire en fonction des objectifs produit recherchés. Par ailleurs, lors de leur autolyse, certaines levures libèrent des mannoprotéines, capables de stabiliser certains composés d'arômes comme la ß-ionone ou l'hexanoate d'éthyle. Là encore, cette capacité de stabilisation varie en fonction de la souche de levure : les essais ont démontré une meilleure aptitude de la D80 comparativement à la D21. Par ailleurs, des préparations de levures inactivées, s'autolysant rapidement sont disponibles depuis 5-6ans : elles libèrent, entre autres, des mannoprotéines susceptibles de stabiliser les composants d'arômes. la maîtrise de l'oxygène L'oxygène est également un facteur déterminant dans l'élaboration des vins fruités : à trop forte dose, il fait perdre le fruité, à trop faible dose, on risque une stabilisation des notes « herbacé » ou un développement des odeurs soufrées. Les travaux de l'INRA ont montré la nécessité d'apporter au moins 8mg/l entre le premier tiers et la moitié de la fermentation alcoolique. Après FA, les lies sont de fortes consommatrices d'oxygène : il faut prendre en compte leur niveau, clarifier si nécessaire avant de s'appuyer sur la dégustation pour déterminer débit et durée d'apport d'oxygène. A titre d'exemple, sur des vins peu concentrés et clarifiés, la diminution des notes « herbacé » sans préjudice sur le « fruité » se fera avec des apports inférieurs à 15mg/l/mois pour un total généralement inférieur à 20mg/l, soit en 2 à 4 semaines.
Eviter le développement de notes négativesLes arômes « soufré », « herbacé » ou « animal » masquent le « fruité » et sont rejetés par une majorité de consommateurs. Pour les éviter ou les limiter à un niveau acceptable, il est d’abord nécessaire de parfaitement maîtriser les fermentations alcoolique et malo-lactique. Au-delà de cet impératif, trois facteurs sont déterminants pour se prémunir contre ces composés aromatiques indésirables : l’oxygène permet de réduire les odeurs soufrées et les notes herbacées pendant la FA comme après. Son dosage doit être parfaitement maîtrisé sous peine de faire perdre le fruité, voire de favoriser le développement de microorganismes contaminants. Les lies et leurs mouvements Les lies consomment de l’oxygène et libèrent des composés soufrés particulièrement stables. Procéder à leur remise en suspension et/ou à leur élimination régulière notamment en fin de FA et FML permet d’éviter le développement de notes négatives. De plus, le pilotage des apports d’oxygène est facilité sur vins clairs de même que l’efficacité des sulfitages à venir. L’hygiène et le SO2 actif. Après FML, le vin n’est pas à l’abri de contaminations microbiologiques qui risquent de lui faire perdre son fruité. Nettoyer, détartrer, désinfecter, sulfiter à juste dose et de manière homogène sont les règles incontournables pour éviter le développement des mauvaises odeurs et de l’acidité volatile. Le contrôle régulier par mise en culture sur milieux spécifiques avec enregistrement des résultats, doit être intégré dans le Plan de Contrôle, identifiant la nature et la fréquence des suivis tout comme les actions préventives et correctives à mettre en œuvre.